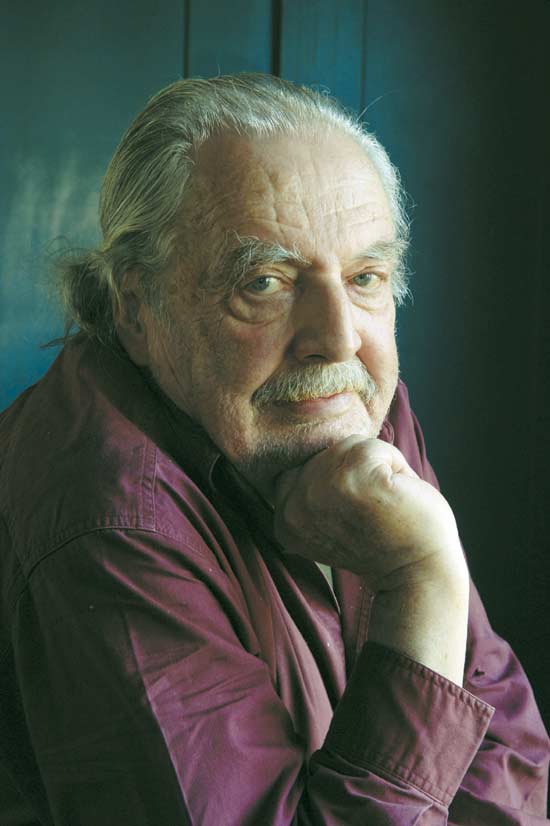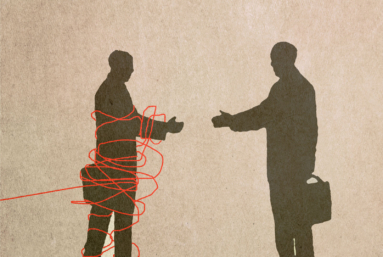« Il fallait tout inventer »
Alors que s’ouvre la soixantième édition du festival de Cannes,
Alain Tanner publie « Ciné-mélanges », un livre-bilan sur son expérience de cinéaste, très critique sur la situation actuelle.
dans l’hebdo N° 952 Acheter ce numéro
Alain Tanner, avec ses « collègues » Michel Sutter ou Claude Goretta, fut l’un des inventeurs de ce qu’on a appelé le Nouveau Cinéma suisse. Après le Free Cinema en Grande-Bretagne, la Nouvelle Vague en France, deux mouvements qu’Alain Tanner a croisés dans sa jeunesse, il participe à l’élaboration d’un cinéma à petits budgets, libéré des contraintes académiques, et politisé. Près de cinquante ans plus tard, et plus de vingt films aux styles divers, dont la Salamandre (1971) et Dans la ville blanche (1982), il a décidé de tirer un trait. Sous forme d’un abécédaire au ton léger sans jamais être badin, il expose ce qu’a été son credo esthétique et s’en prend sèchement aux dérives commerciales du cinéma d’aujourd’hui.
Photo : Pache/Opale
La loi du marché est entrée dans la tête non seulement des producteurs de cinéma, mais aussi des cinéastes. Ce qui crée de la peur, dites-vous. Or, « on ne crée rien avec la peur au ventre » …
Alain Tanner : Je crois que le marché se verrouille de plus en plus. Je n’aimerais pas être un jeune de 25 ans avec un désir de cinéma aujourd’hui, parce que l’espace qui existait quand nous avons commencé a disparu. À la fin des années 1960, on comptait 50 salles indépendantes au Quartier latin, il y avait de la place pour ce que nous voulions faire. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. En outre, le cinéma est régi par un énorme système économique et publicitaire. Il faut faire des films qui marchent. D’où la peur au ventre des cinéastes, des jeunes en particulier. Si leurs films ne marchent pas, leur carrière sera avortée. Il reste peut-être un petit espace pour faire autrement, mais on est tout de suite mis dans la marge, dans la marge de la marge plus exactement, et les films restent très confidentiels.
Ne pensez-vous pas que des festivals comme celui de Cannes, avec ses différentes sections, offrent encore une visibilité pour de jeunes cinéastes ou de moins jeunes, qui ne se soumettent pas aux normes du marché ?
Hormis la Caméra d’or, qui récompense un premier film, le reste, hélas, est oublié. Ma dernière sélection à Cannes, pour Requiem (1998, NDLR), à la Quinzaine des réalisateurs, n’a servi à rien d’un point de vue commercial. Dans Ciné-mélanges , j’avais prévu un passage sur le Cannes de mes débuts, à la fin des années 1970 je l’ai finalement coupé pour ne pas faire trop long , où je racontais que c’était le festival off, la Quinzaine des réalisateurs, la Semaine de la critique, etc. qui importaient alors et intéressaient avant tout les critiques et les distributeurs. Les gros films commerciaux de la sélection officielle laissaient indifférents parce qu’ils étaient déjà vendus. Moi, je dois beaucoup à ce festival de Cannes-là, qui était un bouillonnement d’idées, de rencontres…
À propos de vos débuts, en Suisse, vous dites que, par bonheur, il n’existait pas à l’époque d’industrie et de cinéma suisses, ce qui vous a permis de mener à bien vos « bricolages »…
On faisait du cinéma en dehors de toute idée de marketing, de distribution « bankable ». Et puis, comme rien n’existait, il fallait tout inventer. C’était enthousiasmant, il y avait un élan formidable, une dynamique entre cinéastes, techniciens…
Votre constat de la situation présente étant plutôt noir, à qui adressez-vous ce livre, « Ciné-mélanges » ?
Aux gens qui aiment encore le cinéma, ils sont nombreux. Le livre est déjà sorti en Suisse, et ceux qui l’ont lu apprécient que soit remis en mémoire le fait qu’il y a une pensée dans le cinéma, même si elle n’est plus mise en pratique. Les cinéastes qui s’en préoccupent aujourd’hui appartiennent à des cinématographies lointaines, les Turcs, les Ouzbeks ou les Kazaks…
Les théories de Bertolt Brecht ont été très importantes pour vous…
Les techniques de distanciation que j’ai utilisées ne sont pas du brechtisme appliqué au cinéma, mais elles viennent effectivement de Brecht. C’est lui qui m’a appris à déconstruire la narration et le récit classiques. Et c’est exactement ce que j’avais envie de faire.
À propos de la dimension politique des oeuvres, vous citez un philosophe allemand peu connu, Max Raphaël…
Oui, c’est un philosophe marxiste du début du XXe siècle. Je cite ses phrases éclairantes : « Le sens révolutionnaire d’une oeuvre d’art n’a rien à voir avec son sujet en lui-même, avec l’utilisation fonctionnelle dont il peut être l’objet. C’est un sens qui est continuellement en attente d’être découvert et libéré. Les valeurs d’une oeuvre résident dans l’activité révélée par l’oeuvre elle-même. » Autrement dit, la dimension politique des oeuvres réside dans leur forme. La censure aujourd’hui, la censure économique, ne s’y trompe pas. Cela dit, la dimension politique peut aussi se situer dans le sujet. Mais, dans ce cas, il faut savoir transcender le naturalisme. Peu de cinéastes y parviennent. Ken Loach y arrive parce qu’il a un talent fou pour mettre en scène la classe ouvrière anglaise, et parce qu’il a un regard personnel sur elle.
Vous dites que le travail sur la durée des plans est une conquête de la modernité. Pourquoi ?
La durée du plan pose véritablement la question du montage. C’est-à-dire qu’il ne s’agit pas de recoudre au montage ce qui a été décousu au tournage, mais de faire des films dont les séquences doivent toutes entre elles avoir un rapport lié au sens, beaucoup plus qu’à la fluidité narrative. Or, cela ne peut se faire qu’à partir d’un plan d’une certaine durée.
Mais la modernité n’est pas seulement affaire de plans longs. C’est aussi, comme le dit le poète Octavio Paz, trouver la meilleure mise en oeuvre des moyens techniques, formels, etc., qui permet de faire en sorte qu’à l’intérieur de l’oeuvre elle-même s’esquisse une critique sur le moyen d’expression utilisé ; en l’occurrence, le cinéma.
Vous dites de « l’esthétique TF 1 », de celle des clips et des publicités, qui multiplient les plans aléatoires, les images furtives, etc., qu’elles finissent par déformer le regard des spectateurs…
Oui, mais pas seulement le regard. L’oreille aussi. Même les séries télés, policières en particulier, sont affectées. On n’y entend plus les acteurs. Le son est bourré d’une espèce de soupe, qui n’est plus vraiment de la musique, mais du bruit de fond. On va finir effectivement par rendre les (télé)spectateurs sourds et aveugles.
Votre activité de cinéaste semble vous avoir préservé de l’esprit adulte…
Il y a inévitablement une part de jeu dans le cinéma, comme dans le théâtre. Même quand il traite de questions graves, le cinéma garde une dimension ludique. Et quand il m’arrive de croiser un ancien camarade de classe qui est devenu procureur, je ne me sens pas tout à fait sérieux…
Vous avez décidé de ne plus tourner…
Avec Paul s’en va , que j’ai réalisé en 2004, j’ai décidé d’arrêter définitivement. Parce que tout ce qui précède un film chercher le financement, mendier auprès des chaînes de télévisions, etc. , sans, en plus, être certain d’y arriver, et tout ce qui suit le film, c’est-à-dire les problèmes de diffusion, est devenu pour moi trop insupportable. Si je n’avais fait du cinéma que pendant quinze ans, je serais très embêté. Mais, à 78 ans, j’ai près de cinquante ans de cinéma derrière moi. Je n’ai donc aucun regret, aucune amertume.
Pour aller plus loin…

« No Fear of the Dark », des ténèbres à la lumière

« Talitakum » : boules de nerfs

« Bushman », la violence de l’État