Économie sociale : « Donner de la liberté à l’initiative citoyenne »
Nommé haut-commissaire à l’Économie sociale et solidaire dans un contexte d’inquiétude pour le secteur associatif, Christophe Itier défend sans complexe une vision entrepreneuriale de l’action sociale.
dans l’hebdo N° 1471 Acheter ce numéro
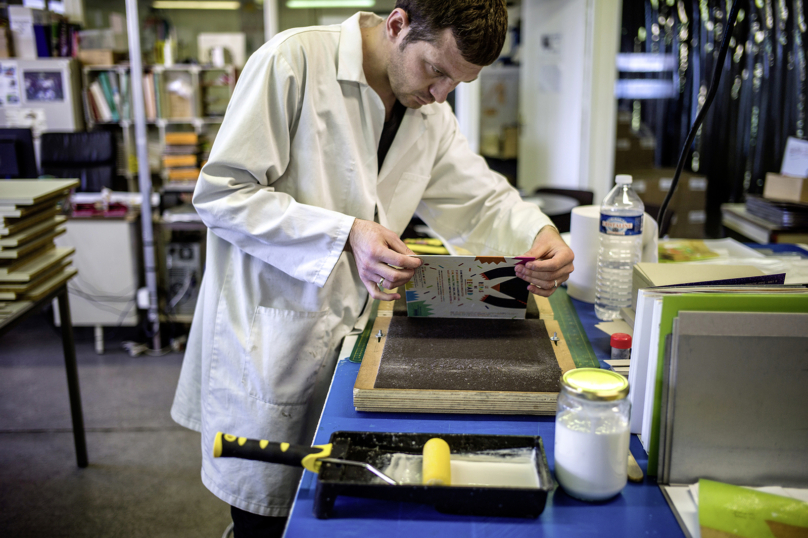
C’est un petit nouveau dans les hautes sphères du pouvoir, et ça se voit. Pas encore de fiche Wikipédia sur Internet et, dans son modeste bureau hébergé par le ministère de Nicolas Hulot, où il a emménagé trois jours plus tôt, Christophe Itier, fraîchement nommé haut-commissaire à l’Économie sociale et solidaire, reçoit sans manières : celui qui assure être imperméable aux attributs clinquants du pouvoir sert le café lui-même et, au lieu de demander à relire l’entretien qu’il nous a accordé, s’inquiète simplement de ce qu’on ne lui fasse pas « dire de bêtises ». L’ex-patron de la Sauvegarde du Nord – une association d’aide sociale à l’enfance –, à la « coolitude » toute macronienne, jure qu’à son nouveau poste il respectera tous ses (multiples) interlocuteurs.
La forte baisse des contrats aidés entérinée par le gouvernement pour 2018 (– 56 % en deux ans) pèse sur le secteur associatif. Pouvez-vous le rassurer ?
Christophe Itier : La situation de ces contrats incombe au gouvernement précédent, qui a voté une baisse de 150 000 emplois aidés pour 2017. Pour tenter d’amortir le choc, nous en avons créé 40 000 [1], mais dans le fond, nous sommes face à des questions structurelles. D’abord, on doit s’interroger sur l’efficacité de ce dispositif pour sortir les personnes du chômage de longue durée et, si ce n’est pas le cas, revoir en profondeur les dispositifs d’insertion professionnelle afin de les rendre plus performants. C’est le sens de la mission qui a été confiée par Muriel Pénicaud à Jean-Marc Borello [fondateur du Groupe SOS, NDLR].
Ensuite, cela pose la question du financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS). Les contrats aidés ont longtemps constitué un outil pour pallier la baisse des subventions. Or, il faut que l’on sorte de ce système de « rustine » pour consolider le modèle associatif. Ne serait-ce que parce qu’il est impensable que des salariés travaillant dans des associations qui luttent contre la précarité soient eux-mêmes précaires !
Aujourd’hui, les associations subissent des injonctions paradoxales : on leur demande d’être plus performantes en termes de gestion, et on ne subventionne plus le fonctionnement de leur structure, mais uniquement leurs actions. Il faut sortir de cette spirale négative, qui a été masquée temporairement par les contrats aidés. C’est l’occasion de réinterroger l’ensemble de l’écosystème du secteur associatif.
Pour vous, les associations sont des entreprises ?
Bien sûr ! Quand vous allez aux prud’hommes, c’est le même droit du travail qui s’applique. Je ne vois pas en quoi c’est choquant, et je suis fatigué des guerres de chapelle. Arrêtons d’être sur la défensive, soyons offensifs : moi, je veux que l’ESS pollinise l’économie, pas l’inverse ! Il faut aller chercher des bonnes pratiques de gestion dans le modèle entrepreneurial. Et, inversement, les acteurs de l’ESS sont porteurs de tendances sociétales et citoyennes qui doivent venir bouleverser notre modèle de développement.
Quelles sont vos propositions pour consolider le financement de l’ESS ?
L’enjeu, c’est de co-construire les réponses. J’ai convoqué le bureau du conseil supérieur de l’ESS [2] et lui ai demandé de produire une série de propositions concrètes pour la fin de l’année, en vue d’une mise en œuvre, je l’espère, dès 2018. Ce conseil a une portée légale qui sera opposable au gouvernement. Ce n’est pas une structure cosmétique.
Il y aura une trentaine de mesures très précises pour le développement et la consolidation du modèle économique des entreprises de l’ESS. Le deuxième axe de travail sera celui de l’innovation sociale : il s’agit de développer un écosystème plus favorable à la multiplication des expérimentations. Enfin, il faudra s’interroger sur l’évaluation et la mesure de l’impact social des actions menées.
Ces propositions du conseil nous seront remises, à Nicolas Hulot et à moi-même, afin que je puisse mettre en œuvre une feuille de route sur le quinquennat à venir.
Il y aura donc une loi ESS en 2018 ?
Le véhicule juridique n’est pas mon sujet. Si je peux m’éviter de passer par une loi et tout faire par des réglementations, cela me va bien.
Le principe de l’appel d’offres doit-il prendre le pas sur la subvention, pour le financement des associations ?
C’est un vaste débat qui pose la question de l’indépendance des associations vis-à-vis des financeurs publics. Je crois qu’il faut rééquilibrer cette relation. Car l’accroissement du contrôle des financeurs sur les associations, pour la moindre dépense, les submerge de contraintes administratives. Les directeurs sont au bord de l’épuisement, parce qu’ils doivent à la fois travailler au projet associatif, s’occuper des bénévoles et répondre aux financeurs. Du côté des collectivités, cela mobilise une armada de fonctionnaires qui pourraient être utiles à autre chose.
Il faut changer de culture, pour redonner de la liberté et du souffle à l’initiative citoyenne et associative. Le pendant de cette liberté, c’est la responsabilité. S’il y a des erreurs de gestion, l’association doit en assumer les conséquences.
Votre volonté d’hybridation entre les associations et le secteur privé, votre goût pour l’innovation… Tout cela ne risque-t-il pas de privilégier les grosses structures de l’économie sociale, au détriment du foisonnement associatif propre à l’économie solidaire ?
Non. Une partie de l’action sociale peut être portée par de grosses associations, parce qu’il s’agit d’activités plus normées et qu’il y a des effets d’échelle. Mais d’autres domaines de l’ESS doivent rester dans une granularité fine. On ne fait pas de la prévention spécialisée de manière industrielle, par exemple. C’est toute la difficulté de ce secteur. Il y a des formes juridiques, des tailles et des modèles économiques nécessairement différents.
Je ne suis pas le défenseur des grands mammouths. Il faut arrêter de penser en cases, avec d’un côté les « salopards de managers » et de l’autre les « doux rêveurs ». On ne peut pas diriger un établissement si on ne comprend pas l’histoire du travail social qui a fait la richesse de ce pays. Je souhaiterais d’ailleurs que le professionnalisme français dans le travail social soit davantage valorisé, comme le luxe ou la gastronomie.
On observe une inquiétude au sujet des « contrats à impact sociaux » (CIS), qui permettent à un investisseur privé de financer un programme social et d’être remboursé, avec intérêts, si le programme atteint ses objectifs. Entre-t-on dans une nouvelle forme de spéculation sur l’action sociale ?
Ne jouons pas à nous faire peur ! Je comprends que cela percute certaines conceptions culturelles, voire idéologiques, avec l’idée que nous serions en train d’introduire un modèle financier dans un système de solidarité. Mais il s’agit d’un outil expérimental : nous sommes loin du « grand remplacement » du public par le privé ! C’est un outil complexe, avec des parties prenantes qui essaient de dégager des intérêts communs. Et, in fine, c’est la puissance publique qui décide : c’est un garde-fou important.
L’État et les collectivités ne signeront pas n’importe quoi : ils seront vigilants, au regard de leur expérience passée sur les partenariats public-privé (PPP) dans la construction, notamment.
Justement, les CIS ont hérité du surnom de « PPP du social », en référence au fiasco de certains PPP et parce qu’ils sont confidentiels. Validez-vous cette comparaison ?
Non : les CIS concernent des programmes de courte durée, pilotés par des associations ; les PPP concernent des équipements parfois surdimensionnés, qu’une collectivité doit payer sur le temps long, avec un environnement économique qui évolue. Et c’est une société d’exploitation privée qui contrôle l’infrastructure.
L’enjeu du CIS est d’aller chercher des financeurs privés pour qu’ils prennent un risque à un moment où la dépense publique est très contrainte. Ce n’est pas dans la culture de la puissance publique de mettre de l’argent sur la table pour récupérer des économies ensuite. Les collectivités payent toujours la réparation. Or, le CIS permet d’inverser la logique en investissant dans la prévention. Et le risque pris par le financeur privé est rémunéré par la collectivité, dans des proportions variant de 0 à 6 % [en plus du remboursement des sommes investies, NDLR]. Le CIS est quasiment une avance de trésorerie.
Quant à la méthode servant à mesurer l’impact social, comment éviter, par exemple, qu’une entreprise d’insertion sélectionne des profils « faciles » pour arriver à l’objectif que lui fixe un contrat, au détriment des plus fragiles ?
La mesure de l’impact social est complexe. Elle ne peut pas se résumer à un chiffre ou à un trait sur un baromètre. C’est pour cela que nous voulons lui donner des moyens, dans le cadre de l’« accélérateur d’innovation sociale » inscrit au programme d’Emmanuel Macron.
C’est crucial pour contrer le discours sur « l’assistanat », quand on démontre qu’un euro injecté dans un chantier d’insertion génère 2,40 euros de cotisations sociales et d’impôts – sans même parler du bénéfice pour la personne accompagnée. C’est aussi un enjeu majeur pour le secteur de l’ESS et les associations, car les choix budgétaires se font de plus en plus en fonction de l’effet levier de la dépense publique.
Il faudrait que nous ayons la capacité d’accoler des chiffres très clairs à toutes nos politiques sociales. Dans la protection de l’enfance, par exemple, nous avons beaucoup de difficultés à savoir ce que deviennent les jeunes après leurs 18 ans.
Les professionnels, eux, savent ce qui est efficace…
Oui, mais, pour que les décideurs fassent des choix budgétaires, il faut pouvoir leur fournir des données tangibles. Je comprends aussi les préventions de certains, mais je veux répéter que cela ne revient pas à se soumettre à la doxa managériale.
[1] De 460 000 contrats aidés en 2016, le Premier ministre a annoncé, le 21 septembre, qu’on passerait à 200 000 en 2018.
[2] Créé par la loi Hamon du 4 juillet 2014, il regroupe 71 membres, représentant les différents secteurs de l’ESS.
Pour aller plus loin…

Au pays des barges, les vaches sont bien élevées

« Marc Fesneau ne change pas du tout le cap »

« Ouvriers, paysans et mangeurs, ensemble »








