Court, bon, juste et frais !
Vente en direct, marques équitables, enseignes bios, supermarchés coopératifs… Les nouvelles manières de s’approvisionner de façon plus éthique sont légion, panier au bras ou clic au doigt. reportage
dans l’hebdo N° 1539 Acheter ce numéro

La ruche et poiscaille : tous en ligne
Des fruits, des légumes, des fromages, des herbes aromatiques, de la viande… Pas de rayons, mais des étals où s’additionnent une flopée de victuailles, en un point éphémère, ou presque. Créée en 2011, La Ruche qui dit oui ! comprend plusieurs centaines de lieux de vente en France. Objectif : resserrer les liens entre petits producteurs et consommateurs, en mettant en avant le local et en effaçant les intermédiaires. C’est au futur client de s’inscrire sur le site Internet de La Ruche. En indiquant son adresse, il trouve la ruche la plus proche de son domicile, choisit ses emplettes, paye en ligne et vient retirer ses courses le jour dit dans un bistrot, une école, une salle quelconque.
À chaque ruche, orchestrée par un responsable, sa variété de produits, certains bio, d’autres en agriculture raisonnée. C’est au producteur de fixer son prix et de déterminer ce qu’il est prêt à livrer. Pour lui (qui doit gérer les commandes et reverser environ 16 % de son chiffre d’affaires à la ruche), c’est une manière d’écouler une partie de sa production. Pour le consommateur (inscrit dans un réseau, une communauté), c’est la garantie de manger local, sans engagement systématique, avec une souplesse dans les achats qui n’existe pas dans une Amap.
D’aucuns diront qu’il s’agit là d’une entreprise commerciale. Ça l’est (on trouve même un certain Xavier Niel parmi ses actionnaires) ; cela n’en reste pas moins une manière de contourner la grande distribution et de se rapprocher des producteurs.
Plus original encore, toujours sur Internet, le site Poiscaille, à lire comme une « Amap de la mer », en plus flexible. Créé fin 2014, installé à Montreuil, il livre poissons, coquillages et crustacés partout en France, en respectant un cahier des charges strict. Poiscaille est ainsi cornaqué à une soixantaine de pêcheurs étirés le long des côtes françaises (Manche, Atlantique, Méditerranée). Bateaux de moins de douze mètres, ni chalut ni drague, techniques dormantes (ligne, filet droit, trémail et casier), pas plus de trois marins à bord, une pêche qui se fait en journée, ostréiculteurs et pêcheurs à pied. Foin de crevettes tropicales et de saumons élevés on ne sait comment.
Un système d’abonnement très souple (la commande peut être reportée), sans engagement, permet au consommateur de s’approvisionner pour un casier, en deux clics et suivant trois formules : une fois par semaine (19,90 euros), tous les quinze jours (22,90 euros) ou mensuellement (24,90 euros). Des prix attractifs. Quel que soit l’abonnement, six à neuf casiers différents sont proposés, en fonction de la pêche, pêle-mêlant différents produits (1 kg de poisson entier, ou 2 kg de coquillages, ou 1,5 kg de crustacés, le plus souvent deux produits). Entre la pêche, la commande et la livraison (dans une épicerie de quartier proche de chez le consommateur), il ne s’écoule pas plus de 48 heures, quand sur les marchés et dans la grande distribution un poisson peut rester à quai six à huit jours… Ni manipulation ni stockage. Une garantie de fraîcheur qui fait toute la différence pour un bar de ligne, un mulet, des coques ou des palourdes sauvages.
Les prix sont fixés d’un commun accord entre Poiscaille et le pêcheur. Un tarif supérieur à ceux du marché et de la criée. « C’est le postulat pour travailler avec des pêcheurs aux productions faibles, explique Charles Guirriec, cofondateur de Poiscaille.fr, c’est une manière de les convaincre d’œuvrer ensemble. » Non sans effet. Parce qu’on « influence les pratiques, on évite la surpêche tout en mangeant du poisson, on préserve mieux les fonds marins ». En privilégiant aussi certaines pêches, des poissons souvent délaissés comme le chinchard, la vieille ou le tacaud.
Contrairement à La Ruche, Poiscaille est donc propriétaire des produits qu’il achète, sans rien enlever au circuit court. C’est aussi une manière d’éviter les diktats de la grande distribution. Il faut croire que cette démarche éthique d’une pêche durable et vertueuse séduit. Poiscaille compte aujourd’hui 1 300 abonnés individuels et une soixantaine de restaurateurs.
Jean-Claude Renard
Pour une brique t’as d’la solidarité
C’est en 2014 que germe l’idée d’une marque équitable dans la tête de Nicolas Chabanne, déjà à l’origine de l’initiative « gueules cassées », visant à vendre des fruits et légumes « moches » (c’est-à-dire non conformes aux normes esthétiques habituelles), mais c’est en 2016 que le premier produit « C’est qui le patron ?! » est lancé. La crise du lait bat alors son plein et Nicolas souhaite répondre aux difficultés des producteurs en créant une brique de lait vendue au juste prix pour le producteur.
« L’idée était de comprendre le chaînon en difficulté [le producteur] et d’impliquer les consommateurs dans la mise en place de solutions, dont certaines existaient déjà », explique celui qui décide de consulter le grand public pour définir un cahier des charges. Origine du fourrage, durée de mise en pâturage des vaches, alimentation avec ou sans OGM et surtout rémunération du producteur : des milliers de personnes répondent à un questionnaire en ligne pour définir un produit conforme à leurs souhaits.
Avec son design minimaliste, la brique de lait « C’est qui le patron ?! La marque du consommateur » est lancée en décembre et obtient un franc succès. « Sans campagne de publicité ni commerciaux en rayon », ajoute fièrement l’entrepreneur. Un succès imputable aux réseaux sociaux, mais aussi au modèle de l’entreprise. Non seulement les questionnaires sont ouverts à tous, mais chacun peut devenir sociétaire pour un euro. Acquérir une part sociale de la SARL permet de participer aux assemblées générales et donc aux choix stratégiques de la marque. Tout ceci favorise l’implication et l’achat une fois le produit mis en rayon. « Les sociétaires et les consommateurs sont vigilants, et leur implication force les enseignes à respecter le prix défini à l’origine », explique Nicolas Chabanne.
D’abord distribuée exclusivement par la chaîne Carrefour, aujourd’hui présente dans la quasi-totalité des enseignes, l’entreprise revendique désormais une trentaine de références. Ce modèle d’équité profite à plus de 1 500 producteurs et ne cesse de s’élargir. « Tout part d’une idée simple de solidarité. Nos produits viennent répondre à une exigence de transparence et les consommateurs redécouvrent une vieille notion : voter par sa consommation pour un modèle plus juste. »
Hervé Bossy
Biocoop good cop
Une main tendue et une jeune pousse ont remplacé la planète Terre en forme de montgolfière, longtemps restée l’emblème de la marque Biocoop. Et une nouvelle devise : « La bio nous rassemble ». « Aujourd’hui, nous voulons porter à travers cette signature les enjeux de collectif, de coopératif et de construction à plusieurs », détaille Orion Porta, directeur général de Biocoop.
Soutenir l’agriculture biologique, mieux consommer, s’impliquer dans un modèle coopératif… Des valeurs que le réseau de magasins bio essaime avec succès depuis plus de trente ans, avec ses 560 magasins et son chiffre d’affaires atteignant 1,1 milliard d’euros en 2017. Mais la concurrence des enseignes traditionnelles se raccrochant à la mode du bio se fait de plus en plus envahissante. Carrefour revendique un chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros en 2018 sur le bio, et s’est offert l’enseigne So’Bio, qui compte huit points de vente dans le Sud-Ouest de la France. Chez Leclerc, les ventes de bio ne représentent « que » 930 millions d’euros en 2018, mais l’offensive s’organise autour du lancement de magasins 100 % bio, avec la promesse de rogner sur les marges, et pas sur la rémunération des producteurs.
Biocoop a une petite longueur d’avance dans la tête des consommateurs les plus militants mais, pour la conserver, il lui faut accentuer ses différences avec les géants de la grande distribution. Pour Guilhem Anzalone, sociologue ayant étudié Biocoop de 2006 à 2012, les débats peuvent notamment porter sur les règles de distribution. « Biocoop est un réseau de magasins indépendants, donc ce n’est pas forcément très différent de ce qu’on peut voir chez d’autres enseignes avec des franchisés. En fait, l’enjeu principal porte sur une question : les magasins ont-ils tous les mêmes pratiques ? Un travail est effectué pour connaître la situation de concurrence à l’intérieur et à l’extérieur du réseau, et pour s’interroger sur les moyens de ne pas la subir, ou en tout cas de la combiner avec le projet originel. »
En se professionnalisant au fil des années, l’enseigne historique de « la bio » a dû utiliser certains outils de la grande distribution – par exemple pour gérer les stocks –, mais sans renier son système démocratique de débat interne grâce aux assemblées (du local jusqu’au conseil d’administration), son exigence de qualité des produits (grâce au cahier des charges) et sa casquette militante : Biocoop a d’ailleurs lancé une pétition citoyenne en réaction à la déclaration d’Emmanuel Macron revenant sur son engagement d’interdire l’usage du glyphosate d’ici à 2022. La cohérence est son leitmotiv pour grandir.
Depuis deux ans, une cellule innovation réfléchit au développement de Biocoop, en accord avec ses convictions. « Le postulat de départ était d’affirmer que l’expérimentation était à la base de la création de Biocoop, afin de proposer des alternatives à l’alimentation et à la production de masse. Aujourd’hui, l’idée est de se demander comment notre modèle peut rester précurseur grâce à de nouveaux leviers, que ce soit sur le système de distribution ou les modes de consommation », décrit Thomas Dromer, responsable de la cellule innovation. Renforcer la visibilité de l’enseigne historique dans des lieux ruraux, excentrés ou inattendus semble être le nouveau credo. Ainsi, des présentoirs avec des produits Biocoop seront disposés dans des magasins à la ferme tenus par des producteurs ou dans des lieux culturels (cinémas, théâtres…), permettant par exemple de proposer des alternatives aux confiseries habituelles. Deux magasins dits satellites ont été créés à Nostang (Morbihan) et à Bourg-Argental (Loire) afin de « recréer du lien social et du lien commercial dans des zones rurales délaissées, et sans rechercher la rentabilité de ces boutiques qui sont forcément liées à un magasin Biocoop à proximité », explique Thomas Dromer. Des magasins « monométiers » misant sur les artisans bouchers, boulangers, fromagers émergeront aussi cette année, mettant l’accent sur la qualité de l’approvisionnement.
Et pour ne pas rater l’entrée dans l’ère numérique, Biocoop veut tenter l’e-commerce : on pourra passer sa commande depuis son ordinateur puis la retirer en magasin. Et nouer des partenariats avec des start-up prêtes à travailler sur des thématiques dans l’air du temps : flexitarisme, gaspillage alimentaire, proximité avec les producteurs… Outre le défi de la captation du bio par la grande distribution, Biocoop va devoir en relever un autre pour garder ses clients, coopérateurs fidèles et exigeants : garantir la philosophie vertueuse Biocoop malgré la multitude de partenariats.
Vanina Delmas
La démocratie, c’est leur rayon
En moins de dix ans, les supermarchés coopératifs et participatifs ont essaimé en France. On en recense plus d’une trentaine, de Montpellier à Lille en passant par Toulouse, Bordeaux ou Annecy. Tous s’inspirent du Park Slope Food Coop, supermarché new-yorkais créé en 1973, qui compte désormais 17 000 membres. Deux États-Uniens, Tom Boothe et Brian Horihan, ont importé ce modèle dans l’Hexagone pour ouvrir en 2010 La Louve à Paris, qui a connu un franc succès depuis. À l’automne 2017, il comptait près de 6 000 coopérateurs.
Le principe ? En échange de trois heures de travail par mois, les coopérateurs bénéficient de prix réduits sur des produits de qualité, souvent biologiques et locaux. Ils sont copropriétaires de la coopérative, avec l’autogestion pour fondement : les décisions reposent sur l’équation « un coopérateur = une voix » et les bénéfices sont réinvestis dans l’entreprise. La participation nécessitée par ce modèle permet de devenir acteur de sa consommation.
À Marseille, le Super Cafoutch est en voie de lancement. En 2017, l’association de préfiguration comptait déjà 400 membres, un an après sa création. L’épicerie-test, le Mini Cafoutch, a ouvert en avril 2018 afin d’« expérimenter à petite échelle le fonctionnement du futur supermarché ». Preuve de sa réussite, deux salariés ont été embauchés et 80 000 euros de chiffre d’affaires ont été réalisés en 2018. Ce projet s’est inspiré d’autres expériences, comme celles de La Louve ou d’Intercoop, un réseau de coopératives qui met à disposition des documents utiles et organise des forums en ligne pour organiser une entraide mutuelle.
Même s’il s’inspire d’un modèle existant, un supermarché coopératif est toujours singulier. Il se constitue par tâtonnements, en fonction du désir collectif de ceux qui le construisent. À Nantes, le Scopeli s’est doté d’une constitution qui insiste sur l’importance de recourir aux circuits courts, aux producteurs locaux et aux produits de saison alors que La Louve vend des « produits exotiques ». À Montpellier, La Cagette semble accorder beaucoup d’importance à l’aspect autogestionnaire et émancipateur de son projet. Si les valeurs revendiquées sont souvent proches, comme l’accès à une alimentation saine à prix raisonnable, l’écologie ou l’autogestion, chaque projet, tout en s’inspirant des autres, colore le sien avec des pigments qui lui sont propres.
Perçu comme un outil démocratique, ce modèle permet de recréer du lien social et de la solidarité dans des lieux qui sont appropriés par ceux-là mêmes qui les utilisent. Une alternative à la grande distribution, mais aussi au système institutionnel et capitaliste, lequel laisse peu de place à l’organisation autonome et collective.
Margot Poulain
Pour aller plus loin…

Le grand déséquilibre de l’accès à l’escalade
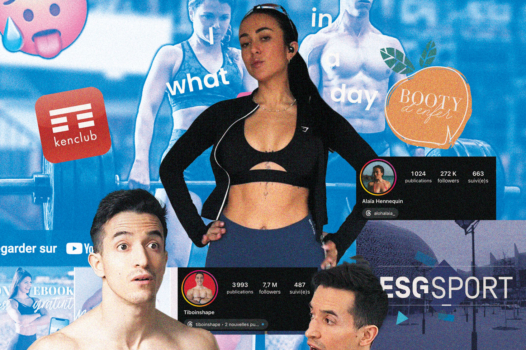
Le fitness, un business en très grande forme

Le stade de foot, laboratoire de la surveillance des foules








