Novarina, cirque austère
L’Animal imaginaire : le nouveau tour de piste métaphysique de l’auteur du Drame de la vie.
dans l’hebdo N° 1571 Acheter ce numéro
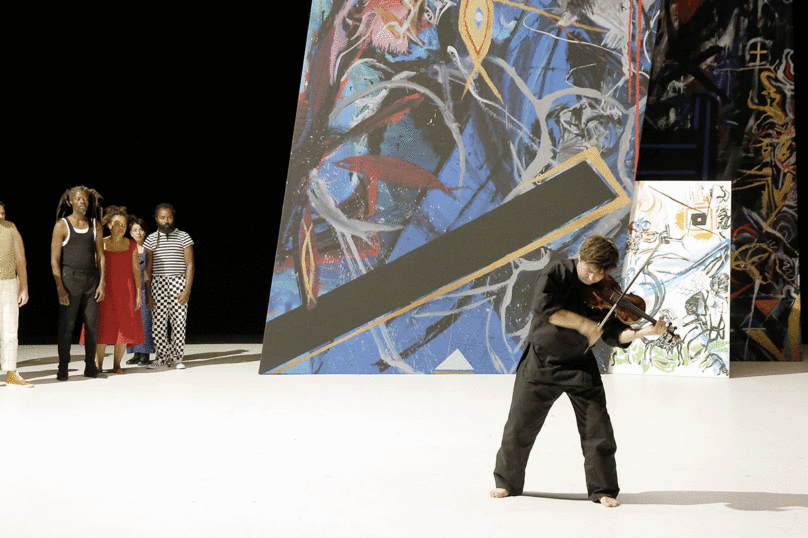
Que nous conte Valère Novarina depuis qu’il est apparu sur nos scènes avec son foudroyant Drame de la vie en 1986 ? Que le théâtre n’est pas nécessairement un lieu à dévider des histoires qui ont un début et une fin. Que la scène est le lieu de la parole non pas ciselée, mais brutale, répétée, martelée. Qu’il n’y a pas de différence entre l’animalité et l’humanité, et que la pensée s’appauvrit à se priver de sa vérité corporelle. Que, depuis la création, nous vivons dans une nuit que viennent éclairer les mots, et surtout les listes de mots – noms propres, noms communs, noms de métiers réinventés qui reflètent nos combats pour sortir d’une préhistoire où nous vivons encore. Que notre destinée consiste à « manger du temps » et à saisir autant l’espace et la durée où nous flottons dans un combat infini. Cela donne une œuvre cosmogonique et souvent comique, dont le succès n’était pas gagné et qui, peu à peu, a conquis son public.
Le public sait que ce disciple d’Artaud, cet admirateur de Dubuffet a retrouvé le sens cérémonial de la scène (tout en le bousculant avec une grande bouffonnerie). Avec sa nouvelle pièce créée à la Colline, L’Animal imaginaire, le rituel est celui d’un cirque austère qui aimerait la nudité et la géométrie. Le quadrilatère blanc de la scène porte en arrière-plan deux immenses toiles abstraites de Novarina lui-même, posées sur le mur du fond, l’une de biais pour laisser entre les deux châssis un passage et donner l’impression d’un déséquilibre dans un lieu où l’ordre semble revenu après une tempête.
Beaucoup d’autres tableaux de Novarina (et même – surprise – des toiles figuratives) interviendront, mais comme les comédiens : elles seront de passage et disparaîtront. Ainsi qu’une fontaine de sang jaillissant dans un angle pour se tarir au bout de quelques minutes.
Le spectacle fonctionne par grandes respirations, longues envolées. C’est d’abord l’affaire de deux acteurs merveilleux, Manuel Le Lièvre et Agnès Sourdillon, qui occupent seuls l’espace et qui, aussi paillasses que prophètes, se disputent une sorte de prééminence dans l’invention de phrases proverbiales, chacun faisant preuve d’un art différent de l’acteur, d’une manière opposée pour entrer, jouer, sortir. Puis les autres interprètes surgissent. Ce sont des habitués des fêtes foraines de Novarina : Dominique Parent, Nicolas Struve, Valérie Vinci. Et d’autres qu’on connaît moins : Julie Kpéré, Valès Bedford, Édouard Baptiste (avec qui l’auteur a travaillé en Haïti). Leurs moments individuels et leurs circonvolutions collectives sont de plus en plus métaphysiques : les propos qu’ils lancent en athlètes de la scène sont des clés pour l’existence sur Terre. Mais il y en a tant que ces proclamations de sagesses et de vérités semblent se fracasser sous le nombre.
Ces scintillements, par leur abondance, aboutissent curieusement à un brouillage. Novarina se plaît à les contrebalancer par un slogan, s’amusant à opposer la simplicité d’une formule coup de poing à la complexité. « Mort à la mort » était le cri d’une des précédentes pièces. « Les hommes ne sont pas bons » constitue le refrain du principal moment chanté, car musique et chant, réglés sur scène par Christian Paccoud, roi de la mélodie ronde et brute, ont une grande importance. Leitmotiv décourageant mais qu’il faut prendre comme une provocation amusée, un coup de pied de l’âne aux messages philanthropiques dont nous sommes abreuvés.
Long de près de trois heures, avec quelques rares moments qui font flop (certaines plaisanteries de chansonnier du deuxième acte, la représentation comique du sacrifice d’Abraham), le Novarina nouveau est un moment de théâtre inouï, dont le déroulement et le langage sont sans pareil. « Le messie, c’est la parole », proclame l’une des banderoles dans le tableau final. Cette parole claire-obscure est une réplique moderne aux livres saints, bibles et autres torahs. La petitesse et la grandeur de l’homme s’y expriment sur un mode sincère et parodique à la fois qui n’avait pas été imaginé auparavant.
L’Animal imaginaire, théâtre de la Colline, Paris XXe, 01 44 62 52 52. Jusqu’au 13 octobre. (Le 5 octobre, à partir de 11 h, journée consacrée aux traductions des œuvres de Novarina). Puis à Bayonne, Marseille, Meyrin, Villeurbanne, Saint-Louis, Sète. Texte chez POL.
Pour aller plus loin…

Avec Gatti, rouvrir l’horizon du théâtre

« Dispak Dispac’h », une très saine contagion

« Cavalières », l’éloge de la tentative








