La « neurodiversité » contre le soin ?
Le mouvement de la neurodiversité revendique le fait que l’autisme serait une simple différence dans le fonctionnement cérébral. Un tel discours en revient effectivement à nier la douleur, la perte d’autonomie, pour ne faire de l’autisme qu’un stigmate de l’intolérance de la société.
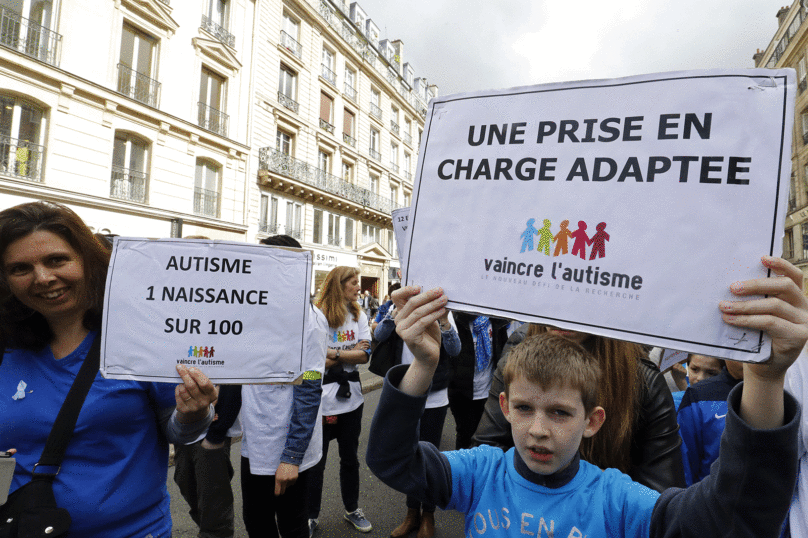
Une fois n’est pas coutume, ce billet proposera un commentaire de l’article « Why the neuro-diversity movement has become harmful », écrit par Mohed Costandi, neurobiologiste moléculaire, et traduit sur le blog de Jean Vicot. Dans cet écrit, Mohed Costandi revient sur le mouvement de la neurodiversité, et sur ses évolutions préjudiciables pour les personnes autistes. Au-delà de la problématique des troubles autistiques, nous essaierons d’élargir la réflexion à la question de la maladie mentale en générale.
L’article en question rappelle déjà la réalité de l’autisme, en insistant notamment sur la très grande hétérogénéité en termes de répercussions fonctionnelles et de degré de handicap au quotidien. Ainsi, les critères diagnostiques récents comportent 3 niveaux, en fonction de la gravité des troubles. Le niveau 1 associe une « difficulté à initier des interactions sociales », des « réactions atypiques ou infructueuses aux ouvertures sociales des autres », des « tentatives bizarres et généralement infructueuses » pour initier des relations amicales et des « problèmes d’organisation et de planification [qui] entravent l’autonomie ». Le niveau 2 comprend les « déficits marqués de communication sociale verbale et non verbale », « l’initiation limitée des interactions sociales », « une communication non verbale très étrange », ainsi que la « rigidité du comportement », la « difficulté à faire face au changement » et la « détresse et/ou la difficulté à changer d’orientation ou à agir ». Enfin, le niveau 3 correspond à « de graves déficits dans les habiletés de communication sociale verbale et non verbale [qui] causent de graves troubles du fonctionnement », « une initiation très limitée des interactions sociales et une réaction minimale aux ouvertures sociales des autres », « une difficulté extrême à faire face au changement », « des comportements restreints ou répétitifs [qui] nuisent de façon marquée au fonctionnement dans tous les domaines » et « de grandes difficultés ou difficultés à changer l’orientation ou à agir ».
A l’évidence, on perçoit bien que les personnes qui présentent une telle intensité dans leurs difficultés peuvent être très handicapées au quotidien pour s’intégrer socialement, communiquer, maintenir une forme d’autonomie, etc.
Les dernières estimations de prévalence des troubles autistiques aux Etats-Unis en arrivent à des chiffres de 1 sur 59, ce qui confirme l’augmentation exponentielle des diagnostics. Ce-pendant, il s’agit là d’une réalité extrêmement hétérogène, allant de troubles légers dans les interactions sociales à des situations de perte complètes d’autonomie, avec besoin d’assistance et de soins au quotidien. Ainsi, environ 40% des enfants autistes n’auraient pas accès au langage oral. Par ailleurs, les comorbidités associées contribuent très souvent à aggraver le handicap : « plus de la moitié des enfants atteints de TSA ont également une déficience intellectuelle (définie comme ayant un QI inférieur à 70) et jusqu’à la moitié pré-sentent des symptômes de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité ». La nécessité d’une prise en charge hospitalière du fait de troubles psychiatriques est également très éle-vée. Enfin, « l’autisme est aussi souvent associé à l’épilepsie, le taux le plus élevé étant observé chez les personnes dont le QI est inférieur à 40 ». Certains autistes doivent ainsi être protégés en permanence, car ils peuvent s’automutiler, ou présenter des crises clastiques très impressionnantes à la moindre variation dans leur environnement.
Il est très important de rappeler ces données brutes, souvent scotomisées lorsqu’on évoque spontanément l’autisme. En effet, les représentations collectives véhiculent davantage l’image de l’autiste de haut niveau, surdoué dans certains secteurs cognitifs, mais mal à l’aise dans ses interactions sociales.
Comme le rappelle Mohed Costandi, « le terme « neurodiversité » a été inventé à la fin des années 1990 par la sociologue Judy Singer, qui a soutenu que les personnes autistes avaient été opprimées à peu près de la même façon que les femmes et les gays, Le mouvement est une extension du mouvement des droits civiques et du mouvement de fierté des sourds qui a émergé après l’introduction des implants cochléaires ».
Ainsi, le mouvement de la neurodiversité revendique le fait que l’autisme serait une simple différence dans le fonctionnement cérébral, en affirmant que la souffrance des autistes ne serait due qu’à la marginalisation et à la stigmatisation dont ceux-ci seraient victimes au ni-veau social. Ainsi, il n’y aurait pas lieu de proposer des soins, mais de rendre la société plus accueillante, pour que le potentiel de l’autisme puisse enfin être accepté et reconnu au ni-veau collectif.
Ce concept de neurodiversité est également sous-tendu par le postulat selon lequel le substrat de la singularité d’une personne serait uniquement lié à la programmation génétique de son fonctionnement cérébral, en rejetant de facto toute dynamique de socialisation et d’imprégnation par les expériences relationnelles. Or, dans le cas de l’autisme, l’héritabilité, c’est-à-dire la part des facteurs génétiques dans l’expression des manifestations autistiques, est estimée entre 50 et 60 %, ce qui laisse une place non négligeable aux facteurs d’environnement…
D’une forme de lutte contre les discriminations, on en est cependant arrivé à une véritable apologie de « l’être autisme », et à un déni de la réalité de la souffrance générée par les situations les plus lourdes. Voici par exemple certains propos qui peuvent être revendiqués par les défenseurs de la neurodiversité : « Il n’y a rien tel que l’AUTISME SEVERE, tout comme il n’y a pas d' »homosexualité sévère » ou de « négritude sévère » » (John Marble)
Au-delà de l’affirmation identitaire, on peut légitiment souligner la violence que peuvent représenter de telles assertions pour les personnes souffrantes de formes très handicapantes d’autisme, et pour les aidants devant les soutenir au quotidien. Un tel discours en revient effectivement à nier la douleur, la perte d’autonomie, pour ne faire de l’autisme qu’un stigmate de l’intolérance de la société à une condition différente, » une variation de la normale « .
Ce postulat entre d’ailleurs en contradiction avec les recherches scientifiques dans le domaine de l’autisme, qui soulignent à quel point les personnes autistes présentent à la fois certains traits communs dans leur développement cérébral, mais surtout des spécificités individuelles qui vont à l’encontre d’une conception univoque et homogène. Comme le rap-pelle Mohed Costandi : « les neuroscientifiques s’entendent généralement pour dire que l’autisme a des origines neurodéveloppementales, des recherches récentes montrant qu’il est associé à des anomalies du nombre de cellules cérébrales et de la structure de la substance blanche, ainsi qu’à des défauts dans la taille synaptique, le processus par lequel les connexions synaptiques indésirables sont éliminées. La recherche montre également que la génétique joue un rôle majeur : chaque individu autiste porte un grand nombre de variantes génétiques très rares ou uniques, ainsi que des copies supplémentaires de gènes, de gènes supprimés et d’autres perturbations chromosomiques. Certaines sont héritées, d’autres sont générées à nouveau lors de la fécondation et dans les premiers stades de développement. Il semble donc que chaque personne autiste présente une combinaison unique de ces variations génétiques, qui se manifeste par un ensemble unique de symptômes comportementaux. »
La dimension culturaliste et identitaire du mouvement en faveur de la neurodiversité revendique donc une conception de l’autisme comme une variation homogène du fonctionnement cognitif humain soumise à des stigmatisations, voire à une forme d’oppression systématique. Pour les tenants de cette approche, les difficultés rencontrées par les autistes dans leur vie quotidienne sont imputables de manière univoque à « l’intolérance des personnes neurotypiques » – dont la définition reste purement négative, sans aucun fondement critériologique. On voit bien à quel point ce discours performatif est susceptible de créer des clivages, des amalgames et des catégorisations arbitraires en lien avec l’établissement d’essences im-muables et aliénantes. De la même façon que l’homme blanc, hétérosexuel, cisgenre peut être de façon automatique désigné comme un oppresseur, les « neurotypiques » sont également dénoncés comme étant à l’origine des souffrances des autistes, comme l’incarnation du mal, dans une logique binaire, voire paranoïaque, du « eux contre nous ». On peut légitimement critiquer un système de représentations et de pratiques discriminantes, comme le patriarcat, le sexisme, le racisme, l’intolérance à la différence et toute forme d’ostracisme. Mais il me parait toujours réducteur, voire dangereux, de s’en prendre à des amalgames de personnes censées incarnées, par essence, des catégories oppressives définies a priori, comme les hommes, les blancs, ou les neurotypiques.
De surcroit, l’autisme n’est pas une culture, une appartenance communautaire plus ou moins choisie ou assumée, un style de vie ou une façon différente d’appréhender la réalité et le lien. Il s’agit réellement d’un trouble complexe, intriquant des déterminismes génétiques, cérébraux, développementaux et environnementaux, et susceptibles d’induire de graves entraves dans l’accès à une vie sociale autonome. Cet état induit de facto une « normativité restreinte », c’est-à-dire, comme l’expliquait Canguilhem, une forme de contrainte « répulsive », visant à restreindre toute perturbation sans possibilité de se confronter, ou de dépasser ses propres normes.
Si l’on souhaite « dépathologiser » certaines formes d’autisme léger, il faudrait peut-être catégoriser autrement, voire même rebaptiser cette simple perception personnelle de singularité, d’atypicité ou de différence, n’induisant pas de souffrance ou de handicap majeurs, sans faire d’amalgame avec un spectre de troubles se situant manifestement dans le registre de la pathologie. Car la problématique est sans doute que le terme « autisme » recouvre des réalités bien trop disparates pour être unifiées ; et que souvent, on tend à négliger, si ce n’est à occulter, les formes les plus graves… Celles-ci se trouvent effectivement invisibilisées, tant au niveau des représentations que des politiques sanitaires. Déjà, les autistes les plus handicapés n’ont pas accès à la parole. De surcroit, ils sont susceptibles d’attiser une certaine d’angoisse, tant leurs symptômes peuvent être impressionnants, ce qui contribue sans doute à induire une forme d’évitement défensif à leur égard. Et puis, en termes de programme de santé publique, ils sont clairement laissés pour compte. Ainsi, il n’est sans doute pas politi-quement correct de venir mettre en lumière cette forme de maltraitance collective qui leur est imposée, par carence de prise en charge et de soins.
En tout cas, une des dérives de cette interprétation univoque de l’autisme en termes de discrimination sociale vis-à-vis d’une « dissemblance » consiste à refuser toute intervention soignante. « Les défenseurs de la neurodiversité qualifient encore de nazis et d’eugénistes ceux qui expriment un désir de traitement ou de guérison… ». Vouloir soulager les personnes les plus vulnérabilisées par leurs troubles reviendrait alors à entériner le stigmate, à marginaliser et à exclure davantage. Alors que pour ces « défenseurs de l’autisme », il suffirait uniquement de transformer la perception sociale, les regards, la reconnaissance et l’accueil des autistes, pour que la pathologisation et la souffrance cessent…
Voici par exemple quelques citations extraites du résumé de l’ouvrage « Autisme : j’accuse ! » d’Hugo HORIOT : « Et si l’autisme faisait partie de la biodiversité humaine, était une autre intelligence douée d’un potentiel hors normes, comme celui des surdoués ? »
« L’ambition actuelle visant à « éradiquer » cette forme d’humanité est partagée même par des autistes ou leurs parents, laissés exsangues par un interminable combat à mains nues »
« Les aides apportées par les « plans autisme » successifs nourrissent un système à la fois coûteux et infantilisant. Toute une population assistée se trouve littéralement dépossédée de son destin. La société va-t-elle encore se priver longtemps de ces compétences extraordinaires qui doivent être détectées, valorisées et cultivées le plus tôt possible ? »
On peut d’ailleurs s’interpeller sur l’argumentaire de l’ouvrage : les autistes auraient des capacités hors-normes, très bénéfiques pour la société (par exemple dans la Silicon Valley ou l’armée israélienne (sic)), et c’est à ce titre qu’ils devraient être respectés et célébrés…Il s’agit là d’une vision purement utilitariste, voire empreinte d’un darwinisme social tout à fait révoltant. Une personne n’a pas à être reconnue dans sa dignité parce qu’elle est compétente ou douée, mais simplement parce qu’elle participe de notre humanité élargie, avec sa singularité, ses vulnérabilités, et ses possibles.
Ces porte-paroles auto-désignés s’arrogent donc le droit de parler au nom de tous les autistes déficients, sans langage et en situation de dépendance complète, comme je l’avais déjà souligné dans un billet précédent https://www.politis.fr/blogs/2019/01/qui-parle-au-nom-des-autistes-34352/. « Dans leur quête zélée des droits des autistes, certains défenseurs sont devenus autoritaires et militants, harcelant et intimidant toute personne qui ose présenter l’autisme sous un jour négatif ou qui exprime le désir d’un traitement ou d’une cure. Cela s’étend aux chercheurs en autisme dans les universités et l’industrie pharmaceutique, ainsi qu’aux parents d’enfants autistes sévères. »
Une autre dérive de ces revendications de démédicalisation consiste à prôner une forme d’autodiagnostic de l’autisme, sans en passer par une évaluation clinique standardisée, médicalisée, et donc perçue comme normative et répressive. Ainsi, s’affirmer autiste peut désormais être considéré comme un acte transgressif, visant à revendiquer sa différence et son statut s’opprimé, ainsi qu’à expliquer de façon univoque ses difficultés existentielles par la stigmatisation sociale. En outre, cette catégorisation identitaire confère un sentiment fort d’appartenance communautaire, ainsi que la légitimation de certaines exigences et l’octroi de certains bénéfices, sur un mode parfois autoritaire. Car l’oppresseur est alors désigné de façon évidente : il s’agit tout simplement des non-autistes, des neurotypiques. Ceux-là mêmes qui refusent de comprendre, d’accepter, qui marginalisent et qui doivent désormais rendre des comptes. Et ce sentiment de préjudice, voire de persécution, peut se trouver encore exacerbé à l’égard de la communauté scientifique ou médical.
De fait, un lobbying extrêmement actif, voire agressif, tend à se déployer, avec des stratégies d’intimidation ou de menaces, auprès tant des instances politiques et des médias que du monde de la recherche. Comme le souligne Mohed Costandi, « bien que de nombreux chercheurs en autisme soient conscients de ces problèmes et trouvent la situation extrême-ment frustrante, très peu sont prêts à s’exprimer, de peur de compromettre le financement de leur recherche, d’offenser une population très sensible de patients et de parents ou d’être eux-mêmes victimes de harcèlement. ».
En contrepartie, tout discours contradictoire, toute proposition non « conforme », peut se voir systématiquement vilipendé, avec une intolérance explicite vis-à-vis de ce qui ne serait pas la conception orthodoxe et hégémonique de l’autisme. Et ceci contribue manifestement à biaiser les axes de recherche. Par exemple, les tenants de la neurodiversité seraient plutôt opposés aux recherches concernant les causes de l’autisme, pour des raisons idéologiques et par crainte sans doute que les avancées dans ce domaine ne viennent démanteler l’unité de l’entité « autisme ». De plus, il existe une sous-représentation des autistes déficients dans les protocoles expérimentaux, pour des raisons à la fois technique (difficultés à inclure les cas les plus lourds du fait de l’intensité de leurs symptômes, mauvaise discrimination clinique des outils diagnostics, etc.) mais aussi d’un manque de visibilité médiatique. « Bien que près de la moitié de la population autiste ait également une déficience intellectuelle, la majorité de la recherche a porté sur ceux dont le langage et la cognition sont relativement intacts. Ainsi, les personnes considérées comme ayant un « faible niveau de fonctionnement » sont négli-gées par le milieu de la recherche. »
Ce sont donc les personnes souffrant de formes sévères qui se voient de plus en plus marginalisées, dans la mesure où elles ne rentrent pas dans la définition de l’autisme prônée par ces mouvements de défenses : « la banalisation de l’autisme par les défenseurs de la neurodiversité se fait au détriment de ceux qui se situent à l’extrémité inférieure du « spectre » ».
Le constat de Mohed Costandi est à la fois saisissant et inquiétant : « ironiquement, un mouvement de justice sociale qui vise à mettre en lumière la façon dont les personnes autistes ont été maltraitées par la société est maintenant directement responsable des mauvais traitements infligés aux personnes autistes les plus vulnérables – dont beaucoup sont trop gravement touchées par leur état pour s’exprimer. En défendant leurs droits, un groupe de personnes marginalisées marginalise à l’excès les personnes mêmes qu’elles prétendent défendre. Ils ont monopolisé le discours public sur l’autisme et continuent de faire tout ce qu’ils peuvent pour faire taire les voix dissidentes ; cette incapacité à débattre et à essayer de trouver un compromis est un problème non seulement pour la communauté autiste, mais pour la société en général. »
Néanmoins, certaines voix dissidentes tentent de s’élever, notamment du côté des familles ou des soignants, en rappelant tout simplement la réalité des situations vécues, au-delà des revendications idéologiques. Cependant, ces témoignages portent malheureusement peu, tant ils se trouvent noyés au sein du discours hégémonique qui imprègne les représentations collectives depuis des années et qui tend à capter l’attention des décideurs politiques.
Et l’on peut d’ailleurs se demander si l’autisme ne constitue pas une sorte de cheval de Troie, avec comme perspective la remise en cause de l’existence de toute forme de maladie mentale. Mohed Costandi rappelle ainsi à quel point « il est inquiétant de constater que cette tendance à romantiser l’autisme s’est étendue à d’autres affections qui peuvent être graves, débilitantes et mettre la vie en danger. Il existe maintenant des groupes d’auto-intervenants qui célèbrent la dépression et la schizophrénie. Cela pourrait également être lié à la croissance des sites Web pro-anorexie, ainsi qu’à l’émergence plus récente de la « fierté de la toxicodépendance ». »
Originellement limité à l’autisme, le concept de neurodiversité s’est étendu depuis les années 2000 aux troubles des apprentissages et aux troubles de l’humeur. Ce mouvement en vient ainsi à prôner l’idée selon laquelle « des développements neurologiques atypiques comme l’autisme, ou, par exemple, la dyslexie, le syndrome de Tourette ou les troubles du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité sont un style de vie »…
On en arrive donc à une situation éminemment paradoxale : d’un côté, une demande sociale de plus en plus extensive de diagnostics médicaux et de reconnaissance de handicap – avec la multiplication de syndromes peu validés scientifiquement ; de l’autre, un refus ultérieur de tout accompagnement thérapeutique, vécu comme une oppression normalisatrice. A travers cette évolution, la médecine n’aurait finalement plus qu’un rôle de reconnaissance et d’officialisation d’un préjudice social, pourtant revendiqué comme inscrit dans la constitution neurologique et génétique des individus. Chacun vivrait alors enclos dans sa catégorie nosographique, sans volonté de s’émanciper d’une telle aliénation identitaire – ce qui suppose-rait déjà d’en passer par l’intervention d’un tiers- : « Je suis comme cela, c’est prouvé par la médecine, la société doit s’adapter à moi sinon elle fait violence à mon identité ». Mais existe-t-il encore un sujet au sein d’une telle dilution ? De fait, les « symptômes » sont tou-jours vecteurs de certains « bénéfices » ; ils exercent en tout cas une fonction dans l’économie psychique d’un individu, en induisant notamment des remaniements dans son entourage susceptibles d’apporter certaines gratifications plus ou moins conscientes, et d’alimenter ainsi le désir de maintenir le statu quo – quitte à s’enfermer alors dans un monde de plus en plus restreint et atrophié… S’en affranchir suppose un risque, un vertige, pour ne pas dire un bouleversement ; l’angoisse de s’appréhender soi-même comme projet et comme histoire, la nudité face à l’affirmation de sa propre autonomie, face au déploiement de son désir subjectif, au-delà des catégories toutes faites et des identités prêtes à porter…
Certes, la définition de la maladie mentale pose de nombreuses problématiques épistémologiques et éthiques, que nous ne ferons qu’effleurer. En effet, il s’agit toujours de considérer une forme de médicalisation de la souffrance humaine ; et ceci ne va pas sans mobiliser des enjeux à la fois sanitaires, mais aussi sociaux, anthropologiques et politiques, tout en considérant que les phénomènes impliqués s’inscrivent inévitablement dans un fonctionnement biologique et cérébral. Par ailleurs, la question du seuil entre le normal et le pathologique reste éminemment problématique, et contraint à développer des théorisations, sur le plan médical, psychologique, mais aussi sociologique, pour en rendre compte. Quoi qu’il en soit, la pathologie ne peut être appréhendée en dehors d’un écosystème élargie, car « être sain c’est non seulement être normal dans une situation donnée, mais être aussi normatif, dans cette situation et dans d’autres situations éventuelles » (Canguilhem). Ainsi, il est impossible de définir a priori une norme physiologique ou comportementale, en l’absence de confrontation à un environnement existentiel. Enfin, la catégorisation du pathologique suppose tou-jours, en dernière instance, une représentation plus ou moins consciente de ce qui constitue-rait une vie bonne, en termes d’autonomie, de réalisation de soi, d’émancipation, etc. « Ce qui définit la santé c’est, d’un certain point de vue, la possibilité de se passer des défenses en les dépassant quand elles sont devenues des normes de vie rétrécies » (Yves Clot).
A l’évidence, il semble important de dénoncer les dérives de la médicalisation, dès lors qu’il s’agit d’entretenir des préjugés, voire une forme d’oppression, en déniant certains enjeux sociaux ou politiques. Souvenons-nous qu’en Union Soviétique, les dissidents étaient psychiatrisés…Par ailleurs, la lutte contre les phénomènes de stigmatisation et de marginalisation reste indispensable, avec la nécessité de favoriser la tolérance et l’accueil vis-à-vis des différences, qu’elle qu’en soit la nature. Il faut également rester très vigilant sur les modalités pratiques du soin, sur les modèles sous-jacents et les présupposés implicites. Tel ou tel processus thérapeutique contribue-t-il à déployer l’autonomie, la subjectivation, ou au contraire favorise-t-il une forme de déshumanisation et de dépendance ? Soigne-t-on afin d’émanciper des personnes, ou pour garantir un climat sécuritaire ?
Cependant, au-delà de toutes ces prudences évidentes, il y aurait un danger évident à s’inscrire dans un relativisme absolu, amenant à déconstruire l’idée même de pathologie mentale. Ce type de posture aurait comme conséquence l’abandon pur et simple des individus souffrants de ces troubles, avec un refus tant de la prévention que du soin, c’est-à-dire une véritable non-assistance à personne en danger. Le soin, même lorsqu’il est parfois exercé sous contrainte, suppose la reconnaissance de l’autre dans la plénitude de son humanité. Le soin sollicite l’accueil et la sollicitude, loin des catégories toute faite ; mais aussi la confrontation à la détresse, dans sa tragique nudité. Le soin suppose la responsabilité et l’acceptation d’une obligation à l’égard de nos prochains ; la reconnaissance du commun…
Certes, le modèle néolibéral aurait tout intérêt à démanteler le soin, car il existe une forme d’incompatibilité irréconciliable entre eux. Comment pourrait-on effectivement penser le soin, en appréhendant les individus comme des monades autosuffisantes, n’œuvrant que pour leur propre intérêt ?
En tout cas, si certains doutent de l’existence de la pathologie mentale par principe, je leur conseillerais tout simplement de se rendre compte des réalités du terrain : de recueillir le témoignage de certains malades lorsqu’ils évoquent leur vécu psychotique ; de constater la détresse des angoisses dissociatives du schizophrène, du délire de culpabilité du mélancolique…De passer un moment au CPOA (Centre Psychiatrique d’Orientation et d’Accueil) de l’hôpital St Anne, ou à l’IPPP (Infirmerie de la Préfecture de Police de Paris), ou bien encore sur un hôpital de jour pour autistes sévères… Quand on a éprouvé, et essayé de partager un peu de cette douleur inénarrable, on ne peut plus se complaire de discours hors-sol et condescendant. On se doit de reconnaitre, et de tendre la main, en toute humilité…
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…

« Les Saumons », bulletin de l’association, sort son premier numéro pour 2024

Politis au Forum social local du Morbihan

À tous les aficionados de Politis…









