Aurélien Bellanger est-il « photogénique » ? Entretien
L’auteur de la Théorie de l’information livre ici quelques réflexions d’ordre littéraire et politique. À discuter.
dans l’hebdo N° 1223 Acheter ce numéro

C’est « l’événement de la rentrée littéraire » pour une bonne partie de la presse. Tandis que certains journalistes, participant du même phénomène médiatique, mais a contrario, l’ont qualifié de pensum ou de fatras. En ce qui nous concerne, nous avons vu dans la Théorie de l’information (Gallimard), d’Aurélien Bellanger, un premier roman qui a le mérite de raconter pour la première fois les quarante premières années de l’ère numérique en France mais qui esthétiquement comme politiquement, les deux dimensions se recoupant, laisse sceptique (voir Politis n° 1217 du 6 septembre). En particulier, son sujet, d’une extrême contemporanéité, et sa forme, une narration linéaire strictement feuilletonnesque – comme si la littérature, elle, n’avait pas d’histoire – sont dans une contradiction qui tend à dévitaliser la force potentielle du livre.
Nous aurions pu en rester là. Mais il nous a été donné d’interroger Aurélien Bellanger sur les points problématiques que soulève à nos yeux son roman, et cela sans détour. L’occasion était bonne, finalement, de l’amener à prendre position sur des questions qui concernent à la fois la Théorie de l’information et plus largement l’horizon littéraire dans lequel il se situe, lui qui a écrit un essai chaleureux sur l’auteur de la Possibilité d’une île : Houellebecq écrivain romantique (Léo Scheer, 2010).
Les réponses d’Aurélien Bellanger, franches et claires, ont le goût de la provocation, même si telle n’est pas l’intention de l’auteur. En même temps, on mesure aussi à quel point elles épousent une certaine pensée « antimoderne » qui déclare caduques, et même dangereuses, les grandes explorations littéraires de la seconde moitié du XXe siècle. « Beckett, s’il n’avait pas été photogénique, il n’en resterait pas grand-chose. La preuve : il ne reste rien de Sarraute », déclare sans complexe Aurélien Bellanger, condamnant sans nuances le Nouveau Roman (taxé de « formalisme » ) comme l’ont fait avant lui tous les représentants de la droite littéraire à la suite des Hussards (Nimier, Jacques Laurent…), tels Éric Neuhoff et Patrick Besson, ou d’innombrables idéologues réactionnaires, comme Philippe Muray, ou encore, sans surprise, Michel Houellebecq.
Sa réponse à la troisième question certes prosaïque, au-delà de la référence à Léo Strauss qu’elle contient, et que ne renierait pas, en l’occurrence, un Finkielkraut (cf. la Défaite de la pensée ), semble pour le moins fuyante, et renvoie dans les limbes – si l’on ose dire – l’opposition gauche/droite en des termes là encore politiquement connotés : « les conservateurs-écologistes conserveront la Terre » … Bref, on aura compris qu’à nos yeux, cet entretien a avant tout l’intérêt de situer des lignes de débat. Et de révéler les soubassements théoriques, même s’ils ne peuvent ici qu’être esquissés, d’un roman qui fait cet automne la une des médias.
Pensez-vous que la Théorie de l’information est conforme au « roman balzacien » que vous avez revendiqué à son propos ?
Aurélien Bellanger : J’ai eu l’idée soudaine, effectivement, d’écrire un roman balzacien : à spectre large, avec une charpente forte et un personnage central dans une position d’ascension sociale. Cela m’a porté, les premiers mois, pour abattre le sale boulot : je pensais, assez naïvement, que l’écriture d’un roman s’apparentait à une longue stase esthétique qui excluait largement le travail. Il y avait le style et il me fallait le rejoindre, vivre cette sorte de grâce surhumaine, cet état de conscience modifiée, supérieure, un état où tout serait facile et où toutes mes années de paresse et d’errances seraient enfin justifiées : elles m’auraient nourri, comme le temps perdu avait avant moi nourri Proust.
Balzac était donc le parfait antidote à cette rêverie antidatée. Je devais me documenter, organiser mes recherches, raconter des choses qui a priori ne ressortaient pas du domaine poétique ou romanesque : l’histoire industrielle, la vie des objets, tout ce qui tenait de la prose au sens large. Or, très rapidement, j’y ai pris goût. C’était délicieux de cesser de me demander si j’avais un style, pour découvrir que j’avais simplement des choses à raconter, et que j’avais certaines facultés à les raconter de façon intéressante. J’ai essayé d’être élégant, de privilégier les structures grammaticales classiques et compréhensibles. Je ne jouais pas du tout à l’écrivain, je travaillais simplement à écrire du mieux que je pouvais. Et le meilleur, c’est que cet état de conscience modifiée dont j’avais si longtemps rêvé sans l’obtenir jamais, je l’obtenais parfois. Le travail m’obligeait à me concentrer, et j’avais soudain une vision panoramique de ce que je faisais. Balzac, après tout, c’est le nom français de « romancier sérieux ». Flaubert ou Proust, il y a déjà une dimension quasi-mystique de l’écriture.
En quoi les débats sur la forme romanesque qui ont traversé le XXe siècle en France, avec notamment le Nouveau Roman, vous concernent-ils ?
Combien de fois ai-je entendu dire d’un livre : c’est bien, mais ce n’est pas très novateur dans la forme. Ah bon, car la littérature a un devoir de progrès ? Que la société en ait un, pourquoi pas, et qu’il en découle que la littérature doive s’adapter à ces changements lents et profonds des goûts de son lectorat, pourquoi pas ? Mais le reste de cette – paradoxalement vieillotte – injonction moderniste, quel enfer ! Je pense que la crise dont le Nouveau Roman s’est voulu l’écho a terriblement vieilli. L’ère du soupçon, la fin du personnage, Jean Ricardou : le monde n’a pas retenu ces débats. Ils sont oubliés aujourd’hui. Le formalisme est à peu près mort. Ouf. J’ai pas mal lu, jeune adulte, ces livres qui correspondent chez moi à un épisode dépressif léger. Les Répertoires de Butor, notamment les pages sur Balzac, m’ont enchanté. Il y a parfois des trucs pas mal chez Robbe-Grillet, dans le genre pénible et appliqué. Claude Simon, je ne comprends pas comment, encore aujourd’hui, on peut s’infliger ça. Beckett, s’il n’avait pas été photogénique, il n’en resterait pas grand-chose. La preuve : il ne reste rien de Sarraute. Duras, on mesure encore mal les dégâts qu’elle a pu faire sur deux, voire trois générations d’écrivains : je ne suis pas conséquentialiste, mais on peut quand même lui en vouloir un peu. Quand on pense que quelqu’un d’aussi sensible et intelligent que Gracq a pu faire tenir la quasi-totalité de son œuvre critique sur un débat de préséance impliquant trois noms : Balzac, Stendhal, Flaubert, on réalise que la littérature du XXe siècle risque de ne pas être à la hauteur. Sartre ou Camus ?
À propos de la dimension politique de votre livre, vous soulignez la lourdeur du monopole de France Télécom dans la première partie (jusqu’aux années 1980), mais ensuite vous n’évoquez pas les monopoles actuels, de nature privée, même si, au détour d’une phrase, vous écrivez « Internet était désormais monétisable dans les deux sens, et privatisable », ce qui est une remarque juste mais courte. Pourquoi avoir dépolitisé la seconde partie de votre roman ?
La question serait plutôt celle de l’universalité de la politique. À partir du moment où le thème du roman devient, d’une certaine façon, la sécession d’un homme, les questions politiques sont-elles oblitérées ? C’est un peu, à gros traits, l’idée des modernes relisant les classiques : intéressant, mais inadapté à notre esprit de modernes. Il existe une autre école, incarnée de façon magistrale par Léo Strauss, selon laquelle les questions classiques demeurent universelles. Cela dit, la politique ne disparaît pas : on peut penser que le thème de la singularité technologique est une question politique. Cet événement étant même d’ordre religieux, il semble qu’il faille, pour en mesurer l’ampleur, rouvrir le vieux débat théologico-politique. La guerre des hommes contre les machines est une question politique. Ou bien on peut fonder une nouvelle discipline, sur le modèle de polis qui donne politique. Il y a déjà la cybernétique. Il pourra y avoir la cosmotique : l’idée d’un gouvernement de l’univers, qu’on trouve par exemple chez l’auteur de SF Stapledon. Pour certains intellectuels, je pense au physicien Freeman Dyson, la frontière gauche/droite est désormais, ou pour bientôt, une frontière « cosmique » : les conservateurs-écologistes conserveront la Terre, les techno-utopistes, persécutés, s’enfuiront dans l’espace. Au passage, il fait remarquer que le courage de ces derniers ne serait que peu de chose par rapport à celui des migrants du Mayflower.
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…

« Les Voleurs d’ampoules », une traversée initiatique

« La Ville » : qui sont vraiment les zombies ?
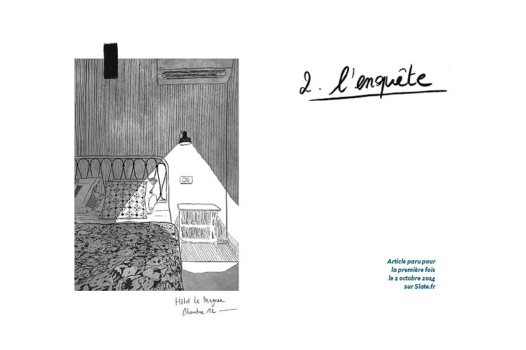
« Écrire Mazan » : avec Gisèle Pelicot, sortir de la sidération








