Lacouture et les erreurs
Jean Lacouture est décédé le 16 juillet à l’âge de 94 ans.
dans l’hebdo N° 1363-1365 Acheter ce numéro
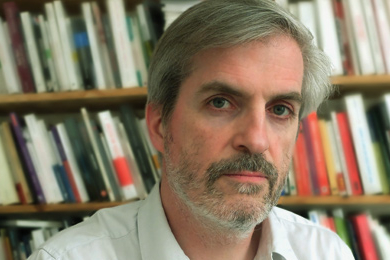
C’est à juste titre que Jean Lacouture, décédé le 16 juillet à l’âge de 94 ans, a été généreusement salué dans les médias. Jean Lacouture, doté d’une plume virtuose, curieux du monde et passionné par son métier, dont la carrière symbolise une période faste pour la presse, peut passer pour un modèle dans la profession. On a souligné l’un de ses traits de caractère, qui n’était pas la moindre de ses qualités. Son anticolonialisme a pu l’aveugler par instants (sur les Khmers rouges, par exemple) ou l’amener à taire certains aspects négatifs (comme les dissensions au sein du FLN). Mais, toujours, il a reconnu a posteriori ses erreurs, des « fautes professionnelles », disait-il, faisant montre de son honnêteté intellectuelle. Imagine-t-on Christophe Barbier ou Franz-Olivier Giesbert battre un jour leur coulpe pour avoir multiplié les unes sur « les dangers de l’islam » ? Cependant, un fait intrigue, exposé dans la nécrologie du journaliste publiée par le Monde (19 juillet), sous la plume de Luc Cédelle. Celui-ci affirme que Jean Lacouture n’a jamais écrit la thèse qu’il projetait, objet d’un séjour à Harvard en 1966. Jean Lacouture, qui l’a pourtant revendiquée, en aurait-il, comme d’autres, seulement imaginé l’existence ? Et pourquoi n’a-t-il pas avoué par la suite cette « invention » ? Parce que la thèse existe bel et bien. Soutenue devant un jury de marque – Jacques Berque, Georges Balandier, Maurice Duverger –, cette thèse de sociologie, qui propose une typologie des leaders du tiers-monde, a donné lieu en 1969 à une publication : Quatre hommes et leur peuple. Sur-pouvoir et sous-développement. Ce travail universitaire n’était sans doute pas éloigné de la conception que Jean Lacouture se faisait de son métier et des livres qu’il publiait, en particulier dans sa collection, au Seuil, « L’Histoire immédiate » : il y fallait du sérieux. D’où son aversion pour ses erreurs.
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…

Librairie Violette and Co : l’État et l’extrême droite ensemble contre les librairies soutiens à la Palestine

« Trop tard », l’extrême droite à la sauce Popeye

« Chimère », identités contrariées








