« Sigma », de Julia Deck : L’art du renseignement
Dans Sigma, Julia Deck raconte une histoire d’espionnage autour d’une œuvre invisible.
dans l’hebdo N° 1474 Acheter ce numéro

Une citation de John Le Carré en exergue : voilà qui augure d’une histoire d’espionnage. Et en effet, le troisième roman de Julia Deck en raconte une, avec des personnages « cibles » qui sont surveillés par des « agents », eux-mêmes employés par une organisation internationale, dont le nom donne le titre au livre : Sigma.
Singularité : on apprend dès la première page que Sigma se préoccupe de la réception des œuvres d’art. Il est ainsi question « qu’une œuvre disparue du peintre Konrad Kessler referait surface aux alentours de Genève ». Or, ce message, issu de Sigma en Suisse et à destination de la direction centrale, ajoute : « Depuis la fin du siècle dernier, notre organisation tente de contenir l’influence de cet artiste subversif. » Objectif original, mais bien dans l’air du temps où les œuvres doivent être sympas, réduites à l’état de « produits culturels ».
Ce qui fixe aussi l’ambition de ce roman : ne pas lui-même tomber dans ce travers. Cependant, bien que fort plaisant, pétri d’un humour placide et constant, Sigma n’a rien d’un simple divertissement. D’abord parce que Julia Deck, qui a déjà signé les excellents Viviane Elisabeth Fauville et Le Triangle d’hiver (chez Minuit, en 2012 et en 2014), prend l’art romanesque au sérieux, en reconsidère les possibilités, joue avec sa complexité. Elle compose un roman de groupe, avec quatre personnages principaux : Zante, un collectionneur d’art ; Elvire Elstir, une galeriste ; Lothaire, son mari, un universitaire aux thèses audacieuses sur le plaisir féminin ; et Pola, la sœur d’Elvire, comédienne de renom. Chacun est affublé d’un assistant. Tous agents de Sigma, les assistants sont à tour de rôle les narrateurs : leurs récits sont les rapports qu’ils transmettent à l’organisation. Foin du narrateur omniscient, donc, mais au contraire, subjectivité et variation des points de vue.
Tout en restant dans le champ du réalisme, l’auteure joue aussi avec les genres. Outre les comptes rendus des agents, le livre comporte d’autres types d’écrits, comme une communication scientifique ou un article de journal. Surtout, le théâtre est très présent. Qu’un personnage se nomme Elvire ou qu’une actrice joue un rôle important en sont des indices. Pola répète Marie Stuart, le drame de Schiller. Julia Deck la décrit toujours à la frontière de la représentation : « Pola Stalker est belle sous tous les angles, que ses traits s’animent ou qu’on la surprenne inopinément fixe, absorbée par la lecture de la presse. » Qui plus est, un des chapitres se présente comme une pièce, avec force didascalies. Enfin, l’esprit du théâtre traverse tout le roman, aussi bien dans ses dialogues que dans l’inversion du rapport dominants-dominés (ou cibles-assistants).
Sigma a également une autre dimension, qui s’appuie sur ce qui occupe tous ces personnages : l’existence d’un tableau de Konrad Kessler (peintre inventé par l’auteure), « un mural spectaculaire », que nul n’a jamais vu, sinon Jean Dubuffet, qui en aurait été très impressionné. Cette peinture, « absolue », représenterait « l’infinie profondeur ». D’où sa charge subversive. Le regard serait ainsi révolutionné par une œuvre invisible : là est l’éminent paradoxe dont joue Sigma, roman vertigineux.
Sigma, Julia Deck, Les éditions de Minuit, 240 p., 17,50 euros.
Pour aller plus loin…

« Les Voleurs d’ampoules », une traversée initiatique

« La Ville » : qui sont vraiment les zombies ?
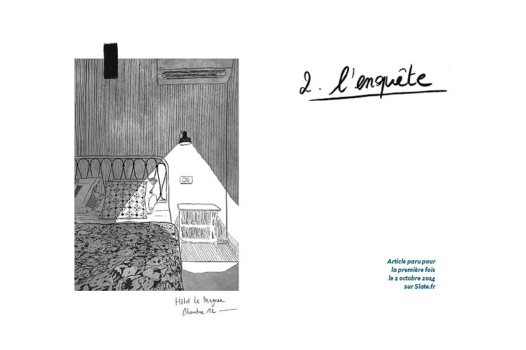
« Écrire Mazan » : avec Gisèle Pelicot, sortir de la sidération







