Goodbye, Philip Roth
L’écrivain Bertrand Leclair rend hommage au grand romancier américain disparu le 22 mai, en revenant sur ses œuvres d’avant la consécration.
dans l’hebdo N° 1505 Acheter ce numéro

La mort qui aura hanté l’œuvre de Philip Roth l’a donc emporté et les sortilèges du grand jeu romanesque qu’il a su mener à son paroxysme n’y auront rien changé. On peine à le croire aussi vulgairement vaincu ; il est vrai qu’on ne croyait déjà qu’à demi l’annonce publique, en 2012, d’une petite mort : sa décision d’arrêter d’écrire. Comment imaginer sérieusement Philip Roth prendre le risque de respirer sans écrire, quand les deux n’avaient jamais fait qu’un ?
Si l’on s’en souvient, pourtant, du Théâtre de Sabbath ! Le plus enragé des romans de Roth, ou l’épopée délirante et maniaque d’un enfant de la guerre du Vietnam, ou plutôt de son refoulement. Ancien marionnettiste condamné au silence par l’arthrose, Sabbath erre à travers l’Amérique amnésique, volontiers obscène, « hanté par la chair » comme « toute personne hantée par la mort ». Et il était si difficile de l’abandonner à son théâtre de misère et de cruauté que c’était à se retrouver courant dans la rue bêtement encombré d’un parapluie un jour de grand beau temps – tant il pleuvait dans le livre, un vrai déluge…
Cette puissance d’emportement est le fruit d’un jeu dionysiaque que Roth a rendu plus vertigineux de livre en livre. Pour ce « fétichiste du verbe », il s’agissait de se laisser prendre au jeu, lui le premier : afin de mieux lâcher la bride à l’écriture, et tant pis si ses doubles de fiction n’en sortaient pas indemnes. Dans le merveilleux Opération Shylock, paru en 1993, le « vrai » Philip Roth débarquait à Jérusalem après avoir appris qu’un sosie usurpant l’identité de « Philip Roth » y prônait à longueur de conférences le retour des Juifs en Europe ou la création des Antisémites anonymes. Leur confrontation physique est un moment si grandiose que le lecteur bascule avec eux dans la confusion, ne sachant plus où est le vrai et où le faux, à Jérusalem…
Plutôt que les derniers romans, qui tous ont été des best-sellers, mieux vaut citer ici ceux qui ont marqué le chemin menant de Goodbye, Columbus (1962) à ces chefs-d’œuvre du tournant du millénaire, à commencer par la trilogie de Zuckerman enchaîné : Nathan Zuckerman y subissait l’opprobre du monde juif pour avoir écrit un roman aussi libidinal que Portnoy et son complexe, qui dans la vraie vie avait valu à Roth, en 1969, son premier vrai succès, mais de scandale.
On s’en voudrait cependant d’omettre Tromperie (1990), dans lequel un certain « Philip » dialogue d’abord avec sa jeune maîtresse sur un mode sarcastique, puis avec sa femme venant de découvrir dans les carnets de son époux ces dialogues délicieusement adultérins. « Philip » prétend la rassurer en affirmant que tout cela n’est qu’invention, matériau des fictions à venir : avec tant de conviction que le lecteur peut y croire. Sinon qu’au chapitre suivant la jeune maîtresse revient converser sans rien ignorer de ce qui précède… À chaque lecteur de choisir son camp entre fiction et réalité – ou d’accepter qu’il n’y a entre elles aucune ligne de démarcation qui vaille, en vérité.
Au détour d’un dialogue du même Tromperie, on pouvait lire à propos de Kafka qu’il a « renoncé à traduire l’expérience en fiction – il impose sa fiction à l’expérience. » C’est exactement la tournure qu’ont prise les grands romans tragicomiques de Philip Roth. Qui n’aurait sans doute jamais dû renoncer à écrire, à « imposer sa fiction à l’expérience » : son ennemi personnel le plus intime n’aura pas tardé à en profiter pour solder les comptes.
Dernier titre paru de Bertrand Leclair : Perdre la tête, Mercure de France, 2017
Pour aller plus loin…

« Les Voleurs d’ampoules », une traversée initiatique

« La Ville » : qui sont vraiment les zombies ?
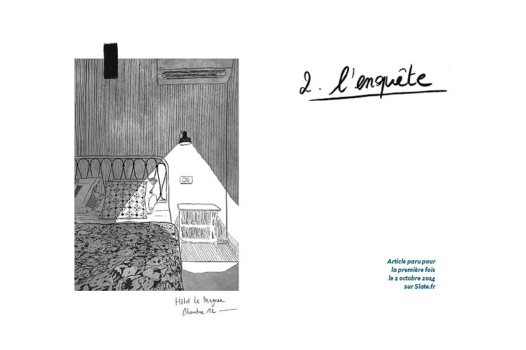
« Écrire Mazan » : avec Gisèle Pelicot, sortir de la sidération







