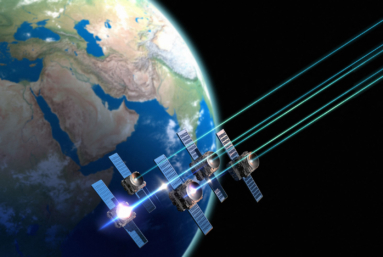« Nouvelle vague », de Richard Linklater (Compétition)
Soixante-cinq ans plus tard, le cinéaste américain imagine le making-of d’À bout de souffle

Nouvelle vague/Richard Linklater/1h45
Sortie : 8 octobre
Raconter la genèse et le tournage d’À bout de souffle, le premier long métrage réalisé par Jean-Luc Godard en 1960 : sur le papier, le projet de Richard Linklater pouvait laisser songeur. Non par le biais du documentaire mais celui de la fiction avec des acteurs dans les rôles du cinéaste, de ses amis, de son équipe… Comment faire du vivant avec une telle œuvre du patrimoine ? Comment ne pas tomber dans le syndrome musée Grévin ?
En évitant le film d’époque mais en le réalisant au présent, dit le cinéaste dans le dossier de presse. En se départissant aussi du poids de la réputation, de la légende et du « génie », toutes considérations qui font obstacle à ce que le film souhaite atteindre : montrer la réalité des premiers pas d’un acte créateur résolument anticonformiste.
Pour qui connaît les protagonistes et l’histoire de la Nouvelle vague, il faut quelques minutes pour s’acclimater à voir Godard, Truffaut, Belmondo, Jean Seberg et les autres sous les traits de comédiens. Mais la convention est vite acceptée car Linklater a eu la bonne idée de ne recruter que des acteurs inconnus (tous excellents), ayant une certaine ressemblance sans pousser le mimétisme jusqu’à la caricature, ce qui permet plus facilement l’identification à leur modèle. Pour aider le spectateur dénué de point de repère, chaque nouveau personnage est présenté avec son nom, premier indice sur les intentions du cinéaste à ne pas réaliser un film pour happy few.
Les débuts de Godard et le tournage d’À bout de souffle sont très documentés. Richard Linklater a puisé dans les livres, les biographies, les critiques du futur cinéaste, ses interviews pour élaborer son scénario et nourrir les dialogues. Il lui revenait avant tout de déterminer quel type de regard il voulait poser sur lui. Il montre tout d’abord un Godard (Guillaume Marbeck) anxieux. Celui-ci assiste à Cannes au sacre de Truffaut avec les 400 coups, tandis que ses autres amis critiques, Chabrol, Rivette, Rohmer, ont déjà fait leur premier long métrage. Pas lui. Le film saisit très bien la peur qui peut hanter tout débutant quand il s’agit de se lancer et donc de s’exposer. Y compris Godard. Cependant, dès qu’il a le feu vert de Georges Beauregard (Bruno Dreyfürsft), qui sera l’un des grands producteurs de la Nouvelle Vague, il est porté par de solides convictions, moins sur ce qu’il doit faire que sur ce qu’il ne doit pas faire. En particulier : refuser toutes les conventions, toutes les habitudes dans la façon de réaliser.
Et ce, dès la constitution de son équipe – Pierre Rissient (Benjamin Cléry) comme assistant réalisateur, novice en la matière, ou Raoul Coutard (Matthieu Penchinat) pour chef opérateur, dont l’activité première était d’être caméraman de guerre – et le choix de ses comédiens – Belmondo (Aubry Dullin), qu’il avait déjà engagé sur un court honorant ainsi sa promesse de le prendre sur son premier long, et Jean Seberg (Zoey Deutch) débarquant d’Hollywood.
La liberté est le maître mot de Godard. Liberté des mouvements de caméra (d’où le recours à tous les systèmes D allégeant la machinerie), liberté par rapport à l’argent, au temps de travail, au jeu des acteurs. Tous ses efforts vont dans ce sens : ne pas se préoccuper de ce qu’on a fait avant lui, suivre son idée, faire la chasse aux clichés, décorseter le cinéma, y faire entrer le souffle de l’inédit.
Ce qui sur le tournage ne va sans incompréhension, en particulier avec la plus étrangère à ces pratiques incongrues : Jean Seberg. La comédienne ne comprend pas ce à quoi elle participe, et n’a pas sa langue dans sa poche pour signifier à Godard ses désaccords. Elle lui offre malgré tout une composition formidable et une conclusion à À bout de souffle qui le laisse, précisément, sans voix. Le producteur et le cinéaste en viennent aussi aux mains : Beauregard est excédé de le voir suspendre le tournage sous prétexte qu’il n’aurait pas l’inspiration.
Godard est imprévisible, parfois désagréable, toujours désappointant. Mais il règne aussi sur le plateau une ambiance de camaraderie. Tout un chacun a accepté de participer à un tournage hors norme, « sauvage » comme le qualifie Coutard, où l’on ne s’ennuie guère, tout en doutant du résultat : le film sera-t-il même montrable ?
S’il y a une part d’hommage dans le geste de Linklater, son film ne reprend en rien la manière godardienne – c’est heureux –même s’il est en noir et blanc. Il n’est pas non plus dénué d’humour. Mais quand on rit de Godard, ce n’est pas à la manière désagréable et anti-intellectuelle du Redoutable, de Michel Hazanavicius (qui était en compétition à Cannes en 2017). Richard Linklater éprouve de la tendresse envers celui qui l’a convaincu, grâce à ses films et à À bout de souffle en particulier, que faire du cinéma était possible. Il sait en outre, lui qui alterne films à grosse production et œuvres personnelles, que la recherche de sa propre voix dans le concert de la doxa a par nature quelque chose de décalé, donc de burlesque. Et aussi de tragique, quand le sentiment de solitude est au rendez-vous – ce sera le cas chez Godard, plus tard.
Objectif atteint, donc, pour Nouvelle vague : le film n’a rien d’un acte de dévotion au culte de l’auteur ou d’un tombeau solennel. C’est un corps qui respire, donnant à apercevoir les arcanes d’une révolution esthétique et à toucher du doigt la part d’inconnu et d’opacité qu’elle implique. Outre procurer du plaisir au cinéphile, Richard Linklater a aussi voulu faire de son film un geste de transmission. Les cartons de la fin y contribuent, donnant des informations sur le devenir d’À bout de souffle et de ses protagonistes. Nouvelle vague s’offre ainsi à tous les publics, aux débats contemporains comme aux rêveries mélancoliques.
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…

« Le Rire et le couteau », de Pedro Pinho (UCR) ; « La Petite Dernière », d’Hafsia Herzi (Compétition)

« Promis le ciel », d’Erige Sehiri (UCR) ; « Dossier 137 », de Dominique Moll (Compétition)

« Put Your Soul on Your Arm and Walk », de Sepideh Farsi (Acid)