Dans l’enfer du travail précaire
Le journaliste Thomas Morel s’est infiltré pendant deux ans dans cinq entreprises. Il en a tiré des reportages saisissants sur la vie quotidienne de millions de salariés.
dans l’hebdo N° 1471 Acheter ce numéro

L’usine, beaucoup l’imaginent. Peu la connaissent. » Faire ressentir – un peu – la réalité du travail le plus dur et le plus précaire, c’est ce que parvient à faire Thomas Morel, journaliste infiltré pendant deux ans dans cinq entreprises des Hauts-de-France. Il a tour à tour « disposé en cadence des chocolats industriels dans leurs boîtes alvéolées, répondu en boucle à des clients invisibles, tenté de vendre des contrats de gaz et d’électricité au porte-à-porte, réclamé de l’argent à des débiteurs pris à la gorge, et monté et vissé des trains arrière de voiture ».
En relatant ces expériences, l’auteur rend palpable la douleur physique et psychologique causée par les cadences, l’inanité du travail ou la grande précarité. Comme une boucle, le livre débute et se termine sur un vestige du « vieux monde », le travail à la chaîne, dans une usine de chocolats Cémoi puis chez Toyota, inventeur d’une organisation du travail ultraparcellisée et standardisée. Dans cet univers digne des Temps modernes de Chaplin, le temps avance au ralenti au cours de créneaux où les vies sont « plongées en apnée huit heures durant ».
On découvre comment les objectifs de production et la pénibilité détruisent à petit feu le corps des ouvriers, tel Didier, à la retraite, « qui boite et se déhanche comme si ses articulations étaient de guimauve ». Pour supporter ce lent supplice, bien des travailleurs consomment du cannabis ou de l’alcool, au détriment de leur sécurité. Pourtant, chez Cémoi, on est prévenu dès l’arrivée : « Faites attention aux accidents de travail, ils coûtent cher à l’entreprise. »
Les autres séquences sortent de l’univers industriel pour nous plonger dans des emplois du tertiaire, qui ne sont pas moins terrifiants. Devenu « smicard 2.0 » dans le centre d’appels Clictel, où il répond à des clients des magasins Boulanger, Thomas Morel décrit un « Google du pauvre » à la salle de repos triste et dépeuplée, mais où la « culture de la surveillance » règne. Il évoque aussi l’abyssal sentiment d’inutilité que lui inspire ce « job à la con [1] ». De quoi ne pas regretter son non-renouvellement, qui lui est signifié moins de quatre heures avant le terme de son contrat, tout comme chez Toyota, où le salarié précaire a eu l’audace de faire grève.
C’est néanmoins dans une filiale de Cofidis – spécialisée dans le recouvrement de dettes de crédits à la consommation – que le journaliste infiltré a le plus souffert. Dans ce « nid de vautours », il comprend vite qu’il va devoir « repousser tout sentiment » face à ces foyers dépassés par le surendettement dans lequel ils se sont enlisés. La doxa maison : « La banque a toujours raison, et les mauvais payeurs toujours tort. » Ravaler ses états d’âme pour faire jaillir le profit à tout prix : la morale de l’économie moderne ?
[1] En version originale, un de ces « bullshit jobs » dont parle l’anthropologue américain David Graeber.
Les Enchaînés, Les Arènes, 270 p., 20 euros.
Pour aller plus loin…

« Fanon nous engage à l’action »
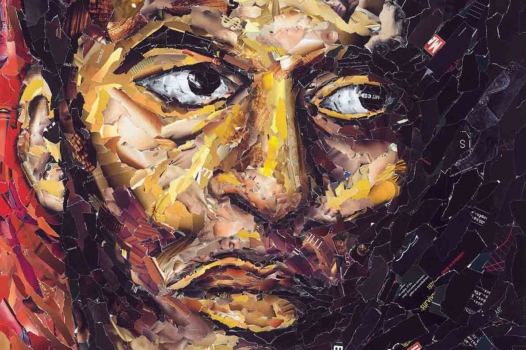
Frantz Fanon, un éclairage disputé sur l’héritage colonial

Fanny Gollier-Briant : « Il faut absolument repolitiser la souffrance des jeunes »







