ESS : dépasser la propriété
En s’appuyant sur un secteur financier socialisé, l’ESS pourrait se débarrasser de la notion de capital et définir un « commun productif ».
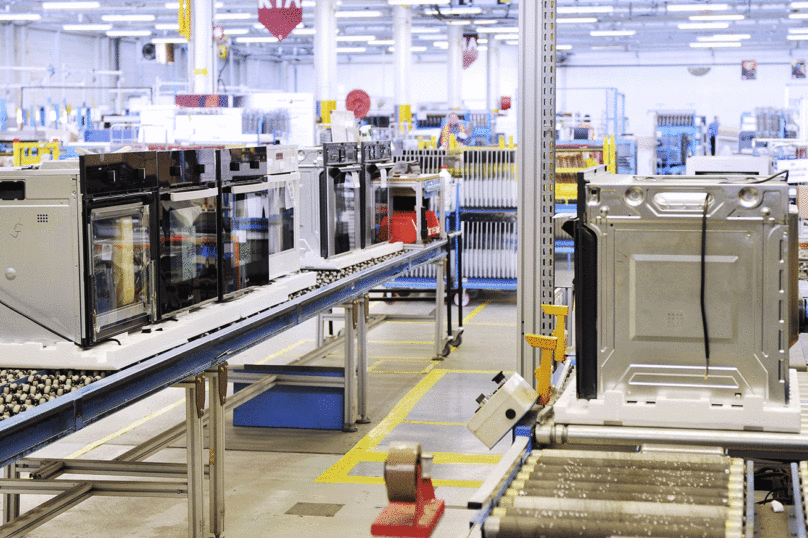
L’ESS développe des pratiques alternatives à celles de l’économie dominante. La rupture majeure qu’introduit l’ESS est le renversement du lien entre objet social – ce que va produire l’entreprise – et capital. Dans une société classique, on réunit un capital dans l’objectif de le faire fructifier, et l’objet social est au service du capital. Dans les coopératives, l’objet social est premier : on se réunit pour produire ensemble quelque chose ou pour obtenir un service, et le capital est au service de cet objet social. Ce caractère second du capital explique les modes de décision sur le principe « une personne = une voix » et la rémunération limitée des apports en cas d’excédents, qui aboutit à la formation de réserves impartageables. Pour autant, l’expérience nous apprend que, même second, le capital est toujours présent et tend à réimposer sa logique.
La propriété coopérative apparaît comme « privée » à l’égard de celles et ceux qui ne sont pas membres de la structure. De ce point de vue, la coopérative – et tout particulièrement celle de travail, dont les membres sont les salariés – reste dans une relation de concurrence avec les autres entreprises. On a pensé pendant de nombreuses années que la coopérative d’usagers (de consommateurs ou bancaire) répondait à cette objection en constituant, par la présence de ses membres, un marché préétabli. L’histoire nous a montré que l’adhésion d’usagers à la coopérative a une implication limitée vis-à-vis d’une concurrence privée capable, par la mobilisation de capitaux importants, de proposer des prix encore plus bas que ceux des coopératives : en France, la grande distribution a réussi à éliminer en quelques années les principales structures de la Fédération nationale des coopératives de consommateurs (FNCC). De plus, dans ces coopératives d’usagers, les travailleurs se retrouvent dotés d’un statut de salariés subordonnés proche de celui des entreprises capitalistes.
Enfin, même second, le capital demeure la propriété des membres de la coopérative, qui ne souhaitent évidemment pas perdre leur apport ou le partager de façon massive. Une illustration parmi d’autres de ce phénomène est l’internationalisation du groupe coopératif Mondragón au Pays basque. Il s’agit d’une expérience remarquable : fondé dans les années 1950 en résistance au franquisme, il s’est développé au point de regrouper plus de 70 000 travailleurs dans une centaine de coopératives de travail, lesquelles ont constitué des coopératives de second niveau (c’est-à-dire dont les membres sont des coopératives) pour s’organiser en groupe, de façon à s’orienter économiquement, mutualiser des ressources et assurer aux sociétaires une véritable sécurité sociale professionnelle. Pourtant, au moment où le groupe a dû s’internationaliser, les coopératives ont réalisé des achats d’entreprises à l’étranger et, chose surprenante, les salariés des sociétés rachetées ne se sont pas vus proposer d’intégrer le sociétariat. Le statut de filiale – expression profonde d’un rapport de propriété antagonique à la coopérative gérée par ses membres – est apparu dans le groupe : les fonds propres des coopératives (qui intègrent le capital social et les réserves impartageables) étaient devenus trop importants pour qu’ils soient partagés, et les travailleurs sociétaires de ces coopératives sont devenus les patrons de salariés travaillant dans les filiales.
Toutes les limites que nous venons de pointer quant à la propriété coopérative nécessitent de combiner l’acquis démocratique de la coopérative avec un dépassement de la propriété. Cela signifie que la notion même de capital disparaisse. Toute entreprise finance ses actifs (ce qu’elle possède) de deux façons : les emprunts et les fonds propres. Les fonds propres sont constitués par le capital initial – qui génère le rapport de propriété, y compris dans la coopérative – et les bénéfices laissés dans l’entreprise. L’avantage de l’emprunt est qu’il ne crée aucun lien de propriété : le créancier sera remboursé avec des intérêts à des échéances convenues mais n’a aucun droit de regard sur l’entreprise. C’est donc en permettant un financement intégral des actifs de l’entreprise par emprunt que l’on fera disparaître la notion de fonds propres, de capital et donc de propriétaires.
Dès lors, qui va diriger l’entreprise ? La pratique du commun nous donne la réponse : ce sont les usagers de la ressource qui sont les mieux à même de le faire, à savoir les travailleurs de l’entreprise. Par ailleurs, un droit de mobilisation et de représentation doit être reconnu à celles et ceux, clients et usagers, qui utilisent les services de l’entreprise. Ce droit de mobilisation débouche sur la nomination d’un conseil d’orientation qui devra rechercher des consensus avec le conseil des salariés de la structure sur les questions de nature et de qualité des produits ainsi que de modalités de distribution.
Nous venons de définir ici le commun productif. Comme il est impossible et non souhaitable que le financement intégral des actifs de l’entreprise se fasse auprès d’agents privés, un secteur financier socialisé doit donc être conçu pour être en capacité de financer la totalité des actifs des entreprises. Ce secteur financier socialisé – et non étatique – est constitué de deux entités distinctes : un fonds socialisé d’investissement (FSI) et des banques autogérées, qui sont des communs productifs au sens où nous venons de le déterminer. Si ces banques accordent des crédits par création bancaire classique, elles pourront dorénavant sécuriser ceux-ci par des crédits accordés par le FSI, ce qui permettra de se débarrasser définitivement des marchés financiers.
Ce FSI constitue un commun dans lequel les citoyens pourront débattre de l’orientation des investissements selon des thématiques (conversion écologique, réindustrialisation, mobilité…) ou des modalités d’intervention (recherche et développement, investissements matériels…) déterminées, ce qui constitue une rupture fondamentale avec le capitalisme, où les investissements ne sont décidés qu’en fonction de leur rentabilité.
Si l’ESS constitue une rupture avec le capitalisme, il n’en reste pas moins que cette rupture est partielle, car conditionnée par le maintien de la propriété productive. La disparition de celle-ci n’a été possible que grâce à une articulation de communs. D’autres communs de mutualisation de revenus destinés à les sécuriser devront être aussi constitués. Cela suppose une intervention politique au niveau législatif pour initier la constitution du FSI en collectant les fonds initiaux par un régime de cotisations obligatoires sur les entreprises existantes. L’ESS ne peut en faire l’économie.
Benoît Borrits est chercheur et essayiste.
Pour aller plus loin…

Conclave : comment le Medef a planté les négociations

« La mobilisation pour les retraites n’a pas bouleversé la donne syndicale »

Super-Zucman, l’économiste qui veut rétablir la justice fiscale







