Ken Loach : « Arrêter d’acheter sur Amazon ne sera pas suffisant »
Avec _Sorry We Missed You_, Ken Loach porte son regard sur les travailleurs pauvres ubérisés. Il aborde ici ce problème, mais aussi la question climatique, le Brexit, son travail avec les acteurs et son plaisir à regarder certains matchs de football.
dans l’hebdo N° 1573 Acheter ce numéro
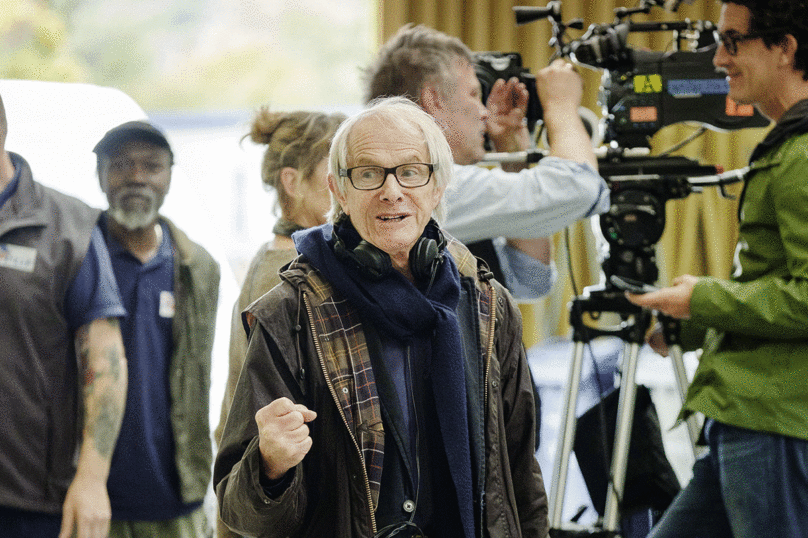
Ken Loach arrive face à son intervieweur détendu, souriant, avec cet air humble et malicieux de celui qui persiste à en remontrer à ceux qui organisent un monde toujours plus barbare. Né en 1936, le cinéaste britannique a déclaré vouloir ne plus tourner alors qu’il revient en très grande forme avec Sorry We Missed You. Son regard sur ses personnages, en l’occurrence une famille de Newcastle prise dans la tourmente du travail précaire, est inimitable. Rencontre avec un grand monsieur.
Ce film a pour objet l’ubérisation du travail. C’est-à-dire une activité toujours plus individualisée, qui annihile toute solidarité entre les travailleurs. Après Moi, Daniel Blake, Sorry We Missed You n’a rien d’un film d’encouragement des classes populaires, comme vous souhaitiez en faire il fut un temps. Qu’avez-vous voulu susciter ?
Ken Loach : Si j’en juge par les premières réactions du public, ce film suscite de la colère. Je crois que la colère est nécessaire pour commencer à s’opposer à ce qui se passe. C’est la base d’une réponse plus articulée, plus organisée. À vrai dire, les sentiments des spectateurs sont mêlés : il y a de la colère, de la tristesse et une aspiration à réclamer la sécurité du travail et la fin de l’exploitation, une aspiration à retrouver une dignité.
Par ailleurs, aujourd’hui, il existe des revendications économiques et sociales avec lesquelles le film est en lien qui sont défendues par des syndicats ou des partis, comme le Parti travailliste. Ce film n’est pas isolé. Paul Laverty [le fidèle scénariste de Ken Loach, NDLR] et moi-même avons pensé à un moment donné introduire dans l’histoire un syndicaliste ou un personnage en désaccord avec les méthodes de travail imposées par cette société de livraison. Mais finalement, nous nous sommes rendu compte que le propos en aurait été affaibli. Cela aurait ressemblé à une expression directe de moi-même dans le film. C’était plus fort de maintenir le point de vue uniquement sur cette famille. Et, d’une certaine manière, la question restait ainsi ouverte pour le spectateur et le renvoyait à son propre jugement.
À lire aussi >> La critique de « Sorry We Missed You »
Aux clients de ces plateformes de livraison, qui sont de plus en plus nombreux aujourd’hui, le film peut dévoiler les conditions de travail qui y sont en vigueur. Beaucoup les ignorent et même n’y pensent pas…
Pour moi, il est difficile d’imaginer qu’on ne se pose pas cette question-là. Mais l’interrogation essentielle, à mes yeux, est la suivante : combien de temps peut durer un système où toute marchandise achetée est apportée à chaque individu par une personne au volant d’un van consommant de l’essence ou du diesel ?
Même si ce système de livraison individuelle était effectué par des véhicules électriques, il faudrait produire cette électricité et il en faudrait toujours plus. Par conséquent, on va finir par redécouvrir une autre solution : la présence de magasins dans les centres-villes où on va faire ses courses. Ce n’est pas une si mauvaise solution [rires]…
Ce que le film montre bien, c’est le terrible engrenage dans lequel sont pris les personnages. La pauvreté de cette famille n’est pas seulement financière. Les relations entre les êtres s’appauvrissent aussi : entre mari et femme, parents et enfants…
Absolument. On assiste à un transfert de pouvoir entre le travailleur et l’employeur. Il a existé une période où les gens avaient des journées de 8 heures, ils ont même eu les 35 heures, ils avaient des boulots fixes, suffisamment d’argent à consacrer à leur famille, ils avaient du temps pour s’occuper de leurs enfants… Il s’était instauré un certain équilibre entre le travail et les autres composantes de la vie. Cet équilibre disparaît avec la montée du travail précaire, que Paul et moi voyons comme un développement inévitable du capitalisme, à cause de la libre concurrence entre les sociétés privées. Celles-ci fournissent un service le moins cher possible, donc à moindre coût, en particulier en main-d’œuvre. On impose aux gens de fournir leur outil de travail, on ne paye pas les congés, il faut trouver un remplaçant sur-le-champ quand on ne peut pas venir travailler, sauf à être pénalisé… Toutes les responsabilités pèsent sur le travailleur. Il n’y a plus besoin de contremaître pour le contraindre à être plus productif. Il s’autoexploite. Bien sûr, les rémunérations sont inférieures. Les personnes travaillent entre 12 et 14 heures par jour. Ce qui donne, sur le plan humain, les néfastes conséquences que vous décriviez. Ce n’est pas une faille, mais au contraire une réussite du marché dans une économie libérale. C’est le fruit de la politique de l’Union européenne : on retrouve les mêmes situations en France, en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Si on veut stopper cette logique, arrêter d’acheter sur Amazon ne sera pas suffisant. Il va falloir s’attaquer au système lui-même.
L’une des grandes qualités de votre cinéma réside dans le jeu des comédiens, qui souvent sont des non-professionnels – c’est à nouveau le cas ici – recrutés parmi des travailleurs ressemblant aux personnages qu’ils vont interpréter. Ils sont toujours formidablement justes. Comment travaillez-vous avec eux ? Pourquoi, notamment, ne leur donnez-vous pas à lire le scénario ?
L’objectif, c’est que le spectateur ait l’impression que l’histoire se déroule en direct devant ses yeux. Alors comment faire pour que tout ait l’air spontané ? Quand j’ai démarré, à la télévision anglaise, on faisait une lecture du scénario avec tous les comédiens réunis, on répétait pendant deux semaines, puis on enregistrait. Mais je trouvais que les acteurs n’étaient pas justes. Ou, plus exactement, ils l’étaient au début quand ils découvraient le scénario, leurs répliques, mais ensuite cela se rigidifiait. C’est pourquoi j’ai changé de méthode. En effet, je ne donne plus le scénario à lire. Et je filme les scènes dans l’ordre chronologique de l’action. Les comédiens ont leurs répliques un jour ou deux avant la scène à tourner. Ainsi, ils découvrent l’histoire au jour le jour et s’interrogent sur ce qui va arriver à leur personnage. Kris Hitchen [qui interprète le rôle du père dans Sorry, We Missed You, NDLR] ne savait pas, quasiment jusqu’au dernier jour, si son personnage allait ou non se tuer dans un accident. Cela donne un vrai sens du danger. Comme dans la vie.
Je vous ai entendu dire que vous aimiez les comédiens vulnérables. C’est-à-dire ?
Cela signifie que je veux des comédiens ouverts, qui se rendent disponibles à la scène, au flux des émotions. Pas des acteurs qui ont des défenses. Les acteurs professionnels apprennent des techniques dont ils usent parfois pour se protéger – et quand je dis cela, je ne formule pas une critique globale envers les acteurs professionnels. Si vous devez jouer un profond état de douleur, cela peut être dangereux pour vous. Cela, je le conçois. Mais, en même temps, un comédien qui ne se livre pas, qui se protège, ne sert pas un film. Seul un acteur dont on a le sentiment que les émotions sont authentiques pourra toucher le public.
J’ajouterai qu’il est de la responsabilité du metteur en scène que le tournage soit un lieu sûr, où règne la confiance. L’humour doit aussi y avoir sa place. Si cet environnement protégé qui va permettre aux comédiens de se libérer n’existe pas, c’est la faute du réalisateur, qui, de fait, commet une rupture du contrat de confiance, si je puis dire.
Que pensez-vous des manifestations contre le réchauffement climatique et plus généralement des mobilisations en faveur de la protection de l’environnement ? La sauvegarde de la planète est souvent considérée comme la première des urgences, notamment par les jeunes, avant les préoccupations sociales et économiques…
La question environnementale est la plus grande qui soit aujourd’hui. Comment se battre contre le dérèglement climatique ? La façon la plus logique, à mon avis, serait de planifier la manière dont on peut protéger ensemble la planète, c’est-à-dire réfléchir à ce qu’on produit, à ce dont on a besoin, aux lieux de production, à la manière dont on organise la distribution. C’est pourquoi on en revient toujours à la question économique.
La libre concurrence ne peut protéger l’environnement. Toute multinationale qui en aura la possibilité détruira les forêts primaires pour obtenir des gains à très court terme. On le voit en Amazonie. Un ou deux pays peuvent toujours prendre la tête d’un mouvement de protection de l’environnement ou essayer d’en être les initiateurs, la solution se situe à l’échelle mondiale. Les lois commerciales doivent être totalement repensées, les productions locales renforcées, etc. L’urgence, c’est qu’il faut enclencher dès maintenant ces mouvements de profonde transformation parce que l’on sait que ces solutions prendront du temps. Quant à ceux qui disent que cette voie-là est impossible, j’attends de voir les solutions efficaces qu’ils proposent.
Pour moi, préoccupations écologiques et préoccupations sociales sont convergentes. Si Donald Trump veut développer la recherche du pétrole en Alaska, c’est parce qu’il est au service des multinationales en quête de profits toujours plus importants. Les luttes en faveur de la sécurisation du travail et celles visant à protéger les forêts ou l’Arctique sont de même nature. Il faudrait que les responsables politiques, quels qu’ils soient, rapprochent ces questions. Mais la plupart ne le font pas.
Pensez-vous que le réchauffement climatique puisse être le vecteur d’histoires pour des longs métrages de fiction ?
Oui, c’est bien sûr possible d’en faire une matière à fictions. Personnellement, je ne crois pas être le bon réalisateur pour cela. Les cinéastes les plus à même de le faire sont peut-être ceux qui viennent de pays où ces questions sont particulièrement cruciales, où le dérèglement climatique les atteint déjà de manière dramatique.
Vu de l’extérieur, on a l’impression qu’on ne parle de plus rien d’autre au Royaume-Uni que du Brexit, dont on ne connaît pas encore l’issue. Comment voyez-vous cela ?
Sur cette question du Brexit, qui envahit en effet l’espace public depuis trois ans, deux droites s’affrontent. D’un côté, il y a les capitalistes « sophistiqués », qui voudraient rester dans l’Union européenne pour les possibilités qu’offre l’économie de marché, sur le plan commercial en particulier. Pour cela, ils seraient prêts à concéder quelques miettes, c’est-à-dire consentir à quelques protections en faveur des travailleurs et à quelques réglementations supplémentaires en faveur de l’environnement. De l’autre, il y a les capitalistes que j’appelle « sauvages », dont Boris Johnson est aujourd’hui la figure centrale, qui défendent un Brexit intégral. La sortie de l’UE, pour eux, signifie la hausse du travail précaire, une main-d’œuvre moins coûteuse, la baisse des impôts pour les grosses entreprises, l’ouverture totale du Royaume-Uni aux produits américains, notamment les denrées alimentaires de faible qualité, et cela permettra aussi de privatiser les derniers services publics encore épargnés.
À gauche, il existe aussi deux visions. Ceux qui avant tout condamnent l’Union européenne pour avoir favorisé la précarité, aggravé le déséquilibre entre l’Est et l’Ouest à cause des disparités des richesses et des revenus, etc. Et ceux qui soulignent surtout qu’en quittant l’Europe le Royaume-Uni va devenir le terrain de chasse des États-Unis.
Dans le débat public, sur les chaînes de télévision, à la BBC, les seules positions qu’on entend sont celles des droites. Les positions du Labour ne sont pas relayées. Jeremy Corbin et John McDonnell, ses deux principaux leaders, organisent régulièrement des meetings qui attirent beaucoup de monde. On en a des échos sur les réseaux sociaux. Mais les grands médias traditionnels les ignorent.
Pendant très longtemps, vos films étaient peu vus en Grande-Bretagne. Vous aviez davantage de public en France. Cette situation a-t-elle changé ?
Oui, ce fut long mais mes films sont mieux distribués désormais. Grâce à l’obtention de la Palme d’or, Moi, Daniel Blake, mon précédent film, est même sorti dans des multiplexes. C’est la première fois que cela arrivait. Bien sûr, ils ne font toujours pas les mêmes entrées que les blockbusters américains…
Quels conseils donneriez-vous à un jeune désireux de faire du cinéma en Angleterre ?
Ce serait de trouver du boulot dans le milieu du cinéma. Plein d’étudiants font des films en amateurs. C’est très bien, mais je crois que le mieux c’est de commencer à travailler dans une des branches du cinéma, pour voir comment cela fonctionne. Et, en même temps, vous pouvez vous former au fonctionnement d’une caméra, au son, au montage. Et syndiquez-vous : c’est une bonne manière aussi de rencontrer des professionnels.
Enfin je voudrais vous poser une dernière question sur le football, dont chacun sait que vous êtes grand amateur…
Ah ! Enfin une question sur le football ! [Rires.]
Comment arrivez-vous à éprouver encore du plaisir de spectateur alors que les joueurs sont devenus des valeurs marchandes et que le foot est représentatif du capitalisme le plus débridé ?
Je ne regarde pas les matchs des grandes équipes (Liverpool, Manchester City, Manchester United…). Il m’arrive de les écouter à la radio et je regarde les résumés à la télévision. En fait, je m’intéresse surtout aux plus petites équipes.
Celle que je soutiens, Bath City, n’est pas une équipe professionnelle. Les gars ont tous un travail à côté. Certains d’entre eux ont commencé une carrière de footballeur professionnel puis ont bifurqué. Les matchs attirent à peu près un millier de personnes à chaque fois. C’est là qu’on ressent un autre état d’esprit, une vraie passion, une vraie joie. Après le match, on se retrouve au bar. C’est très sympa. On désigne le meilleur joueur, à qui on offre une bouteille de vin, et c’est lui qui régale…
Traduction : Pascale Fougère
Pour aller plus loin…

Fanon l’Algérien

« Sans l’hôpital psychiatrique de Blida, Fanon n’aurait pas existé tel qu’on le connaît »

Disparition de Jean-Pierre Thorn, cinéaste des causes justes







