Comprendre l’Iran
« Iran, la révolution invisible », de Thierry Coville, démonte la vision occidentale de ce pays et fait découvrir son histoire récente. Bernard Ravenel, président de France-Palestine Solidarité, nous en livre sa lecture.
dans l’hebdo N° 961 Acheter ce numéro
Alors que l’étau se resserre sur l’Iran avec de nouvelles sanctions votées par le Conseil de sécurité, alors que, comme vient de le déclarer Dan Fried, le secrétaire d’État adjoint américain, « nous n’avons pas retiré l’option militaire de la table » , alors qu’en France a été montée pendant plusieurs mois une campagne effrénée pour justifier cette possible option militaire, Thierry Coville vient apporter un peu d’air frais à une atmosphère médiatique insupportable. À son livre s’ajoute fort opportunément le numéro estival de Manière de voir , publication du Monde diplomatique , consacrée aux « Tempêtes sur l’Iran ».
Comme le rappelle Thierry Coville dans son introduction, on a vu naître en France, dans la foulée des think tanks néoconservateurs américains, des « experts de l’Iran autoproclamés » , des « spécialistes » n’ayant aucune connaissance de ce pays, mais dont le seul objectif est de montrer que « l’Iran représente un danger absolu pour le monde libre ». Ces spécialistes « appelant de leurs voeux une action militaire contre la république islamique » .
Pour l’essentiel, cet essai est une remise en perspective historique visant à démystifier toute la politique de diabolisation systématique de l’Iran menée en Occident. Et l’on découvre alors, tout au long de ces pages, même en limitant le propos au seul XXe siècle, toute la richesse et toute l’importance de l’histoire de l’Iran. Trois événements politiques majeurs ont scandé la vie de l’Iran au XXe siècle : une révolution constitutionnelle dès 1906, la nationalisation de l’industrie pétrolière en 1951 et la révolution islamique en 1979. Dans ces moments forts, l’Iran a été à l’avant-garde du monde musulman, ayant la volonté de régler ses comptes avec l’Occident « colonial » tout en souhaitant établir un système politique démocratique et un état de droit. Thierry Coville nous fait découvrir l’histoire d’une modernité différente de la modernité occidentale, qui n’est pas aussi globale qu’on le dit.
À chaque fois, aussi, ces révolutions ont été l’objet de réactions violentes des puissances étrangères (en clair, du Royaume-Uni, des États-Unis et de la Russie) soucieuses d’installer des dictatures leur permettant de poursuivre le pillage de ce pays plein de ressources. De ce point de vue, la révolution islamique, désormais une donnée géopolitique majeure du XXIe siècle, s’inscrit dans toute l’histoire de l’émancipation de l’Iran vis-à-vis de l’Occident.
L’auteur analyse la nature du régime islamique, où coexistent légitimité démocratique et légitimité religieuse, ce qui en fait un objet historique spécifique que la culture euro-centrique a du mal à appréhender. S’appuyant sur cette contradiction entre ces deux légitimités, l’auteur, fin connaisseur de la vie politique et économique iranienne, présente une analyse de l’évolution du système politique iranien.
Dans le domaine idéologique, l’analyse de la pensée religieuse chiite fait apparaître des courants très divers. Thierry Coville cite alors celui que l’on peut considérer comme l’un des théoriciens de la révolution de 1979, Ali Chariati. Pour ce dernier, influencé par le marxisme, c’est aux masses opprimées que revient la tâche de réaliser la révolution. On aurait aimé en savoir plus sur ce courant de « gauche islamiste » qui a mené dans les années 1990 un travail de « reconstruction » , de refondation idéologique de la pensée islamiste, qui s’apparente à une sorte de théologie islamiste de libération.
Finalement, le régime n’a pu construire un modèle islamique cohérent et reste dominé par des tendances antagonistes. D’où l’intérêt, également, des problèmes posés par l’économie pétrolière et par les conséquences négatives de la rente pétrolière, qui engendre des inégalités très profondes en matière de répartition du revenu national, mais aussi une très faible capacité de création d’emplois pour une population à la fois nombreuse, jeune et éduquée.
Dans cet ensemble, la question des droits des femmes et des rapports entre les sexes, enjeu central de la guerre des cultures, certes abordée à travers les modes d’application de la charia et les résistances qui lui sont opposées, aurait mérité d’être traitée plus largement et plus spécifiquement.
C’est à partir de ce contexte interne que Thierry Coville aborde la question de la politique étrangère de la République islamique. Là encore, étudiant avec soin les rapports entre volonté d’internationaliser la révolution et souci de l’intérêt national, l’auteur présente dans toute sa complexité régionale et dans sa relation conflictuelle avec les États-Unis une politique étrangère dont l’ambition principale est de faire de l’Iran la puissance régionale dominante au Moyen-Orient. Ce qui l’oppose frontalement au Grand Moyen-Orient voulu par les États-Unis.
À partir de là se pose la problématique du programme nucléaire iranien et des soupçons portant sur des objectifs militaires non avoués. Là encore, Thierry Coville, dans une approche rationnelle de « l’ambiguïté nucléaire » iranienne, conclut logiquement et prudemment que « le choix de l’arme atomique n’a pas encore été fait et que l’objectif de l’Iran est plutôt d’atteindre la « zone frontière » lui permettant éventuellement de sauter le pas s’il le décide ».
L’ensemble du livre et du dossier de Manière de voir permet mieux de penser l’avenir possible du régime d’Ahmadinejad. À moins que, d’ici là, les États-Unis décident de frapper, ce qui ne ferait que précipiter la décision du pouvoir iranien de se doter de la bombe. On le voit, cet ensemble met à mal toutes les élucubrations construites par le courant néoconservateur pour justifier la guerre contre l’Iran. Gageons que les porte-plume de ce courant en France auront du mal à le citer dans leurs bibliographies.
Pour aller plus loin…

« Fanon nous engage à l’action »
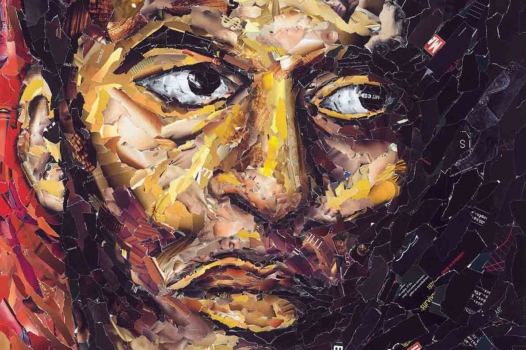
Frantz Fanon, un éclairage disputé sur l’héritage colonial

Fanny Gollier-Briant : « Il faut absolument repolitiser la souffrance des jeunes »







