Le roman d’un tricard
Avec Michel Houellebecq, dont Sérotonine paraît ces jours-ci, le pire est toujours sûr, y compris en matière de littérature.
dans l’hebdo N° 1535 Acheter ce numéro

J e n’aurais peut-être pas fait grand-chose de bien dans ma vie, mais au moins j’aurais contribué à détruire la planète. » Et revoilà l’inénarrable « esprit de provocation » de Michel Houellebecq ! Mais non, erreur ! Ici, ce n’est pas l’auteur qui s’exprime. Il l’a fait ailleurs, récemment dans le magazine américain Harper’s, où il a tressé des éloges à Donald Trump, – « un des meilleurs présidents américains que j’aie jamais vus ». Dans ce septième roman, Sérotonine, c’est son narrateur qui parle, un hétéro-beauf de 46 ans, violemment homophobe, tout autant anti-écologiste, et qui « n’a rien à reprocher aux femmes ». Au contraire, il éprouve pour elles de grands et purs sentiments. La preuve, à propos de Yuzu, une Japonaise qu’il a aimée, il dit : « Ce ne furent pas ses qualités d’escort girl “haut de gamme” qui me firent m’éprendre de Yuzu, mais bel et bien ses qualités de pute ordinaire. »
Si Michel Houellebecq avait voulu créer un personnage à son image, il ne l’aurait pas décrit « baraqué, trapu » et encore moins « un peu alcoolique ». Voilà donc un personnage inédit de roman : Florent-Claude Labrouste, ingénieur agronome, broyant du noir, et absorbant chaque jour un comprimé de Captorix, un antidépresseur lié à la sérotonine, qui lui permet de traverser le quotidien sans terreur mais avec la libido à plat. Du jamais vu chez Houellebecq, non ?
Misère sexuelle, misère de l’époque – ces deux thématiques récurrentes chez l’auteur des Particules élémentaires –, et, en fin de compte, misère de la littérature. Car Sérotonine rejoint ses prédécesseurs au rang de roman de pacotille. Ce qu’il raconte : les amours passées du narrateur, les quelques femmes avec lesquelles il a fait pendant un temps vie commune et pourquoi cela a foiré. Le livre, dont l’écriture est certes élémentaire, mais où on trouve plus souvent le mot « bite » que chez Amélie Nothomb, est construit comme une sorte de passage en revue de ces amoureuses, le récit opérant des flashbacks et des retours au présent, alors que le narrateur vit désormais claquemuré dans une chambre d’hôtel. Ces différentes strates temporelles sont parfois involontairement confuses. On ne saurait trop en vouloir à Michel Houellebecq, qui ose abandonner la narration linéaire. Las, il perd dès lors ses derniers moyens : de laborieux, il devient malhabile.
Ce regard rétrospectif a cependant une importance cruciale : il ouvre à la nostalgie, cette nostalgie poisseuse qui colle à tout le livre. Certes, le narrateur est un loser sentimental en voie de dépérissement. Mais les choses auraient pu tourner autrement. Il y avait la possibilité de l’amour. Michel Houellebecq, à travers Sérotonine, crie sa croyance en l’amour. C’est terriblement bouleversant – ou cucul la praline, au choix. En proie à un rousseauisme passager, son narrateur s’indigne : « J’avais bien compris, déjà à cette époque, que le monde social est une machine à détruire l’amour. » Pas au point de mettre à mal celui qu’il conçoit pour les vaches, normandes de préférence, qui ont été pour lui, dans ce monde de brutes, « une consolation, presque une révélation ».
Bien sûr, tout n’est pas à prendre au sérieux. Les tentatives d’humour, méritoires bien que systématiques, consistent à énoncer un nom tenant de la haute civilisation et de l’associer à un prosaïsme quelconque (ou inversement). Exemple : « Si Pascal avait connu la box SFR il aurait peut-être chanté une autre chanson. » Autre exemple : « Quelle raison pouvait bien avoir une petite fille de dix ans pour frapper à la porte d’un quadragénaire misanthrope et sinistre, allemand de surcroît ? Était-ce pour qu’il lui fasse lecture de poèmes de Schiller ? C’était bien plus vraisemblablement pour qu’il lui montre sa queue. »
Non, ce qui est vraiment drôle, c’est, dans la pluie d’éloges que la presse déverse, ce qu’on a lu sous la plume d’une critique des Inrockuptibles, déclarant que Sérotonine était un roman « d’extrême gauche ». Michel Houellebecq ne prend pourtant jamais la moindre distance avec son narrateur réac et nauséeux. Mais voilà : c’est que celui-ci critique, ça et là, certains travers du libéralisme, comme les accords de libre-échange qui auront la peau des producteurs d’abricots du Roussillon. Il raconte aussi une révolte d’agriculteurs sous le joug de la politique européenne qui entraîne « le plus gros plan social à l’œuvre à l’heure actuelle ». La scène d’une manifestation d’éleveurs qui tourne mal est l’un des morceaux de bravoure. Une anticipation des gilets jaunes, comme certains le prétendent, confirmant là les qualités de « sociologue », sinon de « visionnaire », de l’auteur ? C’est oublier que, là comme ailleurs, Houellebecq ne fait que reprendre ce qui existe déjà – des manifestations violentes d’agriculteurs, encadrées par des syndicats – pour l’hypertrophier, le simplifier à outrance. D’où des visions grossières sinon crétines, comme celles sur l’islam que contenait Soumission, l’opus précédent, et véhiculant une idéologie moisie. Le diable étant dans les détails, il est remarquable que, parmi les noms de partis ou de mouvements politiques cités dans Sérotonine (En marche !, La France insoumise, le Parti communiste…), le seul à ne pas être brocardé, mais, au contraire, à se voir attribuer un satisfecit, est le Rassemblement national (pour les curieux, c’est page 265).
« Je compris que le monde ne faisait pas partie des choses que je pouvais changer », déclare le narrateur, et c’est bien ainsi, étant donné l’odeur rance qu’exhale son esprit. De la même façon, ce roman n’aura pas d’influence sur la littérature. Il en a en revanche sur nombre de critiques littéraires béats chez qui on craint une surdose de Captorix…
Sérotonine, Michel Houellebecq, Flammarion, 347 p., 22 euros.
Pour aller plus loin…

« Les Voleurs d’ampoules », une traversée initiatique

« La Ville » : qui sont vraiment les zombies ?
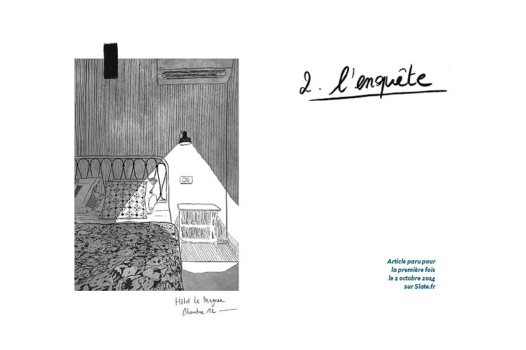
« Écrire Mazan » : avec Gisèle Pelicot, sortir de la sidération







