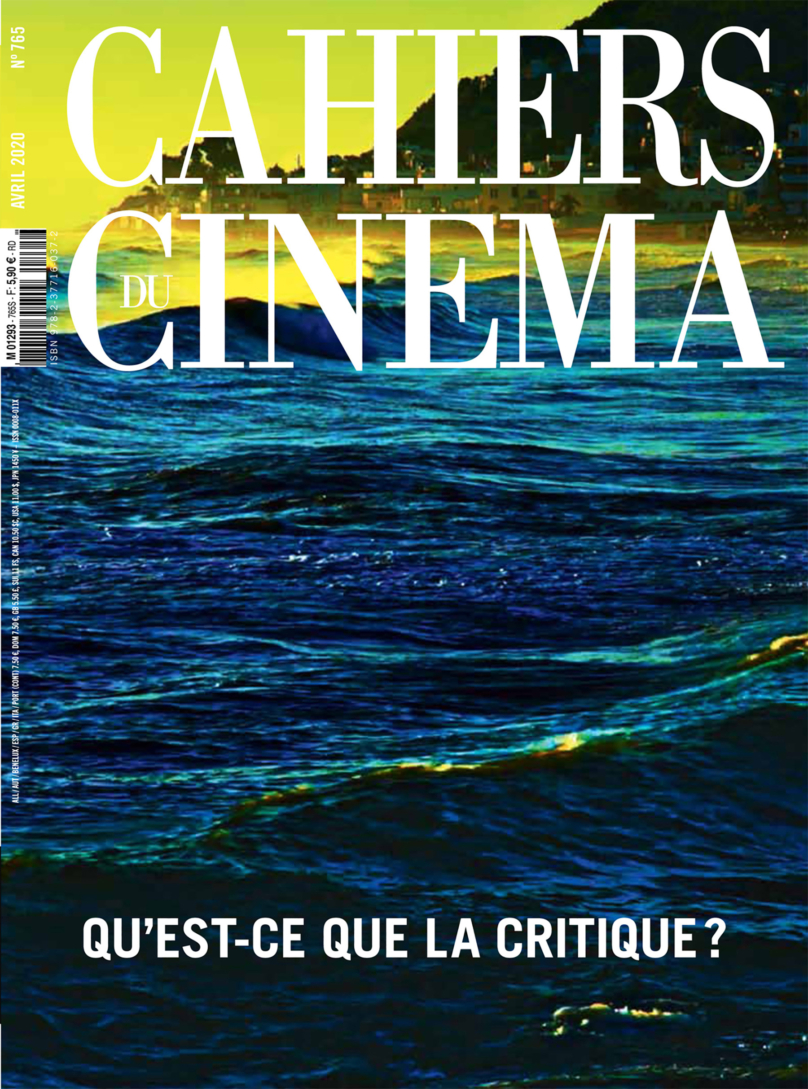Stéphane Delorme : « La critique gêne le marché »
Dans un ultime numéro, la rédaction démissionnaire des _Cahiers du cinéma_ défend l’idée d’une approche exigeante et politique des œuvres. Explications avec son ex-rédacteur en chef, Stéphane Delorme.
dans l’hebdo N° 1601 Acheter ce numéro
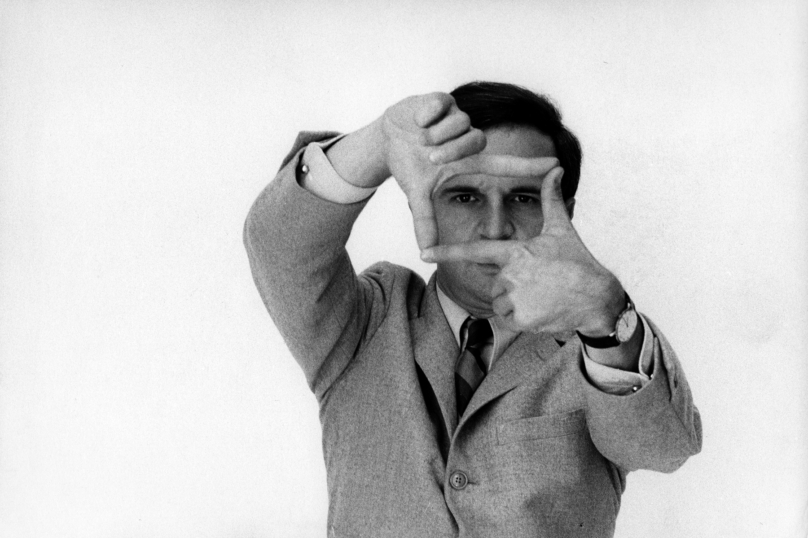
Démissionnaire à la suite du rachat du titre par des affairistes proches du pouvoir et par des producteurs (voir Politis n° 1593, du 5 mars), la rédaction des _Cahiers du cinéma part sur un coup d’éclat : un ultime numéro d’exception. Thème annoncé en une : « Qu’est-ce que la critique ? », sur une image de vagues (nouvelles ?) issue d’Adieu au langage, de Jean-Luc Godard. Pas de veillée funèbre, encore moins de règlement de comptes. Ce numéro constitue un formidable acte de foi, qui se présente sous la forme d’un texte de 25 pages foisonnant, pétulant, stimulant, signé par les quinze membres de la rédaction. Un texte collectif comme un point d’orgue à ces douze dernières années où cette rédaction était en place – et les éditions Phaidon propriétaires des Cahiers –, mais aux allures de manifeste, qui pourrait tout autant surgir à la faveur de commencements. Le geste a de la classe… L’adage dit : « La critique est aisée, l’art est difficile »… Rien n’est plus faux quand on tient la critique pour une activité sérieuse (à exercer sans esprit de sérieux), et non pour ce qui se pratique hélas le plus souvent : une Bourse des valeurs culturelles délivrant des bons à consommer. Ce numéro affirme que la critique est une pratique professionnelle, un espace pour penser le cinéma et le monde, et un sport de combat.
« Si la critique a un sens, c’est celui de défendre une cause, défendre des principes et des idées. Il faut donc savoir au nom de quoi on parle et on juge. […] On juge à partir de principes esthétiques, moraux, politiques. Le critique a un point de vue et il aime que le cinéaste ait aussi un point de vue. » Ça démarre fort. La suite ne faiblit pas. D’autant que toutes les questions complexes sont abordées : de quoi est fait ce jugement (ou « l’art d’aimer ») ? Que fait le critique du chaos de ses émotions face à l’œuvre ? Comment s’élabore l’écriture ?
Cette plume collective ferraille, furieusement politique. La critique ici défendue est aussi exigeante qu’elle est insoumise. Réfractaire aux mots d’ordre, ceux de la promotion comme ceux de la censure, en butte aux forces contraires, celles de tous les pouvoirs. « Si l’on consent à la docilité, à l’abandon de notre tâche (de) critique, à quoi consent-on ? À prolonger le monde (et le cinéma) tel qu’il est pour tous, c’est-à-dire tel qu’il est façonné par l’idéologie de quelques-uns, à se rendre complice de la catastrophe. » Explication avec le désormais ex-rédacteur en chef des Cahiers, Stéphane Delorme.
Pourquoi avoir pris la critique comme sujet ? Était-ce important que ce texte soit signé par toute la rédaction ?
Stéphane Delorme : La critique a mauvaise presse aujourd’hui. Et cela ne concerne pas seulement le cinéma, mais tous les domaines. On avait donc envie de défendre ce métier que nous aimons. Et comme la rédaction quitte le navire ensemble, d’un bloc, il fallait qu’on signe tous ensemble. La critique gêne. Parce qu’elle gêne le marché. La critique a été massivement remplacée par le storytelling, qui est bien plus confortable et inoffensif, ou par le « news culturel ».
On l’a vu il y a quelques jours avec la démission du rédacteur en chef de Hollywood reporter. Les propriétaires lui reprochent d’avoir publié un classement des pires films de la décennie et un article pas assez élogieux sur Jennifer Lopez… Même là, avec ce magazine pourtant proche de l’industrie, on voit que « ce n’est pas assez ». Qu’il ne faut plus aucune fausse note. Il y a une allergie à la critique. Parce qu’elle n’est pas contrôlable et que le marché veut tout contrôler.
Mais il y a une autre idée forte aujourd’hui, qui donne une assise à cette allergie, c’est le « chacun ses goûts ». Il en faut pour tout le monde. La critique serait une autorité d’un autre temps, forcément arrogante et autoritaire, qu’il faudrait démocratiquement renverser. Cette idée a été colportée notamment sur les réseaux sociaux. Or cette idée rejoint parfaitement et idéalement les exigences du marché. Ainsi les entreprises peuvent être en contact direct avec les consommateurs par-delà les critiques emmerdeurs. Toute la presse, pas seulement la critique, a pâti de ce mouvement soi-disant démocratique mais démagogique et bien intéressé. Déstructurer la pensée en abolissant ce tiers symbolique qu’est le critique, et avec lequel un lecteur peut avoir un dialogue imaginaire, permet de contrôler davantage les publics. Ainsi, de la même manière que le marché segmente en différentes populations-cibles, les spectateurs sont invités à se déterminer « comme » groupe (selon le sexe ou la race), à s’étiqueter « comme » fans de tel ou tel genre, dans lequel on peut vite s’enfermer. Or c’est catastrophique pour des gens jeunes, dont l’esprit est très souple et accueillant, qu’on garde captifs de certains genres de films ou de séries (c’est la méthode Netflix) alors qu’ils pourraient aller voir ailleurs.
Le marché cible donc ses consommateurs par groupes et la critique devrait faire de même. Les Cahiers du cinéma devraient faire la promotion du cinéma d’auteur ou L’Écran fantastique la promotion du cinéma fantastique. On se doute qu’il ne s’agit pas de défendre tout le monde, on peut tirer sur les ambulances ou les films sans enjeu. À partir du moment où vous attaquez un film dit « important », là ça pose problème. Il ne faut pas de mauvaises surprises. Or qui détermine à l’avance qu’un film est important ? Parce qu’il est en compétition à Cannes ? Parce que l’auteur est reconnu ? Parce qu’il est du sérail ? Le critique est là pour juger. Jamais l’importance d’un film ne doit être préétablie. Que ce soit un film de Bela Tarr ou d’Arnaud Desplechin, pour prendre des auteurs dont nous avons pu dire du mal. Le critique doit se sentir libre de désacraliser. Pas pour le plaisir de le faire, mais simplement parce que l’art souffle où il veut. Et parfois un petit film inattendu aura plus d’intelligence et de beauté que le chef-d’œuvre annoncé. Et là il faut un critique pour prévenir le public et lui dire : ne le ratez pas.
Votre texte édicte des principes – fruits de croyances, d’idées, de pratiques professionnelles – et en même temps, il revendique pour le critique le devoir d’ouverture, la remise en question de ses habitudes, ses certitudes. Est-ce possible ?
Oui c’est tout l’enjeu de la critique, et de la pensée tout court. Parler au nom de principes, au nom de causes, mais savoir en même temps accueillir l’altérité et nommer la singularité. Cette dialectique est essentielle et c’est dans le passage de l’un à l’autre qu’on peut avoir une pensée en mouvement, jamais dogmatique, toujours fraîche. Les principes ne sont pas des dogmes. A chaque début de film, il faut remettre les compteurs à zéro, se mettre en état de comprendre ce que l’on va nous montrer et nous dire. Ne pas avoir de préjugés. Un critique se doit d’avoir cette générosité, cette attention, vis-à-vis du lecteur, qu’il représente, mais aussi vis-à-vis de l’auteur. Ce n’est pas un sniper qui attend au coin du bois ! Mais c’est la même chose au fond pour tout spectateur. Un « bon » spectateur est celui qui ne veut pas qu’on lui serve tout le temps la même chose, que le film obéisse à ses désirs, à l’inverse de cet « utilisateur » que les plateformes appellent de leurs vœux afin de prédéterminer son « expérience » et de programmer ses envies.
La critique que vous défendez est aux antipodes du journalisme de consommation culturelle, réduit à des conseils, à des évaluations. La critique a-t-elle un avenir dans la presse ?
Ce texte collectif est une mise en garde. On le dit au début, c’est un « bouclier », qu’on donne aux plus jeunes, pour expliquer ce qu’on fait et donner des outils et des arguments. On a vu comment ce qu’on appelle dans le texte « le journalisme culturel » a grignoté la place de la critique. Ce sont des petits arrangements successifs pour faire le plus de partenariats possible, ne pas froisser untel ou untel, passer sous silence ce qui fâche. Au bout du compte tout est plus ou moins conseillé. Il en faut pour chacun. Le journalisme culturel suit l’air du temps pour faire des couv’ accrocheuses. On ne sent plus que les choix sont faits par conviction mais juste par opportunisme. On ne sent plus que les choix sont faits par imagination mais juste par suivisme. Tout devient l’occasion d’une instrumentalisation : que ce soit la cause féministe ou maintenant le confinement. Mais on ne s’interroge pas en profondeur, on n’entre surtout pas dans le vif du sujet. Et on « invisibilise » ce qui a été fait avant. C’est très impressionnant : le trait même de notre époque est cette prétention à faire « nouveau monde », tout doit être une révolution, alors que bien souvent on redécouvre juste l’eau chaude ! On voit bien que ce journalisme culturel béat est une incapacité à entrer dans le domaine de l’art, de l’histoire et de la politique. C’est un phénomène déstructuré et mortifère qui empêche de penser. Parce qu’il n’est pas critique, il ne fait pas de choix.
Quels sont les ennemis de la critique ?
Tous ceux qui ne veulent plus qu’on fasse de choix librement. Tous les ennemis de la liberté et de la subjectivité. Et aujourd’hui ils sont nombreux. Le marché, mais aussi les « milieux » qui préservent leurs intérêts et qui font ami-ami avec le marché. La pensée matérialiste et positiviste qui se targue d’objectivité. Et puis les nouvelles pensées dogmatiques centrées sur la notion d’identité. Selon son identité on aurait le droit de dire telle chose ou pas, de critiquer ou pas. C’est le retour du sacré, du dogme, du terrorisme intellectuel. Alors que la pensée critique accepte par nature la critique, l’autocritique et la diversité des analyses. Le critique est habitué au désaccord et à la discussion. Le critique aime et défend ce qu’il aime ; même quand il attaque, il le fait au nom de ce qu’il aime. Or ce doit être un principe : être au service de ce qu’on aime. Si on défend un film parce qu’il « le faut », cela n’a évidemment plus de valeur – et ne reste plus que la peur. Le texte critique est la trace d’une rencontre désintéressée entre une subjectivité et une singularité.
Dans quelle mesure la critique de cinéma vous a-t-elle amenés aux positions politiques qui ont été les vôtres, en faveur des gilets jaunes notamment ?
En tant que critiques de cinéma, on voit des choses que certains médias ne voient pas. Notre rapport au cadre, au montage, à la mise en scène, au hors champ fait qu’on voit les images. On sait les voir parce qu’on sait les regarder. Ce savoir est en train de se perdre. C’est affligeant de voir que les rubriques « médias » des journaux sont incapables de voir les images. On pourrait penser aujourd’hui qu’il suffit de regarder les vidéos sur internet pour comprendre les forces en présence, eh bien non : ces vidéos ne sont pas regardées. Les médias sociaux prennent le relais mais sont enfermés dans des bulles qui font qu’ils ne touchent pas la majorité des gens. On croit qu’on peut faire la preuve par l’image, mais personne ne se sert des images. C’est consternant. On nous expliquait en boucle que Paris flambait alors qu’il suffisait de regarder : il s’agissait de poubelles et de sapins de Noël ! Et on a été submergé de vidéos de violences policières mais rien n’en a été déduit dans les grands médias. Il est devenu clair avec les gilets jaunes que la vie des poubelles valait plus que la vie des hommes.
Il y a un désir d’ordre aujourd’hui qui fait peur. Or la critique, c’est le désordre, c’est la liberté de parler dans tous les sens, d’objets qui ne sont pas forcément pour nous, de n’être jamais là où on nous attend. Quand les gilets jaunes débarquent, ils font une critique totale et radicale : ils en ont assez. Au lieu de les écouter, ils sont diabolisés de la pire manière. Parce qu’en face beaucoup vivent dans un monde aseptisé et ne sont plus habitués à la critique. C’est l’idée même de contestation qui gêne. Encore aujourd’hui, quand tous les soirs à 20 heures on entend les gens applaudir le personnel hospitalier, comment se fait-il qu’il n’y ait pas plus de sifflets et de slogans contre la gestion calamiteuse du gouvernement ? Va-t-on applaudir deux, trois, quatre mois ? Quand le geste et la parole politiques vont-ils remplacer le geste et la parole compassionnels ? Quand va-t-on passer de la célébration à la critique ? Parce qu’il faut se rendre compte qu’applaudir tous les soirs, c’est exactement ce que veut le pouvoir. Le consensus, l’union sacrée. Au bout du compte, c’est le pouvoir qu’on applaudit sans s’en rendre compte. C’est encore un autre exemple d’une incapacité générale à la critique, qui est vue comme du mauvais goût, du mauvais esprit, alors même qu’elle est une prise de recul sur une situation.
Terminons par une question sur le confinement : au terme de cette période, la salle de cinéma n’aura-t-elle pas été définitivement terrassée par Netflix ?
La salle en prend un coup, et au retour du confinement beaucoup n’oseront pas s’asseoir à côté d’un autre spectateur. Heureusement les salles art et essai étaient déjà à moitié vides ! Mieux vaut faire du mauvais esprit pour garder le moral… Mais c’est vrai que le cinéma d’auteur a déjà perdu une partie de son public et on voit comment Netflix a touché toutes les couches de la population, tous les âges, alors même qu’au départ la plateforme visait plutôt les « jeunes adultes », selon cette formule marketing infantilisante en passe de devenir une donnée sociale. La bonne nouvelle, c’est que certains spectateurs se rendent compte qu’il n’y a pas tant de choses que ça sur Netflix, qui n’est qu’une coquille vide, et recommencent à télécharger ou découvrent la VOD ou encore replongent dans leur vidéothèque, ce qui est mon cas. Le lancement en mars, en plein confinement, de Disney+, dont le catalogue va de Star Wars aux films de la Fox, va concurrencer Netflix. Disney achève ce que Netflix a commencé, à savoir transformer les séries et les films en « contenu ». La guéguerre entre les partisans des films et des séries est de l’histoire ancienne : les deux ne sont plus que du « contenu ». Et le contenu, on le modifie comme on veut. On l’a vu avec la censure sur Disney+ de Splash, ce film populaire des années 1980 sur une sirène jouée par Daryl Hannah. Des cheveux numériques ont été rajoutés sur les fesses quand elles n’ont pas été floutées ! Avec la censure puritaine, on a l’idée qu’une œuvre peut être modifiée selon les canaux et les publics. Si les films deviennent juste du « contenu » sans forme, disponible à loisir sur un canal, si les journaux et les médias en général sont également traités comme du contenu accompagnant d’autres contenus, et non comme des points de vue, il n’y a plus de cinéma, plus d’art, et plus de critique.
Cahiers du cinéma, n° 725, avril 2020, 5,90 euros. Achetable par correspondance sur cahiersducinema.com
Pour aller plus loin…

« Chroniques chinoises » : images non confinées

« Sauvages », la civilisation du vivant

« Miséricorde », pour l’amour du prochain