Atteintes aux libertés : L’islam en ligne de mire
S’éloignant de l’esprit de la loi de 1905, une certaine conception de la laïcité s’impose depuis une vingtaine d’années. Elle vise en priorité les personnes musulmanes, soupçonnées de ne pas vouloir s’y soumettre.

© Sandrine Marty/Hans Lucas/AFP
Bien que la loi du 9 décembre 1905 ne se réfère pas au mot, on considère généralement qu’elle détermine le régime de laïcité au sein duquel il convient d’articuler, en France, les libertés de conscience, de culte et de religion. Les deux premiers articles du texte énoncent, d’une part, que la République « assure » la liberté de conscience et qu’elle « garantit » le libre exercice du culte et, d’autre part, qu’elle « ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ».
Si la mise en œuvre de la loi au début du XXe siècle a été l’occasion de tensions, le rôle du droit s’est vite révélé apaisant, notamment à travers une interprétation libérale du texte qui a permis d’affirmer avec rigueur la portée des obligations de neutralité religieuse pesant sur les personnes publiques tout en garantissant la liberté religieuse : son de cloches, processions, tenues des ministres du culte.
Le grand juriste Jean Rivero pouvait ainsi écrire en 1949 que, en dépit de tous les débats politiques et philosophiques relatifs à la laïcité, « le seuil du droit franchi, les disputes s’apais[aient] » car, « pour le juriste, la définition de la laïcité ne soulève pas de difficulté majeure », la laïcité étant entendue « en un seul et même sens : celui de la neutralité religieuse de l’État (1) ».
Une telle définition ne semble toutefois plus suffire à rendre compte de la compréhension contemporaine de la laïcité. On l’invoque aujourd’hui pour justifier, pêle-mêle, le refus des signes religieux à l’école, au travail ou dans certains espaces publics, l’impossibilité de menus de substitution dans les cantines lorsqu’ils sont demandés pour des motifs liés à la religion, une plus grande intransigeance face à certains usages de la liberté d’expression, voire le nécessaire renforcement de la politique sécuritaire. Et, presque à chaque fois, le cœur de la dispute, c’est l’islam : le voile (ou parfois la barbe), les menus hallal, l’irruption de la lutte contre la radicalisation (presque toujours islamique) dans l’ensemble des politiques publiques… À telle enseigne que non seulement certaines associations nationales mais aussi des institutions et organisations internationales expriment leurs craintes de voir l’argument de la laïcité se muer en outil de stigmatisation, sinon de discrimination, à l’encontre des personnes musulmanes en France. Que s’est-il donc passé, et comment corriger le tir ?
Le processus principal à l’œuvre dans les transformations rapidement listées ci-dessus est celui de la substantialisation de la laïcité (2) : de principe destiné à organiser les rapports entre les pouvoirs publics et les différents cultes, celui-ci est progressivement devenu une valeur à respecter, voire une valeur à laquelle il faudrait prouver son adhésion. Ce faisant, la laïcité s’est faite moins libérale et moins égalitaire, aussi.
Moins libéral, ce nouveau régime de laïcité est aussi moins égalitaire.
Moins libérale, parce qu’elle a servi de fondement à plusieurs restrictions de taille à la liberté religieuse. La loi du 15 mars 2004 interdisant le port de signes ou vêtements par lesquels les élèves de l’école publique manifestent ostensiblement leur religion fut le premier texte de cet ordre, en imprimant une toute nouvelle interprétation de la laïcité, qui, jusque-là, avait toujours été interprétée comme ne s’opposant pas à la liberté religieuse des élèves (mais des seuls personnels de l’Éducation nationale, en vertu des obligations de neutralité pesant sur les fonctionnaires et agents publics). On a vu se multiplier ensuite les controverses relatives aux parents accompagnateurs de sorties scolaires ou aux stagiaires en formation professionnelle. Au-delà de l’école, la loi du 10 octobre 2010 est venue interdire le port du voile intégral dans l’espace public. Et, sur le lieu de travail, la loi de 2016 a permis aux entreprises d’insérer dans leur règlement intérieur des clauses de neutralité (religieuse, mais aussi philo-sophique ou politique) des personnels – un mouvement encore renforcé par la récente loi du 24 août 2021 relative au renforcement des principes républicains, qui procède à une extension sans précédent des obligations de neutralité religieuse en lien avec le service public en prévoyant que tout·e salarié·e du privé travaillant pour une entreprise à qui la loi, le règlement ou un contrat de commande publique confie l’exécution d’un service public, ainsi que tout salarié·e, le cas échéant, des sous-traitants de telles entreprises, est soumis à des obligations de neutralité, notamment religieuse.
Moins libéral, ce nouveau régime de laïcité est aussi moins égalitaire. La France a ainsi été condamnée par le Comité des droits de l’Homme de l’ONU en charge du contrôle du respect du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui a jugé que tant la résolution judiciaire de l’affaire Baby Loup (3) que la loi de 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public étaient constitutives de discriminations intersectionnelles fondées sur le genre et la religion. En d’autres termes, il a souligné que les restrictions à la liberté religieuse en cause pesaient de manière spécifique et disproportionnée sur les femmes musulmanes.
Assurément, une telle lecture des choses n’est pas unanime. Il demeure même plutôt difficile de mobiliser le principe d’égalité ou le droit de la non-discrimination face à l’impact potentiellement inégalitaire de ces nouvelles règles de neutralité religieuse. Ainsi, la Cour européenne des droits de l’Homme, bien que se disant « consciente du fait que la prohibition critiquée pèse pour l’essentiel sur les femmes musulmanes qui souhaitent porter le voile intégral », a jugé que les lois d’interdiction du voile intégral n’étaient pas constitutives de discrimination (4).
La perspective adoptée par le Comité des droits de l’Homme de l’ONU demeure donc isolée ; elle n’en soulève pas moins des questions essentielles, auxquelles des instances comme la Commission nationale consultative des droits de l’Homme ou le Défenseur des droits ne sont d’ailleurs pas indifférents. C’est qu’il faudrait en effet avoir la (fausse) naïveté des personnages d’Usbek et Rica dans Les Lettres persanes pour ne pas percevoir les anxiétés spécifiques suscitées par l’islam dans l’ensemble des redéfinitions politiques et juridiques de l’économie générale du principe de laïcité.
La question sécuritaire et les amalgames
Depuis plusieurs années, les débats sur la laïcité et le pluralisme religieux font une place relativement centrale à la notion de « vivre-ensemble ». Voilà un paradigme qui apparaît tout à fait congruent non seulement avec la devise républicaine mais aussi avec la laïcité entendue comme coexistence par l’équidistance des religions à l’État ; en d’autres termes, un paradigme d’acceptation du pluralisme et de la différence bien ajusté à la promesse républicaine. Il s’agit en tout cas d’un étendard qui pourrait être (re)mobilisé face aux trop nombreuses tentatives de lire la laïcité comme une injonction à se conformer à une manière d’être. Fondée d’abord sur la liberté de conscience, la laïcité peut très bien en accepter toutes les manifestations dans les seules limites de l’ordre public. La loi de 1905 comporte d’ailleurs un important chapitre relatif à la police des cultes, qui permet notamment de sanctionner les propos ou écrits tenus dans des lieux de culte et constitutifs de provocations à la résistance à l’exécution des lois ou au soulèvement des citoyens.
Fondée ensuite sur la neutralité de l’État et l’égalité de tous devant la loi sans distinction de religion, il importe que la laïcité s’y cantonne sans requérir, bien au-delà, la neutralité de l’espace social et de celles et ceux qui y évoluent. D’abord parce qu’une telle interprétation méconnaît le sens même de la liberté religieuse (qui couvre tout à la fois la croyance et la manifestation extérieure de celle-ci, en public ou en privé, à titre individuel ou collectif). Ensuite parce qu’une telle interprétation fait nécessairement encourir le risque d’appréciations et d’applications inégalitaires : pourquoi le voile et pas le turban ou la perruque, le menu sans viande mais pas celui à base de poisson le vendredi, etc.
Pourquoi le voile et pas le turban ou la perruque ?
Deux spectres dominent aujourd’hui ces questions et expliquent largement que nombre d’entre elles soient lues au prisme d’un principe de laïcité dont on tend à faire la clé de résolution de défis et de difficultés qui vont bien au-delà de ce qu’il peut raisonnablement promettre ou permettre. Le premier, c’est celui de la menace pesant sur la République : depuis au moins la fin des années 1980 en effet, des voix puissantes ont voulu lire dans une multitude de signes banals de la pratique religieuse – notamment musulmane – autant de formes de défiance vis-à-vis d’une norme culturelle majoritaire, volontiers sécularisée. Cette lecture, assimilationniste, présente tous les défauts de ce paradigme auquel elle se rattache. Le second, c’est celui, plus récent, qui corrèle la montée en puissance du religieux – et, avec lui, de formes intégralistes ou fondamentalistes de la religion – à la menace sécuritaire qui a vu de nombreux attentats perpétrés (en France notamment, mais pas seulement) au nom de l’islam ; à ce titre, il conviendrait de tuer dans l’œuf ces remobilisations religieuses afin de se prémunir de toute dérive violente ou terroriste.
Face à cette préoccupation, deux réponses peuvent être apportées. D’abord, la connaissance et l’analyse de ces phénomènes doivent être approfondies au lieu d’être rabotées : il faut enquêter, étudier, analyser, comparer les pratiques et les croyances religieuses pour mieux comprendre et évaluer. En ce sens, nombre de polémiques récentes laissant entendre que l’intérêt porté par les sciences sociales aux questions d’intégration, de race, de religion, de croyance, de discrimination, etc. participe, en dernier ressort, de formes de séparatisme par rapport au projet républicain doivent être rejetées avec force comme obscurantistes. Ensuite, un rappel normatif face aux glissements de sens et au péril extrême qu’ils charrient s’impose. Si la France n’est assurément pas le seul pays à y être confrontée, la question sécuritaire porte en elle le risque d’amalgames entre terrorisme et islam/islamisme (5).
Dans ce contexte, la force d’une lecture des idéologies en termes de contagion (6) – qui saisit la question de l’islam en général (et/ou celle de l’intégration des populations issues des migrations) au lieu de celle des comportements violents, afin de lutter contre nombre de pratiques religieuses désormais lues au prisme de la nécessaire lutte contre le « séparatisme » invoqué comme constituant le terreau du terrorisme (7) –appelle à la vigilance.
Par-delà le fait que ces lectures font l’économie des logiques sociales et relationnelles dont précisément les travaux en sciences sociales attestent l’importance (8), elles suscitent l’inquiétude des instances, y compris internationales, en charge de la protection des droits fondamentaux dans le cadre de la lutte antiterroriste (9).
Face à ces différents mouvements qui tendent à solliciter la laïcité sur tous les terrains (citoyenneté, sécurité…), il importe de préserver ce précieux principe constitutionnel en le rapportant à ce qu’il dit (liberté de conscience, de culte ; neutralité de l’État et égalité des cultes) plus qu’en le faisant parler de ce qu’il ne dit pas.
(1) « Le concept de laïcité », Jean Rivero, Recueil Dalloz, 1949, chron. 33.
(2) L’État et les religions en France. Une sociologie historique de la laïcité, Philippe Portier, Presses universitaires de Rennes, 2016.
(3) En 2008, une salariée de la crèche avait été licenciée au motif qu’elle portait un foulard islamique. Après plusieurs jugements contradictoires, le licenciement a finalement été confirmé par la cour d’appel de Paris en 2013.
(4) CEDH, GC, 1er juillet 2014, SAS c. France, not. §161.
(5) « Les effets de la lutte contre le terrorisme et la radicalisation sur les populations musulmanes en France », Francesco Ragazzi, Stephan Davidshofer, Sarah Perret et Amal Tawfik, Centre d’études sur les conflits, 2018.
(6) « Religiosité, rébellion et engagement. La “radicalité” juvénile à l’épreuve de l’enquête », Laurent Bonnelli, Fabien Carrié, in Désirs d’islam. Portraits d’une minorité religieuse en France, Laetitia Bucaille, Agnès Villechaise (dir.), Presses de Sciences Po, 2020.
(7) Les propos du ministre de l’Intérieur à l’Assemblée nationale le 1er février 2021 : « Notre pays est malade. Il est malade d’un séparatisme dont le premier, le séparatisme islamiste, gangrène l’unité nationale. Après s’être attaqué au terrorisme, le président de la République a souhaité diriger l’action de l’État et des pouvoirs publics contre ce qui en est le terreau. Quand on est malade, il faut savoir nommer sa maladie, identifier ses caractéristiques et étudier ses variants, mais il faut aussi trouver les médicaments. »
(8) La Fabrique de la radicalité. Une sociologie des jeunes djihadistes français, Laurent Bonnelli, Fabien Carrié, Seuil, 2018.
(9) Voir les analyses en ce sens de la Rapporteuse spéciale de l’ONU à la suite de sa visite officielle en France en 2018 : https://urlz.fr/gIsW
Pour aller plus loin…
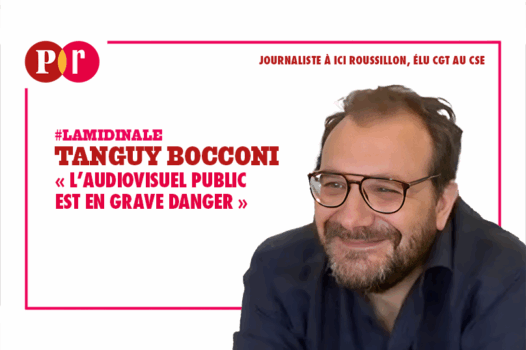
« L’audiovisuel public est en grave danger »

Audiovisuel public : malgré les audiences, une volonté de reprendre la main politiquement

« Les meurtres racistes actuels sont le prolongement du chemin intellectuel de l’AFO »







