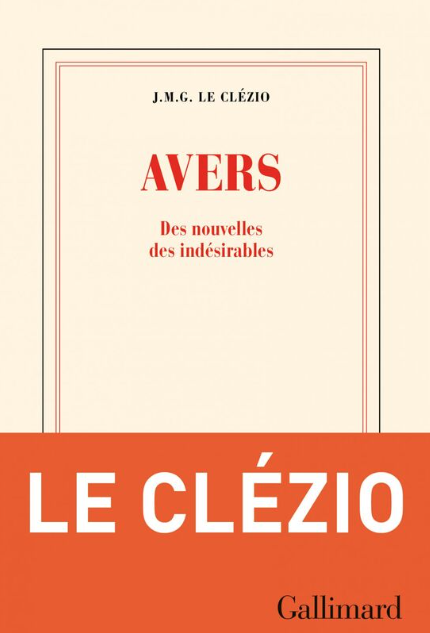« Avers » : soif d’humanité
Dans ce recueil de nouvelles, Jean-Marie Gustave Le Clézio met en scène des enfants et des adultes en proie à la guerre, à la misère et à la froideur des sociétés.
dans l’hebdo N° 1753 Acheter ce numéro

© Ulf Andersen / Aurimages / AFP.
Avers. Des nouvelles des indésirables / Jean-Marie Gustave Le Clézio / Gallimard / 221 pages / 19,50 euros.
L’avers et le revers sont les deux côtés d’une même pièce mais ne sont pas égaux. Le premier est considéré comme la face noble, offerte au regard ; le second, non visible immédiatement, draine en outre des significations négatives qui renvoient à l’échec, au malheur. Le mot « avers » donne son titre au livre de Jean-Marie Gustave Le Clézio et à sa nouvelle inaugurale, et apparaît une fois dans le corps des textes, précisément dans la première histoire, celle de la jeune Maureez Samson.
Cet « avers » concerne une médaille en or que celle-ci détient de son père pêcheur, sur une île au large de Maurice, dont le destin a voulu qu’il disparaisse en mer. Il la lui avait offerte en guise d’objet protecteur, non en raison de ce qui apparaît aux yeux de toutes les autres personnes : la valeur de son métal précieux.
Voilà bien une métaphore : l’avers, chez Le Clézio, n’est pas la face riche, luxueuse du monde, tandis que le revers en porterait la face sombre. Son avers est au contraire peuplé d’« indésirables » qui auraient tous bien besoin d’un talisman protecteur, ballottés qu’ils sont au milieu d’une guerre, misérables dans une société replète ou écrasés sous la botte du crime organisé.
Les plus petits signes de respect
Des indésirables en quête, souvent vaine, du nécessaire, pas seulement matériel, mais des sentiments les plus essentiels – l’amour, la solidarité – ou même des plus petits signes de respect, comme le simple fait d’être considéré comme une personne humaine.
Il y a aussi parfois l’existence, au loin, d’« un autre côté », un autre visage du même monde terrestre, un pays de cocagne où « il n’y avait pas la guerre, pas de voleurs », mais plus qu’hypothétique, comme le suggère le sort de cette femme qui s’est lancée dans le grand voyage : « Elle n’a plus donné de nouvelles, et tout le monde a pensé qu’elle était arrivée là-bas, de l’autre côté. Ou bien elle est morte, et c’est pareil. »
Plusieurs des protagonistes d’Avers sont des enfants. On ne s’en étonnera guère chez Jean-Marie Gustave Le Clézio, où ils figurent déjà dans nombre de ses livres. L’auteur semble nous glisser cette question à l’oreille : imagine-t-on ce que subissent tant d’entre eux ici comme ailleurs ?
« Tous les garçons qui erraient sur les routes, d’un camp à l’autre, tous ceux qu’il rencontrait à l’aventure parlaient ainsi, en insultant leur mère et leurs sœurs, mais cela se voyait tout de suite qu’ils n’avaient jamais eu de mère, ni de sœur, ni personne », lit-on dans la nouvelle intitulée « Hanné » mettant en scène un gamin de douze ou treize ans dans un Liban à feu et à sang.
Dans « La Pichancha », Le Clézio décrit une petite bande de gosses mexicains qui sont autant d’enfants martyrs : « Le plus sournois, le plus violent, c’est Bravo, on dit même qu’à treize ans il a déjà tué un homme, un adulte qui voulait le baiser au fond d’un tunnel […], la Nutria qui est un peu demeurée, il lui manque les dents de devant parce que son père la bat… » Quant aux petits migrants échoués dans les rues de Paris (« Fantômes dans la rue »), ils ne sont pas beaucoup mieux lotis.
Profonde empathie
Comme les loups que croisent Chuche et Juanico dans « Chemin lumineux », et contrairement aux « guerriers » et aux « policiers des frontières », J.M.G. Le Clézio se met sans l’ombre d’une hésitation du côté des enfants et de tous les indésirables. S’il est un défenseur du brassage et du multiculturalisme (lire, notamment, Quinze Causeries en Chine (1), ses passionnants essais sur la littérature), les cruelles injustices occasionnées par la globalisation capitaliste, obsessionnellement matérialiste, le révoltent – s’il fallait s’en convaincre, les quelques lignes de sa plume sur la quatrième de couverture en attestent.
Gallimard, 2019.
Ce qui se traduit dans son regard d’écrivain par une attention particulière à leur endroit, et même davantage : une profonde empathie. De la même façon qu’au cinéma Robert Guédiguian, après Pasolini, fait des gens de la plèbe des héros du quotidien, Jean-Marie Gustave Le Clézio dévoile l’humanité de ces indésirables dans toute son intensité, sa complexité et son innocence.
Ce n’est pas parce que certains de ces textes ont initialement paru dans des publications de l’Unesco ou d’Amnesty International que l’auteur ferait de la littérature « humanitaire ». Son œuvre constitue en soi un havre d’accueil inconditionnel et un manifeste de liberté farouche. Loin d’être saint-sulpicienne, elle est au contraire d’une lumineuse intransigeance.
Maureez Samson, désormais orpheline, s’échappe des griffes de sa belle-mère maltraitante et de son beau-père incestueux, et, grâce à d’heureuses rencontres, découvre la beauté qui est en elle : sa voix de chanteuse enchanteresse. La musique est pour elle « une façon d’être loin, d’oublier les mauvais moments de sa vie, de se libérer » (« Avers »).
Deux enfants en cavale dans un pays d’Amérique centrale, dont la plus âgée est une adolescente, enceinte d’un soldat qui l’a « violée chaque jour », se sont échappés du camp où « la Migra », l’office d’immigration états-unien, les a enfermés. Ils trouvent l’hospitalité au bout de leur dangereux parcours (« Chemin lumineux »).
Voilà ce que racontent les deux premières nouvelles. À leur manière, avec leur fin heureuse, ce sont des contes. Toutes n’ont pas une telle issue. Dans « La Pichancha », une petite bande habituée à passer la frontière qui sépare le Mexique du « pays des gringos » par le boyau étroit et suant la merde des égouts, dans le but de chaparder des babioles, ne tarde pas à se faire pincer et reconduire à son point de départ.
Poussant les gamins dans le combi de retour vers le Mexique, un policier s’écrie : « Putain de vos mères, ça pue le rat là-dedans ! » De l’autre côté, résidentiel, raciste et anti-pauvres, personne ne veut de ces « nuisibles ». Reste l’imagination pour se donner un semblant d’existence dans ce monde-là. Ainsi, l’un des garçons, Bravo, pense que, dans le parc où flottait « l’odeur sucrée des cotonniers », la jeune et jolie Américaine qui a miraculeusement posé ses yeux sur lui « tournera son regard pâle pour chercher du côté des grands arbres, et lui n’y sera pas ».
L’effréné désir d’un monde autre
Deux nouvelles, parmi les plus longues, se distinguent par leur forme. La singularité de la première tient dans son point de vue. Il y est décrit un morceau de trottoir parisien, toujours le même. Et pour cause : il s’agit de la vision d’une caméra de surveillance. Fait peu commun – mais la fantasmagorie n’est jamais loin chez Le Clézio –, cette caméra, douée de conscience, parle. Elle est la seule à vraiment regarder, sans jugement, « les fantômes de la rue » (titre de la nouvelle) qui y ont leur point d’attache, environnés d’« un très grand sentiment de solitude ».
Tout aussi exceptionnelle, la seconde, intitulée « Etrebbema », conclut le volume en déclinant à sa façon l’antagonisme avers/revers. C’est comme si ce texte était construit à la manière d’un gant que l’on retourne : au début, un homme, élevé par les Blancs, pénètre dans la forêt, retrouve son identité indienne et participe à l’épanouissement de sa communauté.
Puis tout bascule avec l’arrivée des narcotrafiquants, semeurs de néant. Cette même forêt devient un cimetière, et un rideau tombe sur « ceux qui vivaient dans ce pays depuis toujours, ceux qui avaient inventé une société autonome, logique, originale, les Emberá et les Waunana, les peuples indiens ».
Tout au long d’Avers, le sentiment du lecteur est étrangement double : heurté par la dureté de la vie de ces indésirables, il est aussi enveloppé par le ravissement que le texte produit. Il ne s’agit en rien d’une esthétisation de la misère. L’auteur a un tel goût des noms de partout et des diverses langues parlées aux quatre coins du globe qu’il invente ainsi une poésie tour-de-babélienne.
Surtout, l’acuité de sa langue alliée à sa simplicité et à sa non-effusion donne l’impression que chaque mot est à sa place. Que tous sont le fruit d’une maturation immémoriale. La langue chez Le Clézio est l’incarnation de l’effréné désir d’un monde autre.
Pour aller plus loin…

« Les Voleurs d’ampoules », une traversée initiatique

« La Ville » : qui sont vraiment les zombies ?
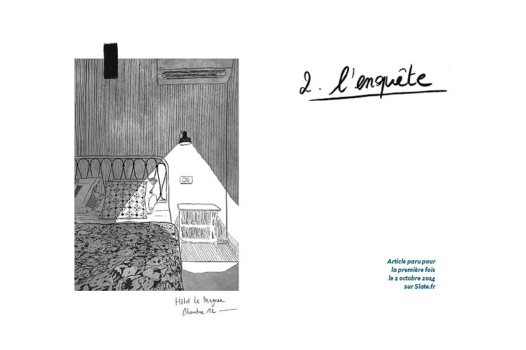
« Écrire Mazan » : avec Gisèle Pelicot, sortir de la sidération