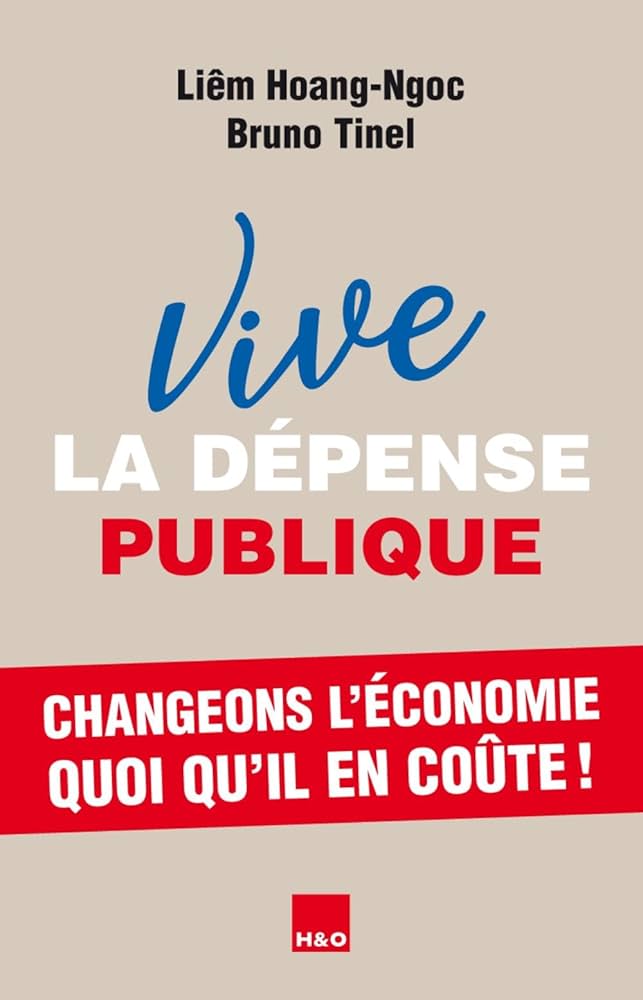Les vrais chiffres de la dépense publique
À l’heure où le premier ministre annonce pour 2026 un nouveau plan d’austérité de 40 milliards d’euros, de nouvelles coupes dans les dépenses auraient un effet désastreux pour nos services publics.
dans l’hebdo N° 1860 Acheter ce numéro

© Clément MAHOUDEAU / AFP
Le discours anxiogène sur la dette publique présente la France comme un pays quasi soviétique, dont la part des dépenses publiques s’élèverait à 57 % du PIB. Cet indicateur sous-entend que, symétriquement, la part de la dépense privée ne serait que de 43 %. Avec Bruno Tinel, nous avons montré (dans Vive la dépense publique, H&O, 2021) en quoi la méthode utilisée pour aboutir à ce chiffre était erronée et menait à une dépense privée atteignant 260 % du PIB !
Les dépenses régaliennes, de santé et d’éducation ont une part dans le PIB qui ne croît plus depuis 2008.
Un indicateur rigoureusement conforme à l’approche dite « par la dépense », en comptabilité nationale, doit strictement tenir compte de la consommation finale et de la formation brute de capital fixe des administrations publiques. La part des dépenses publiques se limite alors à 27 % du PIB. Elle est comparable (bien que de deux points supérieure) à ce que l’on observe en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni. Conséquence d’un choix de société où le périmètre des services publics est plus important en France, elle se situe 8,5 points au-dessus du taux qui prévaut aux États-Unis (18,5 %).
Néanmoins, les données illustrent la tendance récente à réduire la part des dépenses publiques dans le PIB, en application des règlements et directives imposant aux États membres de la zone euro de faire progresser leurs dépenses publiques à un rythme inférieur au taux de croissance potentiel de l’économie. En France, les dépenses publiques croissent désormais à un rythme moyen de 1 % par an, alors que le taux de croissance potentiel est estimé à 1,35 %. L’examen des différentes composantes de la dépense publique est riche d’enseignements.
La consommation finale des administrations publiques mesure la valeur des prestations fournies au coût des facteurs (rémunération des fonctionnaires, coût des techniques). Elles comprennent les dépenses régaliennes, de santé et d’éducation. Leur part dans le PIB ne croît plus depuis 2008. Les dépenses de santé croissent certes, en raison du vieillissement de la population et du coût des techniques médicales, mais insuffisamment pour faire face à la demande de soins et à la désertification médicale. Les dépenses d’éducation par élève décroissent.
L’évolution de l’investissement public est préoccupante.
C’est inquiétant car ces dépenses représentent des investissements en capital humain : elles préparent une main-d’œuvre mieux formée, plus robuste et donc plus productive. L’idée, propagée par les adversaires des services publics, selon laquelle les dépenses de fonctionnement sont, contrairement aux dépenses d’investissement, improductives, est d’autant plus fallacieuse que les premières sont complémentaires des secondes : on ne saurait construire d’écoles, de lycées et d’université sans enseignants, ni d’hôpitaux sans personnel soignant !
L’évolution de l’investissement public n’en est pas moins préoccupante. Le taux de croissance de la formation brute de capital fixe (FBCF) des administrations publiques est nul depuis 2003 et la part de l’investissement public dans la FBCF totale a baissé de 4 %. La détérioration de nos infrastructures sanitaires, scolaires, universitaires, de logement et de transport en est l’illustration. À l’heure où le premier ministre annonce pour 2026 un nouveau plan d’austérité de 40 milliards d’euros, de nouvelles coupes dans les dépenses auraient un effet désastreux pour nos services publics.
Chaque semaine, nous donnons la parole à des économistes hétérodoxes dont nous partageons les constats… et les combats. Parce que, croyez-le ou non, d’autres politiques économiques sont possibles.
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…

Le modèle extractiviste vénézuélien, tout sauf une référence
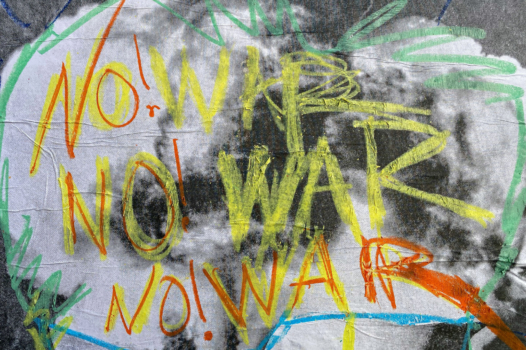
Guerre et capitalisme

L’ère du capitalobscène