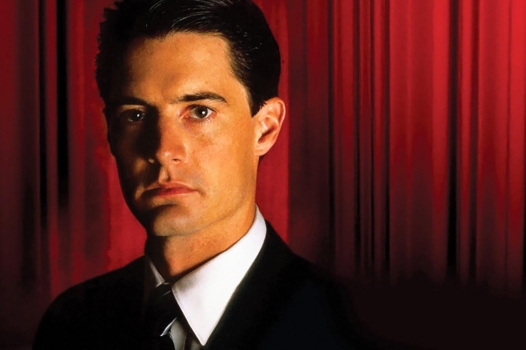« Un simple accident », une torture sans fin
Palme d’or à Cannes, le film pose des questions essentielles sur le Mal et le recours à la vengeance.
dans l’hebdo N° 1882 Acheter ce numéro

© Les Films Pelleas
Le hasard fait que Vahid (Vahid Mobasseri) se retrouve en présence du sadique tortionnaire auquel il était soumis quand il croupissait en prison après avoir manifesté dans les rues de Téhéran pour de meilleures conditions de vie. Pour Vahid, Eghbal (Ebrahim Azizi) est reconnaissable entre tous : doté d’une jambe de bois, il émet un léger grincement à chaque pas – un son qui permet de jouer sur le hors-champ : la première fois que Vahid le reconnaît, la caméra est sur le visage de celui-ci, qui se décompose.
Ce petit homme souffreteux décide de kidnapper Eghbal pour le rayer de la carte des vivants. Mais au dernier moment un doute le saisit : est-ce bien lui, est-ce bien son bourreau ? Afin d’en avoir le cœur net, Vahid va à la rencontre d’autres de ses victimes pour leur demander de le reconnaître.
Tourné clandestinement, Un simple accident, qui s’est vu décerner la Palme d’or au dernier Festival de Cannes, est d’abord un hommage aux détenus que Jafar Panahi a côtoyés lors de son dernier séjour en prison et avec lesquels il a beaucoup échangé. Quelques-uns des sévices qui lui ont été rapportés sont ceux que les personnages du film, Shiva (Maryam Afshari), Golrokh ou Marié (Majid Panahi) ont subis, de même que Vahid, surnommé « La cruche » tant il se tient fréquemment les reins de douleur.
Les séquelles psychiques sont cependant les plus lourdes. Golrokh (Hadis Pakbaten), en robe de mariée au moment où Vahid est venu à sa rencontre – ce qui offre un décalage visuel abyssal entre son présent et le passé qui la hante –, raconte comment, un jour, on lui a passé une corde autour du cou en lui faisant croire qu’elle serait pendue sur-le-champ, une torture qui a duré des heures.
Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :
Pour aller plus loin…

« Soulèvements », le bien commun en héritage

Thomas Lacoste : « Créer un pare-feu autour de ceux qu’on a érigés en “écoterroristes” »

« Urchin » : marcher sur un fil