Les patient·es ont des droits
Cette tribune, cosignée par l’Observatoire féministe des violences médicales, des associations de santé communautaire, des collectifs de patient·es, des professionnel·les de santé, des membres de la société civile et des institutions partenaires, demande un affichage des droits des patient·es dans tous les lieux de soins.

© Miguel Ausejo / Unsplash
Qui n’a jamais eu l’impression, lors d’un rendez-vous médical, que quelque chose n’allait pas ? Votre parole est coupée, vos douleurs sont minimisées, un examen vous est imposé sans vraiment vous demander votre avis. On vous parle comme à un enfant, votre accent ou votre corps peuvent faire l’objet de remarques et de moqueries.
Ces situations, beaucoup les ont vécues. Ces gestes, ces mots, ces négligences, qu’ils soient volontaires ou non, portent un nom : les violences médicales. Elles varient en gravité mais les plus subtiles et d’apparence ordinaire peuvent conduire aux violences les plus graves, s’exerçant sans être remises en question.
Ces violences peuvent être directes telles que les agressions physiques, verbales, sexuelles, les refus de soin. Elles peuvent aussi être indirectes : vous n’êtes pas écouté.e, votre parole est remise en question, votre douleur est négligée, vous n’êtes pas informé.e des risques, bénéfices et alternatives d’actes médicaux, vous ne pouvez connaître le nom d’un.e soignant·e…
Certaines de ces pratiques ne sont pas toujours exercées avec l’intention de nuire, mais elles n’en sont pas moins violentes dans leurs effets. C’est notamment le cas dans certains contextes de violences obstétricales et gynécologiques, où des gestes routiniers, rarement interrogés, peuvent entraîner une souffrance réelle, une perte de confiance ou des traumatismes durables.
« Ce n’est pas si grave »
Les violences médicales ne sont pas des faits isolés. Elles se déroulent à huis clos, dans les moments où l’on est le plus vulnérable, parfois sans témoin et sans recours. Et pourtant, chaque patient·e devrait être accueilli·e, écouté·e et soigné·e dans le respect de sa dignité et de ses droits.
En France, 40 % des patient·es répondant.es à une enquête interassociative portée par le Mouvement en 2018 déclarent avoir déjà été victimes de propos sexistes, grossophobes, racistes, homophobes ou moqueurs dans le système de santé.
Selon une étude de Santé Publique France, près d’1 personne LGBT sur 5 déclare avoir vécu un épisode homophobe dans son parcours de soins ayant dans la majorité des cas comme conséquence des ruptures et/ou des renoncements aux soins. Ces violences verbales, psychologiques, parfois physiques ou institutionnelles conduisent à la peur, à la défiance, à l’isolement, à l’éloignement des soins et parfois à la mort.
En 2022, l’équipe du CHU de Montpellier portée par Xavier Bobbia a ainsi démontré qu’aux urgences, un homme blanc a 50 % de chances de plus qu’une femme noire d’être considéré comme une urgence vitale, face à des symptômes identiques. Ces chiffres font échos à l’affaire Naomi Musenga, décédée après avoir été moquée et non prise au sérieux par le SAMU. Depuis, combien de vies ont encore été brisées ?
Combien ont déjà entendu : « Vous exagérez », « Ce n’est pas si grave », « On ne peut rien pour vous », sans connaître leurs droits ni les recours possibles ? Pourtant ces droits existent. Ils sont inscrits dans la loi : articles L1110-1 à L1110-13 du Code de la santé publique et la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Ils garantissent notamment le respect de son autonomie, la dignité dans le soin, le droit d’être informé·e, de consentir ou de refuser un acte médical.
Alors que la Défenseure des droits rappelle que la connaissance des droits des patient·es doit être renforcée pour consolider leur capacité d’agir, l’affichage de ces droits reste quasiment absent des lieux de soins.
Après une concertation avec de nombreuses associations et acteur·ices du système de soin, elle recommande clairement de généraliser les actions de sensibilisation à la non-discrimination, notamment par l’affichage systématique dans tous les espaces de santé, avec une information facile à comprendre et adaptée à tou·tes.
Une Charte de la personne hospitalisée existe dans tous les établissements de santé (publics et privés) — parfois appelée « charte des usager·es ». Pourtant, elle demeure trop souvent difficile d’accès : affichée dans des espaces peu visibles, rédigée dans un langage technique, ou seulement disponible sur demande. Cette faible accessibilité entretient une asymétrie d’information entre soignant·es et patient·es et limite l’effectivité des droits.
La santé, un droit fondamental
Nous demandons aux pouvoirs publics, aux établissements de santé et aux professionnel·les de s’engager pour un affichage clair, visible et compréhensible des droits des patient·es dans tous les lieux de soins, sans exception : signalétique dédiée à hauteur d’œil, version FALC (facile à lire et à comprendre), interprétariat/LSF, traductions, QR code vers la version numérique et possibilité de remise du document lors de l’accueil.
Cet affichage doit inclure :
- Le droit à l’interprétariat pour les personnes qui ne maîtrisent pas le français
- Le droit à l’accès à l’information des personnes sourdes avec transcription écrite et interprétariat en LSF à l’hôpital
- Le droit à l’information et au consentement libre et éclairé pour tout acte médical
- Le droit à l’intimité et à la confidentialité des informations
- Le droit à l’accessibilité des personnes handicapées (libre circulation, signalétique, matériel adapté, protection sanitaire type masques…)
- Le droit d’être soigné·e sans discrimination, quelle que soit sa situation médicale et/ou administrative, sa religion, son apparence, son origine, son genre..
- Le droit d’être accompagné·e par la personne de son choix lors d’une consultation, sauf dans les situations où un temps d’échange individuel est nécessaire pour garantir votre sécurité ou votre expression libre (par exemple, en cas de suspicion de violences).
- Le droit de réclamation : rappel des textes de loi qui protègent les patient·es et des numéros verts et contacts pour obtenir des informations juridiques ou signaler une discrimination
La santé est un droit fondamental, pas un privilège. Chaque patient·e mérite d’être respecté·e, écouté·e et protégé·e. Parce que le silence tue, nous devons afficher et faire vivre ces droits, partout, pour toutes et tous.
Rejoignez-nous, interpellez vos établissements de santé, signez la pétition, partagez ce message. Ensemble, exigeons que chaque établissement de santé, chaque professionnel·le, chaque institution assume sa responsabilité : plus jamais personne ne doit rester seul·e face à la violence ou à la discrimination dans le soin.
Signataires
Cette tribune est signée par plus de 50 personnes et organisation, dont des soignantEs, patient.es, chercheur.ses, membres de la société civile, syndicats et associations :
- Union syndicale Solidaires
- Fédération SUD Santé Sociaux
- SNJMG Syndicat national des jeunes médecins généralistes
- Afrique Avenir
- Association GRASbuge
- Lallab
- Balance ta Bandelette
- Stop aux Violences Obstétricales et Gynécologiques
- Gras Politique
- Tant que je serai noire
- Pride des Banlieues
- Association Winslow Santé Publique
- Carré Citoyen
- Réseau des Féministes du Sénégal
- Collectif #NousToutes
- Fable-Lab
- Génération Panasiatique
- Féministes contre le cyberharcèlement
- Noustoutes 93 antiraciste
- Les Aliennes
- Association Winslow Santé Publique
- Fatou Dieng membre du Comité Vérité et Justice pour Lamine Dieng / Réseau d’Entraide Vérité et Justice
- Pelphine @corpscools, co-fondatrice de Fat Friendly
- Mame-Fatou Diop Nintcheu, médecin généraliste
- Sophie Xie, médecin
- Dora Lévy, médecin
- Jalel Malek Hamza, pédiatre et membre de l’assemblée pour des soins antiracistes et populaires
- Haya Diakité, cheffe de projet intervention sociale
- Kami Mathiasin, psychologue
- Sushina Lagouje, autrice
- Audrey Teko, chercheuse en sociologie
- Thulaciga Yoganathan, chercheuse membre d’Arokiyam pour tous.tes
- Léa Ballot, Voix de femmes,
- Alizéa Habib, Mains Violettes Caen
- Louise Virolle, maître de conférences en sociologie, Université Paris Cité
- Nadège Erikan écrivaine
- Nina Faure, réalisatrice
Des contributions pour alimenter le débat, au sein de la gauche ou plus largement, et pour donner de l’écho à des mobilisations. Ces textes ne reflètent pas nécessairement la position de la rédaction.
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…
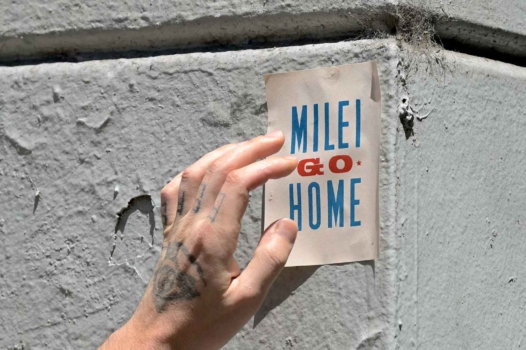
Contre la loi travail XXL de Milei, solidarité avec le monde du travail en Argentine !

750 universitaires et artistes appellent le gouvernement à accueillir leurs homologues de Gaza

Présidentielle 2027 : l’illusoire stratégie du « bloc bourgeois »








