Mario Rigoni Stern, l’homme que « la Méduse n’avait pas pétrifié »
François Maspero rend hommage à l’écrivain italien récemment disparu, grand témoin de la Deuxième Guerre mondiale et auteur d’une œuvre plongée dans les secrets de la nature et les errances de la mémoire.
dans l’hebdo N° 1009 Acheter ce numéro
Avec Mario Rigoni Stern, qui vient de mourir à 87 ans dans son village du haut plateau d’Asagio, près de la frontière autrichienne, disparaît l’un des grands témoins de la Deuxième Guerre mondiale, telle que l’a vécue une génération de jeunes Italiens envoyés au massacre par la volonté délirante du régime fasciste. Témoin au même titre que Primo Levi, qui fut son ami, ou son autre ami Nuto Revelli, que l’on ne connaît malheureusement en France que par son Monde des vaincus et un court récit, ou encore Renzo Biasion, dont l’admirable S’agapo a été enfin publié en France cette année. Tous avaient en commun de ne pas avoir pensé, au départ, suivre une carrière d’écrivain. Tous voulaient seulement, survivants de la barbarie, témoigner coûte que coûte de ce qui, dans l’immédiat après-guerre, semblait condamné à rester indicible.
En 2001, sous la neige à Bourg-Saint-Maurice, où Mario Rigoni Stern avait combattu en juin 1940. Clatot/AFP
Avec lui disparaît aussi l’un des représentants de cette littérature du Nord de l’Italie qui a jadis donné des grands écrivains tels que Cesare Pavese, Lala Romano, Natalia Ginzburg ou, plus récemment, Francesco Biamonti : ces narrateurs parlaient de leur terre et des leurs sur le ton de la confidence, savaient dépasser le régionalisme et atteindre à l’universel. Les livres de Rigoni Stern sont comme des contes chuchotés à voix basse, dans lesquels, chemins faisant – des chemins qui ne sont souvent que des sentiers perdus dans les forêts ou dans la neige –, il confie au lecteur tout ce qu’il a vécu de la beauté comme de l’horreur du monde.
Lorsque paraît en 1953 son premier livre, le Sergent dans la neige (traduit plus tard dans la collection « 10/18 »), l’Italie est encore réticente à revenir sur un passé de souffrances, celles de la guerre de Grèce et d’Albanie, de la campagne de Russie, de l’emprisonnement des soldats italiens en Allemagne après le retournement d’alliances, de la déportation des Juifs, de la dure résistance des partisans, qui ont fait des centaines de milliers de morts dans la jeunesse italienne. L’Albanie, la Russie, l’Allemagne, Rigoni Stern les a subies et en reste marqué dans son âme et sa chair. Son obsession est de garder vivant le souvenir de ses camarades disparus, non comme un ancien combattant professionnel défilant chaque année drapeau à la main, mais comme le dépositaire d’une mémoire douloureuse, tourmentée et souvent bafouée, qu’il refuse de voir mourir. Mémoire vivante, parce que, affirme-t-il à Primo Levi, « la Méduse ne nous a pas pétrifiés ». En 1953, le temps semble être enfin venu de lever le silence. Livre après livre, Rigoni Stern connaîtra le succès : son dernier, Saisons, qui paraîtra en France à la rentrée, s’est vendu dans son pays à 200 000 exemplaires. Mais il ne quittera jamais ses montagnes et ses forêts natales, tout comme, jusqu’à sa retraite, il continuera d’exercer son travail d’employé au cadastre.
« J’aime aller avec mes souvenirs par les sentiers et les chemins forestiers ; j’observe, j’écoute aussi, les signaux qu’envoie la nature au fil des saisons et des ans. Mais c’est lorsque je me fais accompagner de mes amis ou de personnages de ma terre que la promenade devient plus méditative et plus intense. Ces compagnons de marche ne sont plus présents physiquement, leurs corps sont restés en des lieux lointains… C’est avec eux que je marche et que je discute, et les souvenirs remontent. » Toute l’œuvre de Rigoni Stern est marquée par un constant va-et-vient entre l’amour de la terre natale, celle qui reste son présent vivant et quotidien, et l’évocation tout aussi vivante et quotidienne du passé. La terre natale, c’est un pays d’altitude, bien particulier, où l’on ne parlait pas l’italien mais le cimbre, une langue germanique venue de très loin, et où partout affleuraient, parmi tant de cicatrices, celles des combats acharnés de la Première Guerre mondiale : des cicatrices qu’il n’a cessé d’explorer dans son enfance nourrie des récits des anciens, et qu’il évoquera dans l’Année de la victoire (Robert Laffont). Le passé, c’est tout ce qu’il a vécu avec les ombres qui l’accompagnent, et qui renaît au détour du sentier, à partir parfois de minuscules détails, mousse sur un tronc, envol d’un coq de bruyère, passage d’un écureuil, traces de chevreuil dans la neige, amitié d’un chien fidèle. Une lente méditation, presque une prière laïque, pour ne pas dire panthéiste, devant les secrets de la nature et ceux des êtres humains.
Ainsi sont nés, entre autres, Arbres en liberté, le Livre des animaux, Sentiers sous la neige, Hommes, Bois, Abeilles, En guerre, En attendant l’aube, le Vin de la vie, la Dernière Partie de cartes (tous traduits aux éditions de la Fosse aux ours). « Une courte évocation », parmi bien d’autres, que l’on lira dans Saisons (chez le même éditeur), donne la mesure des permanentes réminiscences qui nourrissent ses récits : c’est, au chapitre « Hiver », l’apparition, aux premiers froids, du troglodyte mignon, « touffe ramassée de plumes » dont « le cri ressemble à un léger coup de clochette d’argent ». Mais pas question d’en rester aux charmes de l’hiver. Car surgit aussitôt le récit de la dure survie des partisans dans le terrible hiver 1944, qui crèvent de faim dans les profondeurs de la forêt et que vient visiter l’oiseau. « Je vais faire un lacet avec mes cheveux et le manger avec la polenta » , dit l’un. Et un autre, « connu pour sa férocité envers les fascistes et les Allemands, qui avaient tué son père sur le seuil de sa maison » , murmure : « Si tu fais ça, je te descends comme un fasciste. »
Au terme d’une lecture de Rigoni Stern, celui qui a suivi les tours et les détours enchevêtrés de ses errances dans la forêt des arbres et dans celle du souvenir éprouve comme une forme de libération à la fois de la gangue de journées trop identiques et de celle d’une mémoire trop figée. Travail de Sisyphe peut-être, chaque fois recommencé, mais magie aussi, où le rocher deviendrait si aérien que l’on pourrait même imaginer Sisyphe, sinon heureux comme le suggérait Camus, du moins réconforté. Et le lecteur avec lui. C’est dire combien on aura bien besoin d’autres Rigoni Stern.
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…

« Les Voleurs d’ampoules », une traversée initiatique

« La Ville » : qui sont vraiment les zombies ?
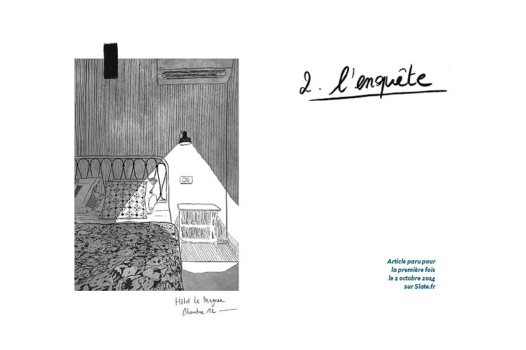
« Écrire Mazan » : avec Gisèle Pelicot, sortir de la sidération









