Maylis de Kerangal : « Le roman, c’est le réel filtré par la langue »
Depuis sa sortie il y a deux mois, Réparer les vivants connaît un succès critique autant que public. L’auteure revient ici sur l’accueil de son livre par les lecteurs et sur ses choix d’écriture.
dans l’hebdo N° 1295 Acheter ce numéro

Les critiques, les libraires, les lecteurs… L’enthousiasme a été unanime pour Réparer les vivants, sorti en janvier, et qui, depuis, n’a plus quitté le haut des meilleures ventes[[Le livre vient d’obtenir
le prix « Roman des étudiants » France Culture/Télérama.]]. On ne saurait trop s’en réjouir, car l’événement est rare quand le roman en question atteint une puissance d’émotion qui ne le doit qu’à son exigence littéraire (voir Politis du 16 janvier). Alors que s’ouvre le Salon du livre à Paris, nous avons voulu revenir avec son auteure, Maylis de Kerangal, sur ce splendide roman, sur son succès, sur ses options esthétiques…
Depuis la sortie du livre, avez-vous fait beaucoup de rencontres avec vos lecteurs ?
Maylis de Kerangal : Oui. Le temps de l’écriture de ce livre a été très solitaire. Mais ensuite, au moment de sa publication, le travail prend une dimension collective. Quand les épreuves circulent et que les libraires réagissent, on établit un programme d’interventions. J’aime accompagner ce livre, d’autant qu’en ce moment la librairie traverse une période difficile : c’est aussi une forme de soutien de ma part, en cohérence avec l’engagement des éditions Verticales en faveur de la librairie.
Actuellement, hors les week-ends, j’ai à peu près une rencontre par jour. C’est un moment de parole publique sur le livre auquel je réfléchis beaucoup. C’est un travail d’éclaircissement pour moi-même. La façon dont le livre est questionné par les lecteurs, qui sont autant des grands lecteurs que des gens qui lisent très peu, me déplace. Mais, bien sûr, ces rencontres doivent trouver un terme dans le temps, car cette exposition pourrait finir par user quelque chose en moi.
Avez-vous, grâce à ces rencontres, une explication sur le succès du livre ?
Je crois que c’est le sujet qui a beaucoup touché. On m’a dit à propos de Naissance d’un pont – mon livre précédent[[Verticales, 2010.
Repris en Folio.]] – qu’il était très, voire trop, technique. Alors que personne n’a été gêné par le vocabulaire technique dans ce livre-ci.
Le sujet de Réparer les vivants interroge la mort, qui concerne au plus près chacun de nous. La greffe d’un cœur est par ailleurs un sujet sociétal, qui peut être évoqué à la télévision. Aimantés par le sujet, les lecteurs – ceux qui ne m’avaient jamais lue – ont découvert l’écriture du roman. Dans la meilleure des hypothèses, celle-ci a relancé le plaisir de lecture.
Pour Réparer les vivants, on ne me pose pas non plus de questions sur les phrases longues, contrairement au précédent. Les lecteurs semblent faire le lien d’eux-mêmes entre la longueur des phrases et la pulsation d’un cœur.
Ne vous semble-t-il pas étrange qu’à l’occasion de débats on puisse vous mettre en présence, par exemple, d’un spécialiste de la chirurgie cardiaque ?
Dans ces cas-là, on n’est pas dans le livre. Le fait de vouloir amener des acteurs réels qui ont à voir avec le sujet du livre crée un débat qui ne concerne pas l’enjeu du roman. Pour moi, l’enjeu du roman n’est pas la restitution du réel. C’est un réel filtré par la langue, la poésie. Il s’agit, lors des rencontres que vous évoquez, de retrouver ce qui, dans le livre, fait trace d’un phénomène social.
C’est le problème des romans à « sujet ». Il se trouve que, pour moi, le sujet survient après un temps où le désir d’écrire se manifeste autrement. Par exemple, pour Naissance d’un pont, j’avais comme désir initial d’être en extérieur, en panoramique, comme dans un western, et au cœur d’une épopée. C’est le sujet qui prend en charge un désir littéraire plutôt qu’une langue qui va habiller un fait de société.
Pour Réparer les vivants , comment vous êtes-vous documentée ?
À l’origine, il y a eu des décès autour de moi, des infarctus, donc des cœurs qui sont tombés, ou des corps qui se sont détruits malgré un cœur très fort. J’ai vu un livre mat, scialytique, c’est-à-dire sans aucune ombre portée. Ce n’était pas une coquetterie. Je voyais un livre où rien ne brillait. Puis le sujet m’est advenu – la transplantation cardiaque –, alors je me suis documentée à fond. Parce que la précision arrache au flou de l’indétermination.
Pour que le roman ait des coups de force calibrés par rapport à la réalité, il faut bien connaître celle-ci. Il y en a deux ou trois dans le livre. Par exemple, le fait que l’action se déroule sur 24 heures, de la mort à la greffe : c’est, dans la réalité, ultra-rapide, mais c’est ce que je voulais, pour des raisons dramaturgiques.
Ma documentation vient d’entretiens que j’ai menés avec un infirmier qui coordonne les prélèvements. Il m’a livré le protocole. J’ai aussi rencontré une personne à l’agence de la biomédecine, qui m’a parlé du serveur informatique qui gère les donneurs et les receveurs, et leur compatibilité. Et j’ai assisté à une transplantation à l’hôpital de la Pitié, qui m’a surtout permis de capter un climat, et m’a mise un peu dans la position de quelqu’un qui attend une greffe, car l’opération, une première fois, a dû être reportée car le greffon n’était pas bon. Par ailleurs, j’ai un frère qui fait de la chirurgie cardio-thoracique, à qui j’ai demandé de vérifier la façon dont je décrivais les opérations.
D’autres lectures, d’un tout autre horizon,b* ont-elles nourri le livre ?
Oui. Celle de Jean-Pierre Vernant, en particulier, sur la mort en Grèce ancienne, ou celle de la Civilisation du cœur, de Jean Nagle, qui a pour sous-titre « Histoire du sentiment politique en France du XIIe au XIXe siècle », un livre formidable où il est question notamment des enterrements de cœurs auxquels on se livrait dans l’aristocratie.
En ce qui concerne le vocabulaire médical et technique, il y avait à mes yeux un enjeu sémantique, qui consistait à ramener dans le littéraire des matériaux qui n’y sont pas a priori. Dit autrement, je pense qu’il n’y a pas de mots, quels qu’ils soient – étrangers, codés, techniques… –, non littéraires.
La dimension mythologique ou légendaire est très présente dans le livre…
Pour moi, la ligne du livre, c’est l’idée du chant. La chanson de geste comme le récit d’un haut fait. Je voulais retrouver ce qui subsiste dans la littérature quand le livre n’était pas encore un livre mais un chant : le chant des aèdes, par exemple. La vague au début du livre, le garçon qui en sort comme un héros grec : il y a en effet une dimension mythologique.
Je souhaitais aussi interroger ce qu’il y a d’archaïque dans notre présent. Une phrase de Georges Didi-Huberman, dont l’œuvre me nourrit beaucoup, m’a frappée : « Le contemporain, c’est quand l’archaïque et le moderne tiennent un rendez-vous secret. »
Pourquoi avoir choisi un narrateur omniscient, qui, par définition, ne connaît pas le doute ? Par exemple, ce narrateur omniscient sait tout de la douleur que ressentent des parents qui viennent de perdre un enfant, ce qui laisse interrogateur…
Un narrateur omniscient permet cette voix, avec laquelle je me sens forte, qu’est la description. Je ne dis pas qu’un « je » narratif ne peut rien décrire. Mais, avec le narrateur omniscient, la phrase agit comme un lasso qui peut tout ramasser. J’ai l’impression d’avoir plus de potentiel, sur la vitesse de narration, en particulier. Certes, le narrateur omniscient a une façon d’imposer un certain point de vue. Mais il en suscite aussi : j’ai placé des digressions et beaucoup de hors-champ dans ce livre. Par ailleurs, je crois à une éthique du regard, qui passe par des hypothèses. Il y a des choses qu’on ne sait pas parce qu’on ne peut pas les savoir.
Où êtes-vous dans Réparer les vivants ?
Depuis trois ou quatre livres, je me dissémine dans plusieurs personnages. C’est très jouissif. Je pourrais dire aussi que je suis surtout dans la langue.
Mais cette question me désarçonne un peu, parce que je crois que la façon dont j’apparais dans mes romans n’est pas réglée. Il y a sans doute un évitement de ma part : je ne suis peut-être pas encore assez solide pour me lancer dans un livre avec un « je » narratif, c’est-à-dire un personnage dont la psyché, le regard, siphonnerait tout le livre. Mais il est probable qu’à l’avenir je resserre sur quelques personnages, voire un seul, avec un « je » narratif, ou sur un mode plus flaubertien, où un seul personnage filtre tout un roman.
Je ne dis pas que je vais faire de l’autofiction, mais peut-être vais-je me rapprocher d’une femme en tant que personnage. Je suis dans une recherche. J’ai l’impression de devenir à chaque livre un écrivain. Ce n’est pas une essence dont je serais dépositaire.
Que pensez-ous de l’autofiction ?
b
L’autofiction relève d’une opération intellectuelle très sophistiquée : ce que je raconte, c’est mon histoire, le « je » narratif, c’est moi, mais c’est un roman, tout est déplacé, je réinvente quelque chose. Cela produit de très beaux textes et désigne ce lieu de liberté qu’est le roman. En ce qui me concerne, je suis plutôt dans la surenchère du romanesque, avec un narrateur omniscient, des sujets étrangers à moi-même, des personnages qui ont des noms de roman très appuyés…
Quand on me dit « Ah, c’est bien, vous, au moins, vous ne vous occupez pas de votre nombril » – avec cette arrière-pensée stupide et moralisatrice que la littérature française serait nombriliste –, cela me vexe. Car je ne parle que d’un rapport au monde qui est le mien.
Pour aller plus loin…

« La Ville » : qui sont vraiment les zombies ?
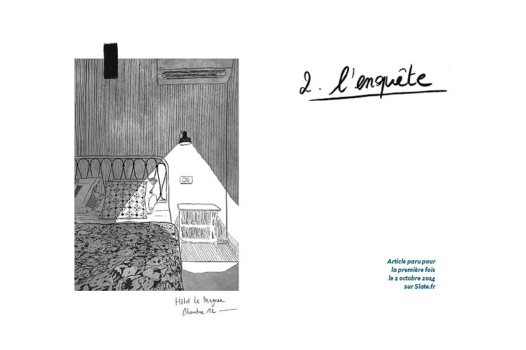
« Écrire Mazan » : avec Gisèle Pelicot, sortir de la sidération

« Correction automatique » : absurdement humain







