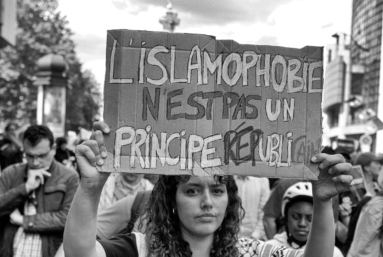La Bosnie des plénums de citoyens
Leurs revendications concernent l’arrêt des privatisations, la répartition du temps de travail, la participation des ouvriers…
dans l’hebdo N° 1300 Acheter ce numéro
En février dernier, la Bosnie-Herzégovine a attiré brièvement l’attention des médias internationaux. Ils ont ajouté au feuilleton mondial des révoltes contre les élites quelques vues de Sarajevo avec affrontements de rue. Depuis, plus rien… Même si Olivier Besancenot, dans la région à la mi-mars, voyait en Tuzla – la ville d’où était parti le mouvement – « la capitale ignorée de l’Europe des travailleurs et des peuples ». L’expérience bosnienne est pourtant exemplaire. Où en est-on, alors que ce mouvement va entrer dans une nouvelle phase, et alors que Sarajevo s’apprête à attirer de nouveau les médias, fin juin, avec la commémoration du centenaire du début de la Première Guerre mondiale ?
Dans le contexte actuel de désintégration sociale qui affecte toute la région, la Bosnie-Herzégovine souffre plus encore que les autres. Le taux de chômage avoisine les 40 % et atteint même 60 % chez les jeunes. La « rationalité » néolibérale a signifié l’enrichissement de quelques-uns (qui depuis la guerre tiennent les leviers de pouvoir) et l’appauvrissement des autres. Car c’est ici que l’effondrement de la fédération yougoslave a été le plus violent. Victime principale de la guerre, le pays s’est retrouvé aussi victime de la paix après les accords de Dayton (1995). Depuis lors, la République de Bosnie Herzégovine comprend deux « entités ». La Republika Srpska (République serbe de Bosnie, 1/3 de la population) et la Federacija Bosne i Hercegovine (Fédération « croato-musulmane », 2/3 de la population), auxquelles s’ajoutent des « Hauts représentants » de l’ONU et de l’Union européenne, avec leur mission militaire Otan-UE. L’existence de ces personnels, bien payés, indique que nous sommes encore dans l’après-guerre. Le système politique bosnien est ethno-confessionnel. La présidence de l’État est assurée à tour de rôle par un représentant d’un des « trois peuples constitutifs » : Serbes (orthodoxes), Croates (catholiques), Bosniaques (musulmans) ; le gouvernement central est formé de représentants des deux « entités ». Les députés sont censés s’exprimer dans l’une des trois « langues officielles » : le bosnien, le croate et le serbe. Mais ils parlent tous la même : Naš jezik (notre langue). Avec ses entités et ses cantons, la Bosnie-Herzégovine compte 14 gouvernements et près de 180 ministres, pour moins de quatre millions d’habitants ! Chaque pouvoir local maîtrise distribution de subsides et emplois publics, contribuant à figer les divisions. Un recensement de la population était censé mesurer l’importance de chaque communauté. Ses résultats, non encore officiels, sont contestés tant les manipulations pour « grossir » telle ou telle communauté sont évidentes.
Le mouvement de février, né de la révolte des ouvriers de Tuzla, s’est répandu dans toutes les villes de la Federacija. Les citoyens mobilisés ont organisé des assemblées pour débattre sur la situation, réfléchir à d’autres modes de gestion : les plénums. Dans l’autre entité, la Republika Srpska, le pouvoir a réussi jusqu’à présent à empêcher l’apparition de plénums […]. Milorad Dodik, le leader local, a présenté le mouvement comme « antiserbe ». Il espère des soutiens financiers russes et considère la situation en Crimée comme un « exemple à suivre ». Les plénums ont fonctionné avec des centaines de participants à chaque réunion. Leurs revendications concernent l’introduction d’un impôt progressif, la baisse des (gros) salaires des représentants politiques, l’impôt sur les bénéfices, l’arrêt des privatisations, la répartition du temps de travail, la nationalisation des banques, l’annulation des privatisations illégales, la participation des ouvriers à la direction des usines… Ils remettent en cause la mauvaise gouvernance des autorités nationales ou locales. Face aux militants des plénums qui manifestaient le 6 avril dernier, marquant à la fois l’anniversaire de la libération de Sarajevo en 1945 et le début de la guerre en 1992, Bakir Izetbegović, membre bosniaque de la présidence, a reconnu que les politiciens n’ont « rien à dire à la jeunesse d’un pays rongé par le chômage ». Les animateurs des plenums ne pensent pas qu’il soit possible de construire un nouveau parti pour les élections d’octobre prochain. Le 9 mai, anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils vont réunir un plénum des plénums pour exposer les revendications prioritaires […]. Va se développer ensuite un travail de conscientisation et d’éducation populaire. […] Comme le remarque le militant de gauche serbe Ivica Mladenović, « les plénums n’ont pas vocation à devenir une alternative à la démocratie parlementaire, ils exercent sur celle-ci un pouvoir avant tout correctif ^2 ».
Le mouvement citoyen bosnien s’interroge aussi sur la tutelle européenne. Le processus « d’intégration » a été vanté comme clé de tous les progrès économiques démocratiques. Mais la politique de l’UE ** a plutôt organisé « la périphérisation » des peuples balkaniques [^3]. Les financements de multiples programmes à l’attention des ONG, « pour la paix et la démocratie », sont restés conformes aux objectifs des bailleurs de fonds, mais pas vraiment en concertation avec les forces locales, et sans privilégier l’auto-organisation. […] L’Événement de paix, qui se tient à Sarajevo du 6 au 9 juin [^4], se veut au contraire construit avec les acteurs locaux. Il s’agit d’une rencontre sur le modèle des forums sociaux mondiaux, d’échanges sur les questions de paix et de sécurité, les conflits passés et présents, l’insécurité pour les personnes et les sociétés, les luttes pour une vie décente. Une rencontre à laquelle participeront des mouvements de Bosnie-Herzégovine, des Balkans occidentaux, d’Europe, de la Méditerranée, du monde.
[^2]: www.contretemps.eu
[^3]: Cf. Catherine Samary : « Les Balkans occidentaux », www.europe-solidaire.org
[^4]: Voir le site www.peaceeventsarajevo2014.eu, ou le Comité français de préparation de Sarajevo 2014 : aec@reseau-ipam.org
Pour aller plus loin…

COP des peuples : un mouvement mondial contre les grands barrages
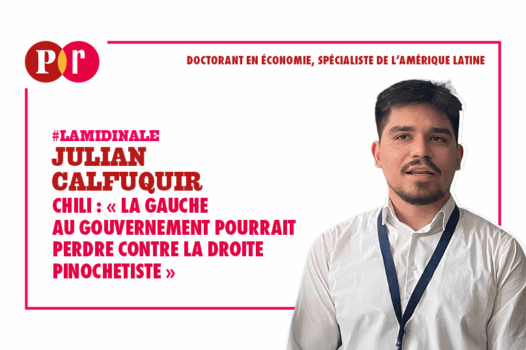
Chili : « La gauche au gouvernement pourrait perdre contre la droite pinochetiste »

Rami Abou Jamous : « On a l’impression que parler de Gaza est devenu un fardeau »