« Si Beale Street pouvait parler » : En blues et noir
Sur les traces de James Baldwin, Barry Jenkins livre avec Si Beale Street pouvait parler un film magnifique où amour et sensualité forgent une critique puissante du racisme.
dans l’hebdo N° 1538 Acheter ce numéro
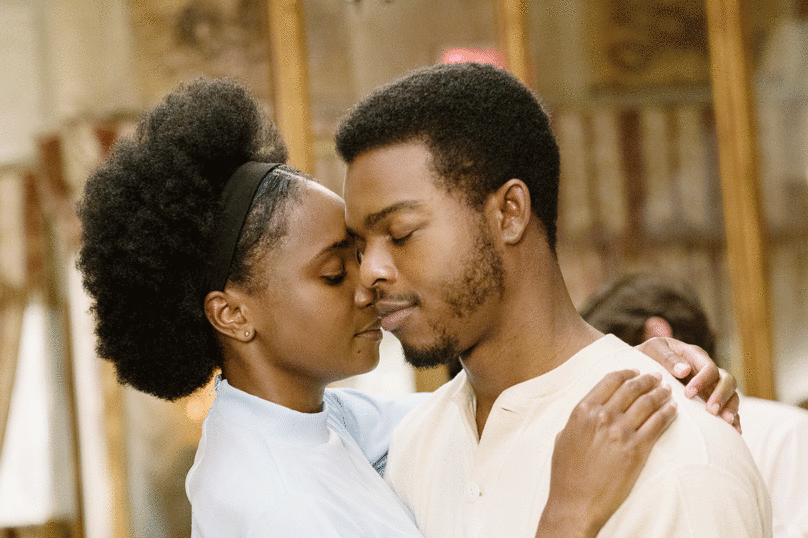
Au cœur de Si Beale Street pouvait parler, le troisième film de Barry Jenkins, dont Moonlight fut oscarisé en 2017, se trouve une scène déchirante qui hante la narration et qui longtemps continue de vivre dans l’esprit du spectateur. Fonny, le personnage principal, est attablé avec son ami d’enfance, Daniel. Leur conversation commence par des banalités puis Daniel se confie, racontant les sévices qu’il a subis en prison, accusé d’un crime qu’il n’a pas commis.
Pour Fonny, la scène est une prémonition. Lui aussi sera envoyé derrière les barreaux, victime d’une bavure policière, séparé de la femme qu’il aime, Tish, la narratrice du film. Lui aussi y sera l’objet de violences, que nous, spectateurs, verrons peu mais qui resteront associées tout au long du film à notre souvenir du regard de Daniel, de son effroi.
Pendant toute la conversation, à côté des personnages, une platine tourne. On entend la trompette de Miles Davis. Blue in Green. Interrogé par le New Yorker sur ce choix, Jenkins a expliqué : « C’est un des standards les plus tristes que j’aie jamais entendus. Je voulais qu’on ait l’impression que le morceau sorte de la bouche de Daniel. »
Le jazz et le blues sont très présents chez James Baldwin, l’auteur de Si Beale Street pouvait parler, que Jenkins, après Robert Guédiguian en 1998 (À la place du cœur), adapte à l’écran. « Souvent dans cette musique, ajoute-t-il, ce qui est heureux ne l’est pas vraiment et ce qui est triste n’est pas triste. Tout repose sur la spécificité de l’expérience, sur l’énergie que le musicien met dans la note ». Il n’y a pas d’idées préconçues mais une œuvre qui cherche à capter la complexité de l’expérience, ses contradictions, sa sensibilité et sa sensualité.
Comme le roman de Baldwin, le film de Barry Jenkins est dénué de tout cliché. C’est là sa force. C’est là aussi que réside sa beauté. Judicieusement, Jenkins n’a pas fait le choix facile de déplacer l’histoire de Baldwin depuis les années 1970 jusqu’à aujourd’hui, ce qui l’aurait amené à insister sur ce que son film soumet avec subtilité : l’actualité de son propos. Bien au contraire, le cinéaste a centré sa narration sur les personnages de Baldwin, des êtres à la fois ordinaires et à contre-courant des idées reçues sur les Africains-Américains dont regorge le cinéma.
Fonny a 22 ans, Tish 19. La jeune femme vient d’une famille aimante, le jeune homme chérit sa relation avec son père. Elle travaille dans une parfumerie. Lui est sculpteur, et le film le montre face à son ouvrage dans la fumée de sa cigarette, sublimé par le regard de sa jeune amante. Tish est enceinte. Les deux ne sont pas mariés, mais la question morale est rapidement évacuée. Ils ont quitté le foyer familial de Harlem pour le West Village, où ils vivent une vie de bohème. Le couple est fou d’amour et la pureté de leur relation est contée par Jenkins avec une sensualité gracieuse renforcée par l’élégante photographie du film, signée James Laxton.
Sur le papier, l’existence de Tish et Fonny pourrait donc être semblable à celle de n’importe quels jeunes Américains étourdis par le foisonnement artistique du New York des années 1970. Seulement, Tish et Fonny sont noirs. Sur les traces de Baldwin, Jenkins montre alors avec une grande finesse comment leurs agissements les plus anodins, lorsqu’ils font les courses, lorsqu’ils cherchent un appartement, quand ils se déplacent dans les rues du West Village, leur amour même, sont perçus comme un affront par le monde extérieur. La manière dont ils se meuvent dans l’espace, les regards tendres qu’ils échangent sont en soi une offense à la structure raciale de la société américaine, qui ne veut tolérer leur liberté. Cette liberté, ladite société la leur fera payer au prix fort. Leur destin est tragique mais rarement le film dépeint leur colère. Souvent, Jenkins préfère filmer leur délicatesse, jamais résignée, qui met en lumière avec une force immense l’absurdité et la violence du racisme.
Si Beale Street pouvait parler, Barry Jenkins, 1 h 59.
Pour aller plus loin…

« Jeunesse (retour au pays) », une parenthèse non enchantée

« Kouté vwa », vivre sans oublier

« En Guinée-Bissau, le Blanc est précédé par son image d’ex-colon »







