Le socialisme dans tous ses sens
Joseph Andras publie deux récits, l’un sur le jeune Hô Chi Minh à Paris, l’autre sur ce que les humains font subir aux animaux.
dans l’hebdo N° 1660 Acheter ce numéro

© SPUTNIK/AFP
Joseph Andras écrit, dès la première page d’Au loin le ciel du Sud, utilisant la deuxième personne du singulier pour s’adresser à lui-même : « Tu n’as jamais chéri que les derniers, les perdants, les foireux, les malfichus, les ignorés et ceux-là, mis bas sous sale étoile, qui pas une broque ne valent. » Dans ses livres précédents, Joseph Andras s’est en effet intéressé à des personnages qui n’avaient pas attiré la lumière : Fernand Iveton, militant du Parti communiste algérien, condamné à mort pendant la guerre d’Algérie sans avoir versé le sang (De nos frères blessés, Actes Sud, 2016), Alphonse Dianou, militant du Front de libération nationale kanak et socialiste, tué avec dix-huit autres Kanaks dans la grotte d’Ouvéa en 1988 (Kanaky, Actes Sud, 2018).
En consacrant l’un des deux récits qu’il fait paraître ces jours-ci à Hô Chi Minh, figure mondiale de l’anti-impérialisme, Joseph Andras aurait-il changé d’avis ? Pas vraiment, car ce n’est pas au président de la République démocratique du Viêt Nam (entre 1945 et 1969) qu’Au loin le ciel du Sud est consacré. Mais à Nguyên Tât Thanh, alias Nguyên Ai Quôc, c’est-à-dire au futur Hô Chi Minh quand il n’était encore qu’un jeune homme – il a 28 ans en 1918 – réfugié en France, y découvrant les luttes entre socialistes et communistes et, déjà activiste, cherchant à faire entendre la cause anticolonialiste.
Joseph Andras tente de suivre son sujet à la trace. « Trace » est le mot qui convient. Que reste-t-il du séjour de Nguyên Tât Thanh dans la capitale entre 1918 et 1923, année où il a rejoint Moscou via Berlin ? Matériellement, rien ou presque : une plaque sur un immeuble du XVIIe arrondissement indiquant que Nguyên Ai Quôc y a vécu de 1921 à 1923. L’auteur a inspecté les biographies, fréquenté les bibliothèques (parfois les mêmes que son héros, comme la bibliothèque Sainte-Geneviève) et s’est rendu partout où il a vécu. Andras dessine ainsi une cartographie du Paris de Nguyên Tât Thanh, qu’il ne raconte jamais de manière linéaire, mais en évoquant telles ou telles luttes politiques ou sociales proches géographiquement de l’endroit où se tient alors le futur Hô Chi Minh. L’itinéraire de Nguyên Tât Thanh s’inscrit dès lors au cœur d’une ville où la mémoire des combats est toujours vivante (ceux de la Commune, notamment). L’auteur, faisant aussi le lien avec le présent, témoigne de ce qui se déroule sous ses yeux, en l’occurrence le mouvement des gilets jaunes manifestant dans les artères parisiennes.
Au loin le ciel du Sud s’affirme ainsi comme l’antithèse du processus d’effacement des traces. D’autant que l’auteur raconte avec précision l’activité militante de Nguyên. Peu au fait des controverses théoriques, il est présent au congrès de Tours, en 1920, en tant que « délégué de l’Indo-Chine », où il prononce un discours décrivant les crimes de la colonisation dans son pays et se terminant sur ses mots : « Camarades, sauvez-nous ! » Le paradoxe – mais en est-ce vraiment un ? –, c’est que beaucoup des grandes figures de la gauche du moment ne furent pas sensibles à la cause défendue par ce jeune homme au « visage creusé, [au] teint cireux, [aux] yeux qui vous sautaient littéralement au visage », comme l’a décrit un ouvrier typographe. L’écho qu’il trouva à Paris ne pouvait lui suffire. En revanche, les services de renseignement, eux, n’ont cessé de le prendre au sérieux. Les innombrables fiches qui le concernent montrent à quel point il fut espionné, sources précieuses aujourd’hui pour mieux connaître Nguyên Tât Thanh à Paris.
D’un récit l’autre, aux sujets pourtant très différents, un mot est commun : « socialisme ». Dans le second livre que Joseph Andras fait paraître, Ainsi nous leur faisons la guerre, il en est question à propos d’un chien martyrisé lors d’une démonstration scientifique en 1903 à l’University College London. Joseph Andras note que les socialistes de ce temps, « marxistes, fabiens, unionistes, travaillistes ou anarchistes », s’accordent sur le fait que le sang des réprouvés, quels qu’ils soient, doit cesser de couler. Or, dans le quartier de Londres où s’organise un meeting dénonçant le traitement subi par le chien, on fait ce lien : « Un chien, ce n’est certes pas un ouvrier, ce n’est certes pas la classe unie qui abattra la loi de l’or, mais un chien, ça ne se massacre pas. […] On dira même que ce petit chien, il est la lutte des classes à lui tout seul. »
De la cohérence, donc, dans les écrits de Joseph Andras, ce qui ne peut surprendre chez cet écrivain sans concession avec ce qu’il croit juste, au point de refuser d’apparaître, récusant ainsi le primat médiatique de l’auteur sur l’œuvre. Pour autant, son écriture n’a rien d’uniforme. Ainsi nous leur faisons la guerre se décline en trois tableaux : le premier se déroule à Londres au début du XXe siècle ; le deuxième met en scène un commando, en 1985 à Los Angeles, délivrant des animaux voués aux expérimentations ; le troisième raconte l’échappée d’une vache tombée d’une bétaillère dans les rues de Charleville-Mézières en 2014. Ce troisième récit en particulier, allégé d’aspects didactiques et ne reposant que sur la description du bovin en proie à un inédit parfum de liberté, permet à la langue de Joseph Andras de se déployer dans toute sa richesse. Moins empreinte d’un lyrisme parfois un peu trop affecté, elle gagne ici en intensité narrative et en poésie concrète. Ainsi nous leur faisons la guerre convainc d’autant plus sur le front de la cause animale qu’il excelle littérairement.
Au loin le ciel du Sud et Ainsi nous leur faisons la guerre, Joseph Andras, Actes Sud, 112 pages et 96 pages, 9,80 euros chacun.
Pour aller plus loin…

« Les Voleurs d’ampoules », une traversée initiatique

« La Ville » : qui sont vraiment les zombies ?
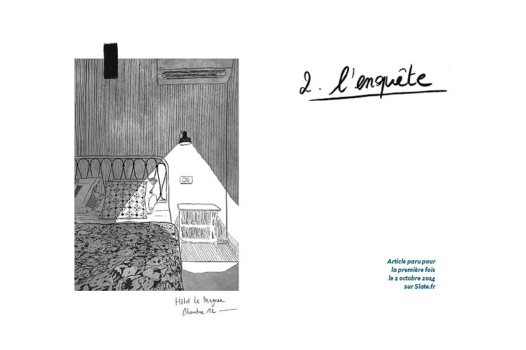
« Écrire Mazan » : avec Gisèle Pelicot, sortir de la sidération







