Quelle victoire ?
Malgré de vraies mesures « de rupture », le Grenelle de l’environnement consacre l’essor d’une écologie soumise au libéralisme. Le chemin des promesses aux actes est plein d’écueils. Analyse et questions.
dans l’hebdo N° 974 Acheter ce numéro
Le Grenelle de l’environnement s’est achevé vendredi dernier dans une euphorie médiatique généralisée et sur un large satisfecit. Le président français, dithyrambique, s’attribue le lancement d’un « New Deal écologique », d’une « révolution verte ». Consécration : Al Gore, le croisé planétaire du climat, en appelle à un « Grenelle mondial ».
Gouvernement, associations, syndicats, collectivités locales, patronat : les partenaires du Grenelle ont tous convenu qu’une rupture était amorcée (voir ci-contre). L’éventail des mesures validées par Nicolas Sarkozy qui détenait la clef du succès fait effet de masse et consacre l’engagement de l’État. Le Président a même poussé jusqu’à défendre le principe de précaution un coup d’arrêt aux spéculations de la Commission Attali sur la croissance , appelant les entreprises à la responsabilité et annonçant le « renversement de la charge de la preuve » : les solutions écologiques n’auront plus à démontrer leurs avantages, les décideurs auront à prouver qu’elles sont inutiles s’ils veulent s’en passer.
Jean-Louis Borloo, à Nantes, le 28 septembre.
TANNEAU/AFP
Il sera difficile de renier demain ces fortes paroles. Mais on aurait tort de les confondre avec l’exercice de la volonté politique. Car, au lendemain du Grenelle, de nombreux écueils pavent le chemin qui va des discours aux actes.
Tout d’abord, les mesures doivent être chiffrées pour définir une vingtaine de programmes concrets pour mi-décembre. Nul ne sait comment l’on va financer la recherche sur les substituts aux pesticides, l’aide à la bio et aux énergies renouvelables, la rénovation thermique des bâtiments, etc., alors que le gouvernement clame son aversion pour tout alourdissement de la « pression fiscale » après avoir octroyé 13 milliards d’euros de cadeau annuel aux contribuables les plus aisés. Il faudrait aussi évaluer la portée réelle des mesures. L’éco-pastille verte favorisant les véhicules sobres sera-t-elle un gadget de plus ?
Ensuite, les vraies négociations avec le monde économique, les élus, l’Europe, etc. ne font que commencer. D’abord, parce que plusieurs restrictions émaillent le catalogue d’annonces réduction des pesticides* « si possible », autoroutes abandonnées « sauf en cas d’intérêt local » , etc. , et que certains calendriers sont irréalistes : comment abandonner en trois ans les lampes à incandescence, qui représentent plus de 70 % du marché français de l’éclairage ?
Mais, au-delà de sa faisabilité, ce Grenelle est une machine à démontrer la thèse du gouvernement : il est possible de rendre la croissance libérale « écolo-compatible », et même de tirer parti de la crise environnementale pour dynamiser la croissance. En effet, les seules mesures fortement consensuelles concernent des chantiers à belles perspectives économiques pour de gros opérateurs privés : rénovation thermique des bâtiments, décollage massif de la bio ou des renouvelables, etc., profilent l’essor d’un « capitalisme vert » décomplexé. En revanche, on cale sur des décisions d’intérêt général, où l’on frise parfois le ridicule : grand flou sur la réduction des pesticides, report des décisions concernant l’incinération des déchets, gel des cultures OGM jusqu’à fin 2007 (il ne contraindra personne !) ou de toute ouverture de nouveaux sites nucléaires (hors sujet…). Quant à l’effort mis sur le TGV, cela signifie un désinvestissement des « petites » lignes, synonymes de permanence du service public.
Enfin, la taxe carbone, emblème d’une approche réglementaire et contraignante, s’est embourbée dans deux « renvois en commission » : son étude à l’échelon européen, ainsi que dans le cadre d’une remise à plat de toute la fiscalité.
Le danger de la réussite gouvernementale de « l’opération Grenelle », c’est que la critique radicale du système libéral, le vrai message de l’écologie politique risque d’être sérieusement muselée pour de longs mois. Les associations et les syndicats les plus remuants ou les Verts vont s’entendre traiter de grincheux : de quoi vous plaignez-vous, puisqu’on va appliquer le Grenelle ?
Pour aller plus loin…

Loi Duplomb : comment le gouvernement éteint les voix paysannes
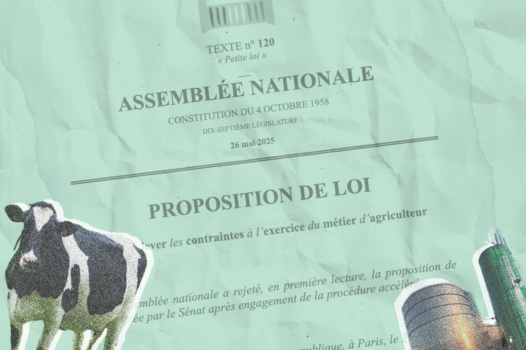
Les cadeaux de Macron à l’agro-industrie

« Stop aux marchands de mort » : au blocage de l’usine Phyteurop, avec les opposants aux pesticides








