« Réfugiés » environnementaux ?
La dénomination est ambiguë, voire contre-productive, met en garde Chloé Vlassopoulou, spécialiste des politiques environnementales à l’université de Picardie*.
dans l’hebdo N° 978 Acheter ce numéro
Les rapports, de divers horizons, annoncent pour bientôt des millions de « réfugiés environnementaux ». Un terme attrape-tout ?
Chloé Vlassopoulou : Je suis critique envers cette désignation je parle pour ma part d’exodes environnementaux. D’abord parce qu’elle est utilisée, par convenance, pour désigner des personnes soumises à des situations très diverses et non définies, et dont le nombre varie entre 10 et 100 millions sur la planète : les apatrides forcés, dont le territoire devient inhabitable c’est le sort prochain de l’archipel de Tuvalu , les déplacés de catastrophes naturelles, les victimes d’accidents industriels, ceux qui fuient les nuisances modernes les riverains d’un aéroport, par exemple, etc. Je trouve hasardeux de mettre toutes ces catégories dans le même panier : cette globalisation semble créer un « statut » de victime d’aléas naturels, exonérant du même coup les responsables de ces situations industriel pollueur, aménageur fautif, etc. Veut-on induire que c’est à la communauté de prendre en charge ces personnes lésées ? Les victimes du cyclone Katrina, il y a deux ans aux États-Unis, relèvent-elles de l’aide internationale ?
Ensuite, le terme de « réfugié » dispose à ce jour d’un cadre juridique et d’une définition scientifique : il s’agit d’une personne déplacée car pourchassée ou persécutée, et qui ne dispose pas de l’aide de son pays. On peut rencontrer ce cas avec la construction de gros barrages, par exemple. Mais de nombreux « réfugiés » environnementaux ne répondent pas à ces critères.
Que révèle cette facilité de langage ?
La confusion ne date pas d’aujourd’hui, puisque la dénomination apparaît dès 1985. Mais elle ne commence à poser problème qu’aujourd’hui, parce que la période est à la xénophobie, à la fermeture des frontières, à la lutte contre l’immigration. Parler de « réfugiés climatiques », c’est brandir la menace d’une invasion, avec tout ce que cela peut justifier en retour comme politiques répressives ou restrictives. C’est pourquoi je mets en garde les écologistes : s’il est opportun de médiatiser ces situations de détresse réelle, il faut éviter les simplifications qui peuvent devenir contre-productives. Inversement, on aura aussitôt fait de justifier la fermeture des frontières, comme en Australie, par exemple, en suspectant les réfugiés d’être eux-mêmes source de problèmes environnementaux : un surcroît de population ferait peser une pression insupportable sur des ressources fragilisées, à l’image des dégradations accompagnant ces camps où s’entassent les réfugiés.
Pour aller plus loin…

Loi Duplomb : comment le gouvernement éteint les voix paysannes
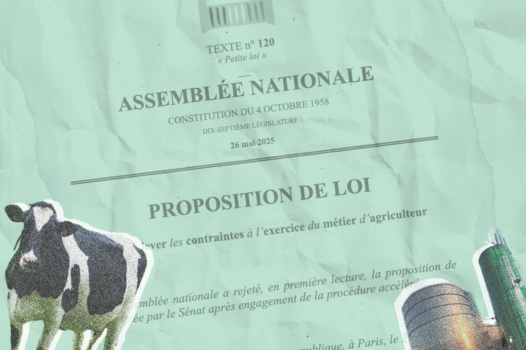
Les cadeaux de Macron à l’agro-industrie

« Stop aux marchands de mort » : au blocage de l’usine Phyteurop, avec les opposants aux pesticides







