Penser un nouvel humanisme
À l’occasion de cette rentrée politique, le philosophe Vincent Cespedes donne son sentiment sur la crise actuelle de
la gauche et les possibilités pour la dépasser.
dans l’hebdo N° 1066 Acheter ce numéro
Politis : On ne cesse de dire
que la gauche traverse une crise profonde. Pourquoi ? Comment l’appréhendez-vous ?
Vincent Cespedes : La crise de la gauche, selon moi, se caractérise essentiellement par son incapacité chronique à dire la société de demain. Or les gens, aujourd’hui, souhaitent d’abord que ceux qui s’adressent à eux puissent leur raconter le monde de demain. Certes, celui-ci est extraordinairement complexe, d’une complexité sans doute jamais atteinte auparavant. Mais la gauche doit néanmoins être capable de se projeter dans l’avenir. Et cela passe d’abord par une réflexion approfondie sur un vrai projet de société. Un travail qu’elle ne fait pas. Elle se contente d’une logique gestionnaire, ce qui équivaut selon moi à une négation de la politique. Les politiques et les intellectuels doivent être capables de dire qu’ils ne sont pas simplement des gestionnaires. Ils doivent cesser pour cela de tout calculer en termes de profits, de gains, avec toute l’obscénité qui va avec, où la seule ambition est d’être le meilleur manager. C’est ce que j’appelle la « doctrine du palmarès », qui est pour la gauche une sorte de virus dépolitisant où la seule valeur est de gagner contre l’autre. On paye là encore l’ultralibéralisme des années Reagan-Thatcher, dont l’idéologie continue de déteindre sur une partie de la gauche, sur la social-démocratie en somme. Pour moi, l’un des préceptes importants aujourd’hui est de faire sienne cette question déjà posée il y a longtemps par Lao-Tseu : pourquoi vouloir à tout prix arriver premier ? Il faut repenser la gauche à partir de l’idée de collectif.
Vos critiques portent principalement sur la social-démocratie. La gauche de (la) gauche trouve-t-elle un peu plus grâce à vos yeux ? Quelles devraient être ses revendications pour le monde de demain ?
Pour moi, la gauche de gauche fait encore de très bons diagnostics des problèmes de la société actuelle. Néanmoins, il me semble qu’elle fonctionne avec de vieux logiciels, avec trop de centralisation et un type d’organisation bien trop rigide aujourd’hui. Je crois qu’elle doit gagner peut-être plus en légèreté, en se rappelant par exemple ce qui a permis Mai 68. À l’instar de la pensée d’Henri Lefebvre, qui était alors professeur à Nanterre et avait pour étudiants Cohn-Bendit et la plupart de ceux qu’on appelait les « enragés » de l’époque, il faut, selon moi, insister sur une révolution de la pensée qui prenne en compte beaucoup plus de questions esthétiques, de poésie, de joie de vivre, de valeurs différentes, avec l’envie d’inventer une société différente en recréant du lien entre les gens, en respectant l’autre et la nature autour de soi… Un peu de rêve, quoi !
Deux des grandes questions que doit affronter la gauche aujourd’hui sont la question sociale et l’urgence de l’écologie politique.
Or, la gauche semble incapable de les relier entre elles, et parfois elles semblent même s’opposer. Comment peut-elle parvenir à les relier ?
Je crois que cela passe par un nouveau tiers-mondisme, même s’il ne faut pas l’appeler ainsi parce que le terme tiers monde ne signifie plus grand-chose aujourd’hui. Mais je reprends ce terme en pensant au magnifique mot de Deleuze formulé dans l’Abécédaire : « Être de gauche, c’est savoir que les problèmes du tiers monde sont plus proches de nous que les problèmes de notre quartier. » Et il ajoute qu’il s’agit d’abord d’un problème « de perception ». Je crois en effet que le lien à faire entre le social et l’écologie dépend essentiellement d’un problème de perception de la société qui nous entoure et du monde globalisé dans lequel nous vivons. Or, c’est justement le rôle du politique, et évidemment des intellectuels, que de montrer ce lien. L’exploitation est toujours plus forte et s’étend partout sur la planète en la détruisant. Il y a là un nouvel humanisme à penser. Comme on parle aujourd’hui de l’Internet 2.0, je rêve de voir éclore les « Lumières 2.0 » pour penser le monde globalisé d’aujourd’hui. Or, avec Internet et les nouvelles technologies, les peuples du monde peuvent aujourd’hui avoir accès à une somme de connaissances comme Diderot ne l’a même jamais rêvée. La connaissance est à la portée des peuples. Mais il faut qu’ils n’oublient pas de douter. On ne doute pas assez de nos jours, certainement du fait de cette « doctrine du palmarès » dont je parlais plus tôt. Il est temps de se remettre à douter.
Pour aller plus loin…

« Fanon nous engage à l’action »
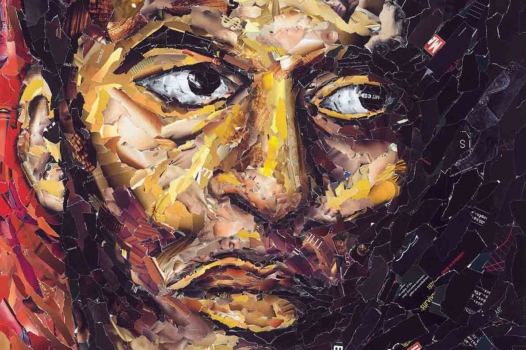
Frantz Fanon, un éclairage disputé sur l’héritage colonial

Fanny Gollier-Briant : « Il faut absolument repolitiser la souffrance des jeunes »







