Péan, politiquement incorrect
Avec « Carnages »,
le journaliste révèle une part de vérités cachées
dans les guerres secrètes
que livrent les grandes puissances en Afrique.
dans l’hebdo N° 1136 Acheter ce numéro
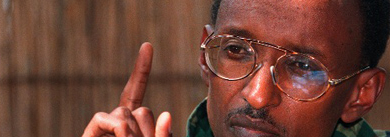
Si la formule n’était pas galvaudée, on dirait que Pierre Péan a écrit un « livre courageux ». Mais ces mots servant le plus souvent à « vendre » les ouvrages les plus convenus et situés du côté du manche, on hésitera à les reprendre pour qualifier cette somme que Péan consacre à l’Afrique. Pourtant, il s’attaque courageusement à un sujet délicat : la politique israélienne en Afrique. Le journaliste réfute l’idée, pourtant bien établie, selon laquelle l’État hébreu serait exclusivement un acteur régional, au sens où il n’interviendrait pas dans d’autres zones que ce Proche-Orient incandescent. Or, Péan montre que les pionniers d’Israël ont d’emblée positionné le jeune État naissant comme « un acteur néocolonial » . Toutefois, ce n’est pas l’esprit de conquête qui guide en premier lieu Israël, contrairement aux grandes puissances européennes et aux États-Unis, mais son sempiternel souci sécuritaire. C’est la peur que suscite à Tel-Aviv l’Égypte de Nasser d’abord. L’État hébreu se
