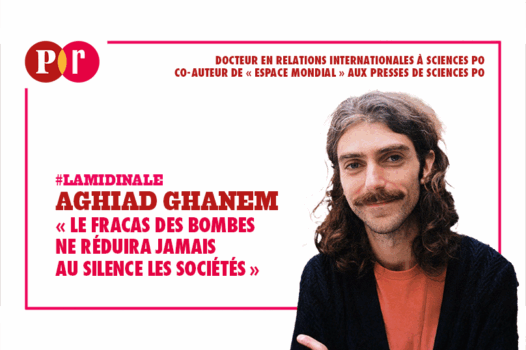Un parfum de révolte dans le Wisconsin
Des mobilisations de grande ampleur dans le Midwest contre une loi vue comme anti-syndicats pourraient réconcilier les employés américains avec la « manif’ » à l’européenne. Analyse d’Alexis Buisson.
dans l’hebdo N° 1152 Acheter ce numéro

Le vent de fronde qui souffle sur le monde arabe a fait des émules improbables dans le Midwest américain : les fonctionnaires du Wisconsin. À la mi-février, plusieurs milliers d’entre eux, du policier à l’institutrice, ont manifesté pendant plusieurs jours devant et à l’intérieur de l’Assemblée législative de l’État, dans la capitale, Madison, pour protester contre un projet de loi du nouveau gouverneur républicain, Scott Walker, limitant notamment le pouvoir syndical en matière de négociation salariale. Des manifestations de moindre ampleur ont éclaté dans d’autres États, comme l’Ohio, gouvernés par des Républicains souhaitant faire passer des lois de casse sociale similaires.
Si l’application de la loi a été suspendue par un juge en mars et pourrait bien se jouer devant la Cour suprême de l’État, l’épisode a surpris pour plusieurs raisons. Le timing, tout d’abord, laissait suggérer un lien entre les soulèvements populaires en Égypte et en Tunisie – de fait, certains manifestants à Madison brandissaient des pancartes comparant le gouverneur Walker à Hosni Moubarak. Non moins surprenante, la stratégie des députés démocrates, qui ont purement et simplement quitté l’État pour priver les Républicains du quorum nécessaire pour voter la mesure !
Mais c’est surtout le recours à la manifestation comme moyen d’action qui a surpris dans un pays où elle est loin d’être un rituel comme en Europe. « En France, il y a une culture de la manifestation continue sur la question du travail. Aux États-Unis, elle a été mise entre parenthèses il y a plusieurs décennies » , explique Michael Kazin, professeur d’histoire à l’université de Georgetown à Washington, DC.
Contrairement aux idées reçues, la culture protestataire existe bien aux États-Unis. Le développement d’organisations syndicales à la fin du XIXe siècle dans l’Amérique industrielle entraîne la multiplication des sit-in et des grèves dans les secteurs de l’automobile, de la sidérurgie et du chemin de fer. Le pouvoir syndical est renforcé à plusieurs reprises pendant la première moitié du XXe siècle, notamment lors de la Grande Dépression des années 1930. L’avancée la plus importante survient en 1935 avec l’adoption du Wagner Act. Le texte donne aux travailleurs du privé le droit de se constituer en syndicats, de participer à des conventions collectives, à des mouvements de grève, ou à toute forme de revendication collective.
Après la Seconde Guerre mondiale, le vent tourne. Le Congrès américain, face aux grèves multiples et au refroidissement des relations avec l’URSS, adopte pas moins de 250 lois antisyndicales. La plus connue, le Taft-Hartley Act, de 1947, restreint le droit de grève. La mesure est mal vécue par les syndicalistes, qui la surnomment « la loi des travailleurs-esclaves ». Un autre coup dur survient en 1981. Le président républicain Ronald Reagan, apôtre de la dérégulation, mate une grande grève des aiguilleurs du ciel en ordonnant le licenciement de 11 000 d’entre eux. Les aéroports se remettent à marcher, mais la mesure a rendu une génération de travailleurs rétive à l’idée même de mobilisation collective. Le nombre de grèves d’au moins mille participants est passé de 470 en 1952 à 29 en 1997, tandis que le nombre de journées débrayées a chuté de près de 90 % entre 1981 et 2008, selon le département du Travail américain.
Entre la crainte du licenciement, les restrictions réglementaires, l’augmentation des salaires, mais aussi la montée en puissance de l’Internet comme plateforme de contestation, les rangs des syndicats s’érodent. Certes, la tendance s’observe dans de nombreux pays développés, mais elle est particulièrement forte aux États-Unis. Si la part des syndiqués reste forte dans le public (36,8 % en 2009), la même population dans le privé fond comme neige au soleil. Seuls 7,2 % des travailleurs du privé faisaient partie d’un syndicat en 2009 contre 33 % dans les années 1940.
Pour Michael Kazin, le faible recours aux manifestations de rue ne veut pas dire que les syndicats sont dociles, au contraire. Selon lui, ils ont fait le choix de porter leur combat directement dans les couloirs du pouvoir, plutôt que dans la rue, faisant du lobbying auprès de parlementaires et recherchant des « alliés » au Congrès, à la Maison Blanche et dans les agences. « Les travailleurs ont obtenu beaucoup de droits auprès des États et de l’État fédéral sans passer ni par la grève ni par la manifestation, mais en travaillant avec le législateur, observe-t-il. En plus, ils se sont rendu compte que les manifestations et les grèves étaient impopulaires, et que cela nuisait à leur image. » Un succès dans le Wisconsin pourrait-il changer les esprits ?
Pour aller plus loin…

Yassin al-Haj Saleh : « Le régime syrien est tombé, mais notre révolution n’a pas triomphé »

Au Chili, un espoir pour la gauche

Contre la guerre, aux États-Unis : « Nous ne voulons plus de morts, plus de victimes »