Jean-Luc Mélenchon : « Pas question de ne pas aller jusqu’au bout »
Intronisé par le PC avec 59 % des voix, Jean-Luc Mélenchon est désormais le candidat officiel du Front de gauche. Il veut titulariser les précaires du public, un salaire maximum, sortir de l’Otan, un référendum sur le nucléaire… Il préconise une rupture avec la politique « autoritaire » européenne.
dans l’hebdo N° 1158 Acheter ce numéro

Le Front de gauche a son candidat à l’élection présidentielle. Après le vote interne des militants communistes, Jean-Luc Mélenchon, qui portera les espoirs de cette alliance élargie à trois nouvelles formations, explique aux lecteurs de Politis comment il conçoit son rôle, le sens du « programme partagé » qu’il défendra. Le coprésident du Parti de gauche dévoile aussi les objectifs de la campagne qu’il conduit désormais.
Politis : Vous êtes depuis ce week-end le candidat du Front de gauche. Mais vous l’étiez déjà en quelque sorte. Qu’est-ce qui change ?
Jean-Luc Mélenchon : Grâce au vote des communistes, tout. Avec les décisions communes du PG, de la Gauche unitaire, du PCF, de la Fase, de Convergence et Alternatives, de République et socialisme, l’autre gauche a surmonté son penchant mortifère pour la division. C’était à mes yeux sa principale faiblesse. En 2007 aussi, un large rassemblement s’était constitué avec l’objectif d’une candidature commune à la présidentielle. Mais, malgré des heures de travail et de dévouement, cela n’avait pas abouti. Et l’autre gauche s’était fragmentée en poussières à l’élection suivante. Beaucoup se demandaient donc si nous étions capables de faire l’unité que nous proclamions. Ce doute est levé. Partant de là, beaucoup de personnes vont se mettre en mouvement. D’autant plus que notre campagne commune peut maintenant commencer et qu’elle sera ouverte à tous et à chacun. À tous ceux qui le peuvent, je donne d’ailleurs rendez-vous le 29 juin prochain pour prendre la place Stalingrad, métro Jaurès à Paris, et lancer notre campagne.
Êtes-vous capable de passer du « je » au « nous » comme vous l’a demandé Pierre Laurent ?
Il y a là un grand malentendu. Je dis « nous » modestement quand je m’y sens autorisé. À l’ère des médias, le rythme de la scène publique n’est pas celui des organisations collectives : quand un événement surgit, il faut réagir une demi-heure après ou choisir de se retirer de la scène publique. Dire « je », c’est protéger la liberté que d’autres viennent dire « nous pensons… » en ayant eu, quant à eux, le temps de consulter. Je veux bien dire « nous » tout le temps, mais après il faudra assumer. Ce sera le règne du correctif permanent et de son ridicule. Le travail d’un candidat ou d’un porte-parole est sans cesse dans ce maniement délicat de la parole collective et de la parole personnelle. Vous allez donc continuer à alimenter votre blog pendant la campagne ? Il ne faut pas que l’on sombre dans la grisaille. Que subitement la parole soit rabotée pour être conforme à ce qui convient à tout le monde en même temps, et que je joue la comédie de disparaître en tant que personne. J’espère que la campagne sera collective mais qu’elle sera aussi portée individuellement par tous ceux qui vont s’y associer. Nous ne pourrons pas la faire sur le modèle des armées régulières. Nous ferons forcément une campagne de francs-tireurs et partisans, une campagne de guérilla où chacun s’y met, monte au front, revient chez lui… Il est très important que souffle sur notre campagne l’air de l’autonomie et de l’implication personnelle. Pour le reste, nous avons un dénominateur commun : notre programme partagé.
Vous avez réussi à vous imposer dans les médias, mais le « personnage » n’a-t-il pas tendance à tuer le discours ?
Évidemment que parfois le message est moins puissamment entendu que le personnage. À la plupart des hommes et des femmes politiques, on demande le plus souvent de réagir à ce que d’autres ont dit, et il est très difficile d’obtenir d’être interrogé sur ses propres positions. Celui qui croit qu’il va utiliser les médias comme porte-voix de son positionnement se trompe complètement. Les médias ne sont pas un miroir déformant, c’est une arène et un lieu de divertissement. Donc il faut utiliser la situation. Il y a un effet « vu à la télé » : une série de gens qui voient dans ma manière d’être un signal de ralliement. Ceux-là viennent me retrouver, sur le blog, au parti, à la manifestation du Front de gauche, au meeting… Par là, ils entrent dans le large système que nous avons constitué. Au cours des six derniers mois, nous avons franchi le deuxième million de visiteurs sur mon blog. Dix mille personnes par jour le consultent. Nous avons réussi par cette méthode à solidifier un espace conscient, réactif. Les partis du Front de gauche en bénéficient tous, et tous y contribuent.
Le titre de votre livre, Qu’ils s’en aillent tous !, a souvent été interprété comme une invitation au populisme. Vous avez entendu cela, y compris le parallèle Mélenchon-Le Pen. Qu’est-ce que ça vous inspire ?
Tout d’un coup, voir des gens m’assimiler à l’extrême droite, que j’ai combattue toute ma vie, m’a beaucoup blessé, plus même que ce que vous pouvez imaginer. Après, il faut y réfléchir politiquement. La bonne société a trouvé le moyen de régler ses comptes avec la périphérie du « cercle de la raison », celui des importants et des défenseurs du système : ils ont diabolisé les barbares, c’est-à-dire tout ce qu’ils veulent repousser en le mettant dans le même sac rebaptisé populisme. Non seulement le procédé nous oblige à des démarcations qui nous font perdre du temps, mais il brouille les repères et aggrave la situation dans des proportions épouvantables. Pour la vieille petite deuxième gauche archaïque qui règle ainsi ses comptes, c’est une façon perverse et sournoise de mener le combat. Nous devons non seulement résister au travail extrêmement dangereux de ces gens mais contre-attaquer avec vigueur et discréditer leurs méthodes par tous les moyens dont nous disposons.
Comparé à votre dernier essai, le titre du programme partagé, « l’Humain d’abord ! », n’est-il pas un peu angélique ?
C’est très radical au contraire. La société capitaliste et productiviste est fondamentalement inhumaine. « L’Humain d’abord », c’est un magnifique manifeste politique humaniste. Et nous nous donnons les moyens de dire en quoi cela consiste. D’abord récupérer la souveraineté, ne pas la laisser à l’argent, empêcher que certains se gavent tandis que les autres dépérissent. Ensuite, la planification écologique, le refus de la guerre, et ainsi de suite. C’est riche de conséquences : si c’est l’humain d’abord, ce n’est pas le riche d’abord, ni la compétitivité de nos entreprises contre la Chine-l’Inde-et-le-Brésil, qui fait la joie de tous les JT. Et si c’est la personne humaine qui marche la première, il faut partager pour que tout le monde ait de quoi vivre dignement comme être humain.
Quelles seraient les premières mesures de ce programme à mettre en œuvre ?
Le programme partagé n’est pas réalisable sans implication populaire, donc la première tâche consiste à réunir les conditions de cette implication. Sécuriser la vie des gens en sortant de la précarité les millions de gens qui y sont contraints, c’est 800 000 précaires des trois fonctions publiques titularisés en 48 heures et, dans le secteur privé, des quotas de contrats à durée déterminée (pas plus de 5 % dans les grandes entreprises, pas plus de 10 % dans les petites). La fin de la peur du lendemain donnera de l’énergie populaire, car si vous passez votre vie à avoir peur du lendemain, vous n’avez pas le temps de vous occuper des autres et de vous engager. Autre mesure immédiatement mise en œuvre : le salaire maximum. Voilà pour le renforcement immédiat de la base sociale de la révolution citoyenne. Après, il y a l’aspect politique, avec la convocation d’une constituante. Mais il y a aussi des choses rapides à faire, par exemple sortir de l’Otan, décider le rapatriement des troupes françaises d’Afghanistan… En revanche, mettre en route la planification écologique demande que l’Assemblée nationale définisse le plan de marche et que les différents échelons se mettent en place puisque ce sera par la force des choses une planification décentralisée et relocalisée. Cela prend un peu plus de temps. De même pour la mise en place des grands outils de contrôle, comme la constitution d’un pôle public financier, ou le retour dans la collectivité des principaux leviers qu’on sort du secteur marchand, tels que l’éducation, la santé, l’énergie. Là, il faudra ouvrir les discussions avec nos partenaires européens parce qu’il faut s’affranchir du traité de Lisbonne. Ces mesures peuvent paraître exceptionnelles par leur rupture, mais elles sont à la hauteur de la situation car personne ne sait dans quel état sera le système de l’euro dans un an. On ne sait même pas dans quel état il sera dans un mois ou une semaine.
Le 23 juin, le Parlement européen doit voter les six directives du « paquet gouvernance économique », qui placent les budgets nationaux sous contrôle. Qu’en dites-vous ?
L’Europe est passée du stade a-démocratique à un stade autoritaire. Quoi que le peuple dise, elle impose ses directives. Et elle est en train de passer à un stade totalitaire puisque dorénavant les peuples seront contraints. Comment qualifier autrement l’arrivée de la troïka [UE, FMI et BCE] dans un pays européen libre, démocratique et souverain ? Ils mettent un représentant par ministère, qui surveille les dépenses. Et, quoi qu’il arrive et que disent les gens, on applique de force le programme de l’armée d’occupation que représentent les banksters et la troïka, qui est leur bras séculier. La Commission rétablit le droit de veto sur les budgets que les États généraux avaient refusé à Capet en 1789. C’est une évolution sur le plan de la forme de nos États d’une gravité immense, qui mesure aussi que le libéralisme est devenu un système politique plus rigide que le Gosplan. Une série de principes coulés dans le bronze doivent s’appliquer jusqu’à l’absurde. On vote ainsi le paquet économique d’austérité au moment même où la démonstration est faite de ce que ça donne en Grèce.
Si les Allemands sont partisans du rééchelonnement de la dette grecque, il en coûtera à leur système bancaire, mais moins qu’à nous, les Français. D’autres, avec M. Trichet, disent que le rééchelonnement va mettre en mouvement tous les titres d’assurance sur la dette d’un pays qui aura fait défaut, et que la catastrophe viendra par les assurances et les banques. Du point de vue des normes libérales, puisqu’ils s’interdisent le recours au financement direct par la Banque centrale européenne, il n’y a aucune solution. Vont-ils ouvrir la vanne de secours ? Non, ils se mettent devant avec un fusil et interdisent d’y toucher au risque de faire sombrer le système tout entier, y compris la vanne elle-même.
Existe-t-il encore des marges de manœuvre pour des gens comme vous, s’il advenait que vous accédiez aux responsabilités ?
Elles sont immenses.
Comment, par exemple, se libérer de Lisbonne ?
En le décidant. Il faut d’abord opérer un désenvoûtement dans les milieux dirigeants qui ont fini par croire, comme ils le racontent, qu’il n’y a qu’un seul ordre possible. Si nous décidons demain que la BCE a le droit de prêter aux États comme le font les États-Unis, qui se prêtent à eux-mêmes, le problème est réglé. Cela ne réduit pas la dette, mais elle peut se renégocier, les établissements bancaires peuvent être mis à contribution…
En Grèce, Georges Papandréou pouvait-il faire autre chose que ce qu’il a fait ?
À quoi a servi ce qu’il a fait ? C’est un comble que l’on nous demande des comptes et non à lui, qui s’est soumis. Il a pillé son pays, saccagé l’économie, démoralisé son peuple. Beau résultat ! Au bout d’un an, les Grecs sont encore plus endettés qu’au début. Comme je ne veux pas, si c’est à moi qu’on confie cette responsabilité, que les Français soient traités comme les Grecs, ce n’est pas le troisième jour que se produira la résistance. Il fallait dire non à la première heure. Or, le premier jour, M. Papandréou a dit : « Pardon, les Grecs sont coupables. » Dans quelques semaines, quelques mois peut-être, notre propre pays va être confronté à ce choix. La force de notre programme, la netteté de ses ruptures, ajoutées au caractère des gens qui le portent, tout ça fait un tout pour faire face à une situation comme celle-là.
Un sondage Ifop relance le débat sur le protectionnisme. Y êtes-vous favorable ?
Ce que les gens ont compris comme nous, c’est que la règle de la concurrence libre et non faussée aboutit à une seule et unique conséquence : le dumping social. À cette règle, nous opposons un système de filtres, selon des critères d’exigence écologique, de relocalisation de la production et d’exigence sociale. Que sommes-nous capables de produire ? Que ne sommes-nous pas capables de produire ? Ce que nous ne sommes pas capables de produire, est-ce que nous en voulons vraiment ? Si nous en voulons mais ne savons pas le produire, nous demandons à ceux qui savent le produire, et là, c’est de la coopération. À la concurrence libre et non faussée s’oppose le modèle de la coopération internationale. Pour cela, il faut des puissances publiques, parce que ce sont elles qui signent des accords et garantissent la bonne exécution de la coopération. Il faut donc des ensembles démocratiques ou des États nations, toutes choses qui font horreur aux libre-échangistes, pour qui l’État est un embarras et les peuples une gêne.
Dans le programme partagé, la question du nucléaire n’est pas tranchée.
On n’est pas d’accord entre nous, on ne va pas le cacher. Le Parti de gauche, dont je suis issu, est pour la sortie du nucléaire dans le cadre de la planification écologique. Le Parti communiste est pour la mise en place d’un « mix » des différentes sortes d’énergie. Une fois constatée cette divergence, nous sommes d’accord pour dire qu’il faut sortir du recours aux énergies carbonées, qui ont un effet de serre que tout le monde connaît. C’est un objectif politique et un appel à l’inventivité, à la réflexion, au progrès scientifique et aux recherches. Ensuite, nous sommes pour que la question de l’ensemble des énergies, y compris nucléaire, soit soumise à référendum. Ce n’est pas rien ! Nous n’avons jamais discuté dans ce pays de la question du nucléaire. Jamais. Elle n’a été soumise ni au peuple ni à l’Assemblée nationale. D’ailleurs, Europe Écologie-Les Verts, qui est pour la sortie du nucléaire, fait la même proposition, qui tient compte du fait que, sur un sujet controversé, notre intérêt est qu’il y ait débat et que chaque Français comprenne de quoi on parle.
Des électeurs sont convaincus que le Front de gauche travaille pour le PS et que vous irez au gouvernement avec lui…
J’ai dit je ne sais combien de fois que je ne participerais à aucun autre gouvernement que celui que je dirigerais. Quant à la radicalité des mesures à mettre en place, ceux qui croient qu’ils vont passer à côté se trompent. La situation va les rattraper. Les peuples vont être confrontés à ce choix : ou la radicalité libérale qui saccage et pille les pays au profit des politiques d’austérité, ou la radicalité concrète de type Front de gauche qui consiste à dire « l’Humain d’abord ! »
Quel est l’objectif que vous vous assignez ?
Le premier objectif, celui du Front de gauche, c’est un peuple plus rassemblé, plus conscientisé, et avec des objectifs de combat qui sont vécus et intériorisés. Mais il n’y a pas de limites à notre ambition, et en tout cas nous n’intérioriserons pas les limites de ceux qui veulent nous en donner. Notre ambition, c’est évidemment 51 %. Ensuite, tout score à deux chiffres nous va. Donc pas question de vous retirer même au cas où les sondages feraient craindre la présence de Marine Le Pen au second tour ? Évidemment. J’irai jusqu’au bout. Pourquoi se retirerait-on pour des socialistes qui feront la même chose que Papandréou ?
Pour aller plus loin…

À Bagneux, les unitaires lancent le « Front populaire 2027 »
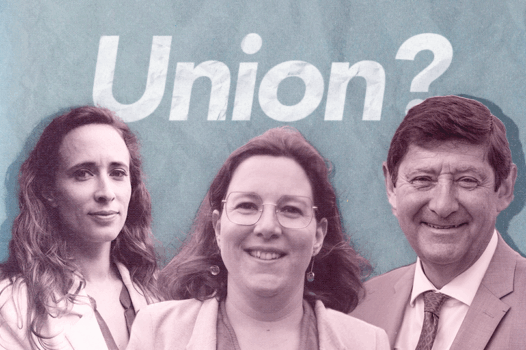
Gauches, quel chemin ? Guetté, Chatelain et Kanner répondent

Les gauches, (toujours) condamnées à s’entendre







