Ces héros qui nous fabriquent
Comment les figures de notre enfance continuent-elles de nous accompagner à l’âge adulte ? Plusieurs personnalités dévoilent leur héros.

Au départ, cette idée que nos héros d’enfance nous accompagnent… Perchés sur nos épaules pour nous taper dans le dos ou nous tirer les oreilles selon que l’on est fidèle ou traître à nos rêves. Ou cachés dans des plis de mémoire qui se déroulent parfois pour nous adresser des clins d’œil. Si ces héros ont leur histoire, ils représentent aussi un peu de la nôtre, de l’époque où nous les avons découverts, du contexte dans lequel ils ont jailli des pages d’un livre ou d’un écran. Ce sont souvent des enchanteurs, gardiens de la clé des champs, mais aussi des pourvoyeurs de « trucs » pour transcender le quotidien ou affronter ses peurs.
« Qu’importe que [le héros] ait tous les pouvoirs ! Où serait son mérite ?, interrogeait dans Télérama Jean-Philippe Arrou-Vignod, écrivain et directeur de collection chez Gallimard à l’occasion de l’exposition l’Étoffe des héros qui se tenait au Salon du livre et de la presse jeunesse à Montreuil fin novembre (voir Politis.fr). Le héros, pour m’intéresser, doit se surpasser, se montrer capable de surmonter ses handicaps. En un mot, me ressembler mais en plus courageux, plus déterminé, susceptible d’accomplir des prouesses qui me sont inaccessibles. » L’autonomie de Tarzan, la magie de Mary Poppins, la victoire sur la mort d’Harry Potter… Aimés pour leur force – leurs pouvoirs – les héros sont des fabriques d’idéaux. Souvent nobles mais pas toujours : « De nos jours, les héros sont moins corsetés qu’auparavant, poursuit Jean-Philippe Arrou-Vignod. La littérature de jeunesse est débarrassée de ses missions d’édification morale, ses personnages sont devenus plus ambigus, complexes, parfois négatifs […]. Ils expriment ainsi ce que nous voudrions être, mais aussi ce que nous craignons de devenir. » Publié en 1964, Max et les Maximonstres, de Maurice Sendak, en est un des premiers exemples. Avant cette date, peu de héros troubles. Ils étaient engourdis par la finalité éducative, du Télémaque de Fénelon aux Petites Filles modèles de la comtesse de Ségur. Ils étaient surtout principalement masculins. C’est moins le cas aujourd’hui, où l’on voit surgir davantage d’héroïnes. Tout de même, certaines ont réussi à traverser le temps : Fifi Brin d’acier, Jo March, Peau d’âne, Cendrillon, la Petite Sirène, Heidi, Super Jamie, Yoko Tsuno, Laura Ingalls, et toute une série de « Belle »…
« L’héroïne et le héros participent à la construction collective d’une image idéale, d’une sorte de surmoi social auquel les jeunes générations peuvent s’identifier. Ils dépendent ainsi de ce que René Kaës appelle “l’appareil psychique groupal” », explique Jean Perrot dans les Héros dans les productions littéraires pour la jeunesse (L’Harmattan). Le rôle du héros collectif frappe comme une évidence quand on pense à Ulysse… ou à Jack Bauer. « Umberto Eco montre aussi, dans De Superman au surhomme, comment des personnages symboliques, de Rocambole à Monte-Cristo, d’Arsène Lupin à James Bond, de Tarzan à Superman […], ne vieillissent pas, car ils sont porteurs de traits caractéristiques, parfois à la limite de la déformation caricaturale. » Autre effet du héros : il tend un miroir, soulignant une aspiration ou un trait de personnalité. Il agit aussi comme une madeleine offrant un accès immédiat à un moment de l’enfance ou de l’adolescence. Il est surtout une occasion de raconter des histoires. Que les personnalités qui ont accepté de jouer le jeu dans ce dossier en soient remerciées ! Ingrid Merckx
**André Grimaldi
Jacques et Antoine : l’insurgé et le médecin**
- Je quitte le lycée Buffon de Paris pour le lycée Gautier d’Alger. Mon père, comme plusieurs milliers d’autres fonctionnaires, y a été muté pour participer à la « pacification » de l’Algérie française. La France ne fait pas la guerre, elle assure seulement le maintien de l’ordre. Le héros de mes lectures de l’époque est Jacques Thibault, jeune socialiste, en rupture avec sa famille, opposé à la guerre, la grande, dont on va célébrer le centenaire. Il meurt, en août 1914, lors du crash d’un avion transportant des tracts appelant les soldats français et allemands à fraterniser. Jacques a un frère Antoine de 10 ans son aîné, humaniste et conservateur. Moi aussi j’ai un frère plus âgé de 10 ans, jeune professeur de philosophie, appelé à combattre en Algérie comme « soldat du contingent ». À vrai dire, c’est lui le révolté radical, l’insurgé permanent. Moi, j’admire Jacques mais je ressemble plutôt à Antoine, fils docile, étudiant appliqué. Comme Antoine, je deviendrai médecin, manière de donner un sens à sa vie, tout en soignant sa timidité.
En 1968, je suis reçu au concours de l’internat des hôpitaux de Paris ? Mais cette même année, le vieux monde, né à Yalta, semble se fissurer de toutes parts. Jacques frappe à la porte. D’abord s’engager, ensuite essayer de comprendre. J’adhère à la JCR. Les années passent. La révolution annoncée s’évapore. L’insurrection libertaire de Mai 68 a été récupérée et recyclée en mouvement de libéralisation des moeurs. L’épopée révolutionnaire se termine en techno parade. Plutôt que de vouloir changer le monde, peut être serait-il plus raisonnable d’essayer de changer le service de diabétologie de la Pitié Salpêtrière où j’exerce comme praticien hospitalier? Antoine est de retour. Commence la solitude du coureur de fond. Il est beaucoup plus difficile de construire que de s’insurger. Plus difficile mais hélas aussi plus dérisoire, à la merci des bouleversements sociétaux provoqués par la mondialisation libérale. Le triomphe dans les années 1980, de la pensée managériale de marché détruit progressivement les savoir faire artisans et disloque les équipes patiemment construites. La mode est au « business plan ». On était des médecins dévoués, on allait devenir des « producteurs de soins » « travaillant à flux tendu ». Ne pas se taire, surtout ne pas sombrer dans « les eaux glacées du calcul égoïste » Autre temps, autre guerre ! Et ce pourrait bien être la der des ders. Déjà certains, à l’avant-garde de la génomique, préparent « l’homme augmenté », version biologique de « l’homme nouveau ».
**André Grimaldi est professeur émérite d’endocrinologie, ancien chef du service de diabétologie à la Pitié-Salpétrière et tête de pont du Mouvement de défense de l’hôpital public.
Il a récemment publié « La santé écartelée, entre santé publique et business » (Editions Dialogues).**
Emmanuel Maurel
Rêver avec Robinson Crusoe
« Le héros de mon enfance, c’est Robinson Crusoe. Il m’a fallu attendre de lire la version non expurgée de Michel Tournier, et bien sûr celle de Daniel Defoe, pour percevoir ce qu’il pouvait y avoir de douloureux dans la situation de Robinson et de problématique dans sa relation avec Vendredi.
Enfant, je ne voyais que le côté aventureux et exotique de l’histoire : celle d’un homme qui vit au contact d’une nature sauvage qu’il a progressivement apprivoisée, d’un solitaire qui réorganise le monde avec méthode. Robinson, c’est surtout une formidable invitation au voyage, à la rêverie et au jeu. Dresser des listes (kit de survie, fruits comestibles, coquillages, bêtes sauvages, fleurs rares), inventer des cartes (recoins, pièges, grottes, trésors cachés), construire des cabanes, imaginer des suites ou des variantes au mythe originel.
Aujourd’hui, quand je veux retrouver Robinson, je lis les sublimes “Images à Crusoe” de Saint-John Perse, placées en tête du recueil Éloges. »
Emmanuel Maurel est membre du bureau national du PS et animateur du courant Maintenant la gauche.
Aurel
L’humour détaché d’Astérix
« Je vénérais MacGyver. À tel point que son nom est passé dans mon langage courant : “Je te fais ça à la MacGyver.” Un type capable de se sortir de la plus mauvaise passe avec trois bouts de ficelle, ça fait rêver. À chaque fois que je bricole, j’ai une pensée pour lui !
L’autre héros de mon enfance, c’est Astérix. Un personnage qui me permettait d’entretenir un lien particulier avec mon père, dont c’était aussi le héros. On connaissait tous ses albums par cœur. Dans notre famille, on glisse régulièrement des répliques d’Astérix dans la conversation. J’aime bien le dessin mais, surtout, j’apprécie les différents niveaux de lecture : l’aventure, les jeux de mots, l’humour caché… Il y a finalement assez peu de héros qui manient l’humour avec détachement. »
Aurel est dessinateur.
Esther Benbassa
La douceur ineffable de Jésus
« Mes parents, à Istanbul, étaient très amis avec les Papazian, une famille arménienne qui comptait deux filles, dont une de mon âge. Ils me laissaient souvent avec elles lorsqu’ils sortaient s’amuser. Je dormais dans leur chambre. Sur un des murs, il y avait l’image d’un homme blond aux cheveux longs et aux yeux clairs, d’une douceur ineffable. L’auréole qui couronnait sa tête le rendait encore plus beau. Que dire enfin de sa tunique blanche et de la croix qu’il tenait ?
Un soir, j’osai leur demander de qui il s’agissait. Mes amies me répondirent avec beaucoup de révérence qu’il se dénommait Jésus et était leur Dieu. Quelle surprise ! Chez moi, il n’y avait point d’image de Dieu. Éblouie, je demandai à mes parents quelques informations.
Nuit et jour, je pensais à ce bel homme qui m’avait tant marquée. Je voulais l’épouser. Et avant tout avoir dans ma chambre la même image que les filles Papazian. Mes parents m’expliquèrent d’abord que, chez les Juifs, Dieu n’était pas représenté, que Jésus n’était absolument pas notre Dieu, et, bref, qu’il n’était pas Dieu du tout. Me conseillant de penser à autre chose, ils m’ont signalé que Jésus était mort depuis longtemps. Quelle déception ! J’appris au moins que même un héros aussi puissant que Jésus était mortel…
Esther Benbassa est titulaire de la chaire d’histoire du judaïsme moderne à l’École pratique des hautes études et sénatrice EELV (94). Derniers ouvrages : De l’impossibilité de devenir français (Les Liens qui libèrent, 2012) et Égarements d’une cosmopolite (François Bourin, 2012).
Hervé Kempf
La Terre perdue dans l’espace
« En 1968, j’étais en sixième et j’ai voulu faire un exposé sur la conquête de l’espace. Le monde contemplait alors les premières images de la Terre vue du ciel. J’étais émerveillé de ce spectacle et baigné par le rêve de cette époque qui annonçait que, bientôt, on marcherait sur la Lune. Ces photos ont imprimé dans ma conscience une révélation : la Terre est un vaisseau perdu dans l’espace. La finitude de ses ressources apparaissait comme une évidence. Je reconnais une filiation entre cette période de mon enfance et mon engagement d’écologiste. »
Hervé Kempf est journaliste et écrivain.
Pierre Rabhi
Bibi Fricotin : à chaque problème sa solution !
« J’ai une pleine étagère des aventures de Bibi Fricotin ! J’y retrouve la saveur d’une adolescence tourmentée, durant laquelle j’étais fan de ce personnage. Ce gars-là a des solutions à tous les problèmes. Quelle que soit la situation, il s’en sort ! Je suis totalement immergé, au quotidien, dans l’univers “sérieux”, d’une très grande complexité et marqué par l’extrême urgence de la crise que nous vivons. L’homme est individuellement doué et collectivement crétin. C’est une barrière au bonheur. Bibi Fricotin, avec sa candeur intelligente et vive, m’offre une échappatoire vers la simplicité et une forme d’innocence face à la gravité. Même si le héros majeur de ma vie demeure Socrate… »
Pierre Rabhi est agroécologiste et philosophe.
Pascal Boniface
D’Artagnan et la solidarité
« Ce qui m’a plu en d’Artagnan et les mousquetaires, lorsque, enfant, j’ai lu le roman de Dumas, c’était leur sens de la solidarité et de l’amitié, leur conception de l’honneur, leur courage qui leur fait prendre tous les risques. Ils ont un petit côté rebelle, voire libertaire, tout en ayant pour principe absolu le respect des engagements pris et de la parole donnée. En tous les cas, une vision personnelle de la discipline.
Je l’ai relu récemment d’une traite, et il y a des points historiques que je trouve plus contestables. Notamment les visions de Richelieu et d’Anne d’Autriche. Si je n’adhère pas vraiment à cet aspect politique, j’ai en revanche retrouvé le sens des valeurs. Pas de compromissions par intérêt. Ça change radicalement de ce que l’on voit trop souvent aujourd’hui, où la trahison est récompensée et le reniement une pratique admise. D’Artagnan incarne l’esprit chevaleresque par excellence. »
Pascal Boniface est directeur de l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris).
Zaü
Bleck Le Roc et les grands espaces
« Il y avait peu de livres chez moi lorsque j’étais enfant. Je vivais dans le quartier de Barbès et je passais plus de temps à rêvasser en regardant la foule bigarrée du marché que devant des illustrés. Je me suis pourtant pris d’intérêt pour le héros de BD Bleck Le Roc. Ce trappeur blond m’offrait pourtant peu de perspectives d’identification ! Mais Bleck ouvrait au voyage, aux grands espaces, aux animaux sauvages, à l’aventure. Et quelque chose dans la manière dont il était dessiné m’attirait. Cela dit, les premiers personnages que j’ai dessinés étaient des Indiens : une autre invitation au voyage pour moi qui suis fan de western. »
Zaü est illustrateur de livres pour la jeunesse. Voir Politis n° 1278.
Paul Ariès
Pourquoi Carreidas m’a fasciné ?
J’ai longtemps été fasciné par le personnage de Lazlo Carreidas dans Tintin … l’homme-qui-ne-rit-jamais. Je parle bien de cette fascination que provoque le serpent et non pas de celle que produit les héros positifs. Qu’est-ce qui pouvait séduire un gone de 12 ans de culture ouvrière communiste chez ce personnage ni franchement sympathique ni vraiment très méchant ? Ce milliardaire apparaît dans Vol 714 pour Sidney . Tintin et Haddock qui se rendent à un congrès international d’astronautique après avoir marché sur la Lune sont [_GoBack<-]
invités par Carreidas dans son jet personnel. Mais des franchement « méchants » ont décidé d’enlever le milliardaire pour s’emparer de sa fortune… J’ai appris bien plus tard qu’il y avait du Marcel Dassault chez Carreidas, même chapeau, même écharpe, même lunettes. Et il construit des avions. Il possède même des compagnies pétrolières et la célèbre marque Sani Cola (allez savoir si mon aversion pour Coca-Cola ne vient pas aussi de là…).
On dit aussi que Dassault ne savait pas rire ni même sourire. Il y a aussi du Picsou chez Carreidas : il occupe comme lui une posture anale en étant assis sur son gros tas (d’or). Mais contrairement au bien nommé Picsou, Carreidas n’est pas un capitaliste monomaniaque du fric, mais avant tout un obsessionnel de son vieux couvre-chef. Il est autant au sens propre qu’au sens figuré l’homme-qui-ne-se-découvre-jamais que celui qui ne rit jamais : éternel enrhumé, refusant de serrer la main par crainte de la maladie, incapable de parler de lui…
Carreidas donne raison à Bergson qui écrivait que le rire est le propre de l’homme, car cet homme-qui-ne-rit-jamais est un asocial, un solitaire, un pauvre type. Carreidas n’a donc rien de sympathique : il est radin (il choisit son avion le plus économique, il commande sa propre boisson mais en contenance familiale), il est tricheur (il installe une caméra pour espionner le jeu de bataille navale du capitaine Hadock), il est assurément un mauvais patron (ses employés complotent ouvertement contre lui). Il n’a ni ami ni amour. Il fait davantage figure de peine-à-jouir que d’un « killer ». Je disais qu’il était un pauvre type : Haddock le prend même pour un pauvre et lui fait l’aumône…
De quoi donc Carreidas tire-t-il son pouvoir de fascination ? Son nom déjà est un indice : un carré (et plus encore un carré d’as) est pour les pythagoriciens le symbole de la puissance, de la toute-puissance (puisque mise au carré). Son absence de rire (ou de sourire) ensuite : Buster Keaton ne rit pas davantage que Carreidas, mais ce héros positif est victime de ses propres mauvais coups, il échoue à devenir un champion, un gagnant. Buster Keaton ne rit pas (contrairement à Charlot) car il est sans psychologie. Ses gags ne doivent rien à son humanité mais à un simple enchaînement de faits conçu avec une précision littéralement géométrique… Carreidas tire son pouvoir de séduction de sa congruence finalement avec certains grands mythes. Il est la figure du moine-soldat, c’est l’homme ou la femme voué sa tâche, monomaniaque devant l’histoire, c’est celui qui sacrifie quelque chose en lui. Il y a en lui du Birkut, cet ouvrier de choc de l’Homme de marbre de Wajda, il y a du stakhanoviste.
Carreidas, c’est celui qui est d’un seul morceau, qui n’échappe pas à sa condition scolaire (celui qui refuse de regarder les oiseaux par la fenêtre de la classe pendant que la maîtresse fait sa leçon, c’est l’anti « gros Pierrot » de Michel Fugain), celui qui n’échappe pas à sa condition prolétaire (au point de battre les normes), celui qui n’oublie jamais la révolution (qui dévore ses enfants tandis qu’on ne peut avoir raison contre le parti).
Carreidas fascine car il est à l’image de ce surmoi auquel on voulait alors nous soumettre… L’homme-qui-ne-rit-jamais n’est pas l’antithèse de L’homme qui rit , ce grand roman philosophique de Victor Hugo… L’homme-qui-rit est aussi une mutilation de l’humanité. Souvenons-nous en au moment où le management moderne ne rêve que de « taylorisation du sourire » ! La vraie antithèse de l’homme-qui-ne-rit-jamais c’est l’ homo ludens , c’est la part d’irrationnel de nos existences. Seul Tournesol peut faire rire Carreidas !
Paul Ariès est rédacteur en chef du mensuel les Z’indigné(e )s. Dernier livre : Nos rêves ne tiennent pas dans les urnes, Max Milo, novembre 2013.
Laurent Mucchielli
Nelson Mandela et l’espoir de salut
« Aujourd’hui comme hier, si les hommes et les femmes qui dirigent les pays divisant notre monde avaient tous et toutes ne serait-ce que la moitié ou même un quart de la grandeur de Mandela, l’humanité ne serait pas dans le pitoyable état de guerre, de concurrence et d’égoïsme dans lequel elle stagne encore le plus souvent en ce début de XXIe siècle. Et, si l’on peut nourrir l’espoir que cet état a néanmoins progressé au fil des millénaires, c’est parce que, de temps à autre, des héros de ce genre se dressent pour nous rappeler où se trouve le chemin de notre salut. »
Laurent Mucchielli est sociologue, chercheur au CNRS.
Christine Delphy
Tarzan, l’indépendance absolue
« Il y avait peu d’héroïnes retenant mon attention dans les livres de mon enfance, hormis les personnages de la comtesse de Ségur et Jo, la plus intrépide des quatre filles du Docteur March. En fait, mon héros m’a contrainte très tôt à une forme de schizophrénie car c’était une figure masculine : Tarzan. Ce qui me plaisait chez lui, c’était une certaine idée de la liberté. J’avais alors comme obsession de trouver l’objet qui me rendrait totalement indépendante, comme Tarzan dans sa jungle, qui n’a besoin de rien, ni lit ni magasin, et vit en complète autonomie. »
Christine Delphy est sociologue, cofondatrice de la revue les Nouvelles Questions féministes.
Jean-Christophe Attias
Rimbaud, l’appel de l’Orient
« Je me souviens, accrochée au mur de ma chambre, d’une photo de Rimbaud arrachée à un numéro du Magazine littéraire. Qui donc me fascinait en lui ? L’aventurier, assurément, autant que le poète. Il y eut Proust, aussi. Je veux dire : le jeune Marcel. Lanza del Vasto, enfin, et son Pèlerinage aux sources. Hétéroclite panthéon ? Pas sûr.
Trois personnages mi-réels mi-fictifs, auteurs de leur propre vie, héros de leur propre récit. Et déjà, avec ces trois-là, l’amour de la littérature, le tourment de la mémoire, l’appel de l’Orient et la tentation du voyage. Passions que je retrouverai plus tard dans le judaïsme, dont j’ai fait mon métier. Un judaïsme vagabond, aimant le monde, accueillant à la musique des mots. Mais un judaïsme inquiet, doutant de la justice divine, ennemi des âmes « habituées ». Et où les personnages de fiction (Moïse, par exemple, sur lequel je travaille actuellement) sont aussi importants que les autres…
Où passe d’ailleurs la frontière ? C’est loin d’être clair. La preuve : Mon profil a été récemment supprimé d’autorité par Facebook. Mon forfait ? “Usurpation d’identité.” Cela me plaît assez qu’on m’accuse d’usurper ma propre identité. Serais-je donc moi-même un personnage de fiction ? Si seulement… »
Jean-Christophe Attias est titulaire de la chaire de pensée juive médiévale à l’École pratique des hautes études. Derniers ouvrages : les Juifs et la Bible (Fayard, 2012), Penser le judaïsme (rééd., CNRS Éditions, 2013).
Pour aller plus loin…

Le Collège de philo en danger
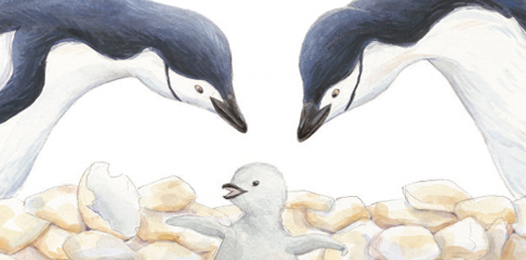
La théorie du manchot

Le corps médical et le corps social au bord de la fracture







