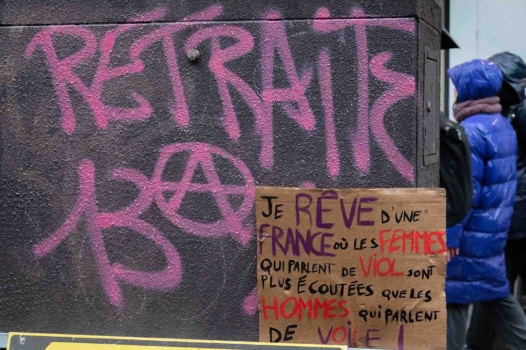La France en guerre : quelques questions
TRIBUNE. La France est-elle réellement entrée en guerre contre l’État islamique au sens du droit international, comme l’a annoncé le chef de l’État devant le Congrès ? Que recouvre l’usage du lexique guerrier ? La solution militaire peut-elle être l’unique réponse ?

Personne n’a pu échapper ces derniers jours au torrent ininterrompu de vocabulaire belliqueux et guerrier utilisé par la classe politique, balayant ainsi les réflexions fondamentales que sont celles du vivre ensemble, du fondamentalisme religieux, de la migration en direction de l’Europe ou encore des mesures à adopter contre les causes du terrorisme et non contre les symptômes qu’il produit.
Moult fois on a pu entendre que la France était en guerre, particulièrement lors du discours du Président devant le Congrès. L’utilisation de ce champ lexical peut cacher plusieurs intentions ou réalités qu’il est nécessaire de pleinement mesurer dans les intentions et les réalités qu’il caractérise.
Argument électoral ou intention politique
User du mot « guerre » relève généralement de l’argument électoral ou de l’intention politique destinés à adopter des mesures liberticides en cristallisant la peur ancestrale qui est celle de l’état de guerre. Car si l’on peut annoncer la
Sophie Clamadieu et Arthur Nguyen dao sont juristes en droit international.
À l’issue du Conseil de défense, François Hollande déclarait : « La France, parce qu’elle a été agressée lâchement, sera impitoyable à l’égard des barbares de Daech. » L’expression mérite d’être soulignée, notamment parce que l’emploi du terme relatif à l’agression ne s’inscrit pas seulement dans une argumentation politique, mais renvoie également à un vocabulaire précis de droit international.
Faut-il rappeler qu’en 1945 les États réunis à San Francisco au moment de l’élaboration de la Charte des Nations unies avaient consacré l’interdiction du recours à la force, en faisant ainsi de l’article 2 une pierre angulaire des relations interétatiques. Visé à l’article 51 de la Charte, l’agression demeure alors la condition indispensable à l’ouverture du droit de l’État à la légitime défense, celle-ci constituant alors la seule exception à l’interdiction du recours à la force en droit.
La légitime défense est alors devenue un argument majeur dans les déclarations des puissances occidentales, qui souhaitant s’engager dans la « guerre contre le terrorisme », n’hésitent pas à qualifier le terrorisme comme une véritable agression armée, un « acte de guerre » comme l’a souligné le Président François Hollande lors du discours du 14 novembre 2015. Au lendemain des attentats du World Trade Center, le Conseil de sécurité avait, dans sa résolution 1368, rappelé « le droit inhérent à la légitime défense » dont disposait tout État victime d’une attaque terroriste sur son territoire, non sans préciser que de tels actes représentaient une « menace à la paix et à la sécurité internationales » . Ainsi, force est d’admettre que le vocabulaire utilisé par François Hollande au cours de ses dernières déclarations ne vise pas seulement à convaincre son électorat du caractère indispensable des nouvelles opérations militaires en Syrie et en Irak, il la légitime également à l’égard de l’ensemble de la société internationale.
Un tournant dans la stratégie militaire française
Pourtant, les frappes militaires lancées contre Raqqa, la capitale autoproclamée de l’État islamique, dimanche 15 novembre, ne constituent pas une première pour la France, qui avait amorcé ses opérations contre le groupe jihadiste en Irak depuis le 20 septembre 2014, puis en Syrie depuis le 24 septembre 2015, aux côtés d’une coalition d’États dirigés par les États-Unis. Le 8 septembre 2015, dans une lettre adressée au Secrétaire général des Nations unies, la France avait justifié ses interventions en Irak et en Syrie sur la base de l’article 51, puisque les autorités irakiennes avaient demandé l’assistance de l’ensemble de la communauté internationale aux fins de lutter contre les attaques lancées par l’État islamique à partir du territoire syrien, qui risquaient à terme de menacer gravement l’existence de l’Irak, une justification qui avait également été soulevée par les États-Unis lors des premières opérations de la coalition internationale en septembre 2014.
Dès lors, la France est-elle réellement entrée en guerre contre l’État islamique au sens du droit international, comme l’a annoncé le chef de l’État devant le Congrès, ou le conflit armé existant ne prend-t-il pas une forme différente ?
Il est incontestable que les attentats du 13 novembre marqueront un tournant dans la stratégie militaire française au Moyen-Orient. Déjà, faut-il noter qu’un changement avait semblé s’imposer progressivement lorsque les autorités françaises avaient annoncé l’extension des frappes militaires à la Syrie, alors que celles-ci avaient jusque-là refusé d’intervenir dans le pays afin de ne pas donner l’impression de s’engager aux côtés de Bachar al-Assad.
Le temps de la réflexion
Mais la campagne massive de bombardement lancée contre « le fief de l’État islamique » laisse suggérer que le groupe jihadiste constitue désormais l’adversaire prioritaire de la France. Un fait qui, jusqu’à présent, ne paraissait pas certain dans la mesure où les puissances occidentales semblaient plus soucieuses de maintenir leurs intérêts géopolitiques que de détruire un ennemi commun. Reste alors à savoir si les attentats de Paris aboutiront à une réaction commune des puissances occidentales, à un consensus au sein des pays de l’Union européenne et à l’ouverture des négociations avec des États jusque-là considérés comme des adversaires, à l’instar de la Syrie ou de la Russie.
« Il ne s’agit pas de contenir mais de détruire Daech. » Les déclarations récentes laissent plutôt à penser qu’il ne s’agit pas de contenir mais bien de se barricader pour tenter de se prémunir contre Daech. D’ailleurs si l’option de l’opération militaire au sol de grande envergure est envisagée, comme l’indique l’intensification du dialogue avec les autres puissances militaires ainsi que la convocation d’une session extraordinaire du Conseil de Sécurité des Nations unies, certaines leçons ne doivent pas être oubliées.
Le désengagement plus que laborieux des Américains de l’Afghanistan quinze ans après l’invasion, la décomposition de l’État irakien qui a précédé la création de l’État islamique ainsi que la guerre civile qui ravage la société libyenne depuis l’éviction du colonel Kadhafi sont autant d’exemples qui démontrent que la solution militaire ne peut pas être l’unique réponse.
Dès lors, aujourd’hui ne doit pas être le temps de l’état d’urgence, du repli et de la réduction des droits fondamentaux et des principes démocratiques, mais aujourd’hui doit être le temps de la réflexion. Cette réflexion doit porter sur l’étendue de l’intervention militaire en tant que partie de la réponse globale et sur les moyens qui l’entourent, à savoir les moyens financiers, structurels, humains, politiques, éducatifs, de dialogue et d’intégration des acteurs locaux dans une perspective de destruction de Daech, car on ne peut combattre une idéologie uniquement par les armes.
Des contributions pour alimenter le débat, au sein de la gauche ou plus largement, et pour donner de l’écho à des mobilisations. Ces textes ne reflètent pas nécessairement la position de la rédaction.
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…

Au nom de la décarbonation, l’État allège la réglementation des installations polluantes

Reprendre la main sur le logement : défendre et amplifier la loi SRU

Ministres de la Justice et de l’Intérieur : respectez la liberté de la presse, renforcez le secret des sources !