« Idiotie », de Pierre Guyotat : La chair de la création
Dans Idiotie, Pierre Guyotat raconte les années de 1958 à 1962, quand il commence à publier alors qu’il est appelé pour faire la guerre en Algérie. Un très grand livre, politique et poétique, irréductible et tempétueux.
dans l’hebdo N° 1517 Acheter ce numéro

Soyons intrépides. Entrons dans cette splendeur qu’est Idiotie au risque d’être ébloui, nouvelle cathédrale dans l’œuvre de Pierre Guyotat, dont la présence tranche en cette rentrée dite « littéraire ». Idiotie compte parmi les livres à tonalité autobiographique de l’auteur (Coma, Formation, Arrière-fond), qui rompent avec les textes « en langue », réputés plus difficiles, tout en oralité, comme les deux volumes de Joyeux Animaux de la misère, publiés en 2014 et 2016, et dénommés par lui « jactances ».
Idiotie couvre la période allant de 1958 à 1962, quand Pierre Guyotat est âgé de 18 à 22 ans. C’est dans sa vie un moment clé : il commence à être publié, au Seuil, par Jean Cayrol, et est appelé sous les drapeaux, puis envoyé en Algérie en mars 1961. Autrement dit, l’œuvre s’ouvre et le citoyen naît. Guyotat va en effet découvrir les horreurs d’une guerre coloniale et les refuser, au point d’être accusé de complicité de désertion et de trahison, et jeté au cachot pendant trois mois. L’expérience de cette guerre pénétrera loin dans son inconscient d’écriture, donnant ensuite deux œuvres métaphoriques et capitales : Tombeau pour cinq cent mille soldats, en 1967, et Éden, Éden, Éden, en 1970, longtemps censurée.
Mais revenons à Idiotie. Et plus particulièrement à son titre. En son sens étymologique, « idiot signifie simple, particulier, unique […]. Toute chose, toute personne sont ainsi idiotes dès lors qu’elles n’existent qu’en elles-mêmes (1) ». D’une certaine façon, Idiotie est un récit d’émancipation. Il commence ainsi. Le narrateur-auteur, encore lycéen et – faut-il le rappeler ? – mineur à cette époque, fugue à Paris avec son jeune frère, les deux s’étant échappés pour quelques jours de Lyon, où ils résident chez un oncle. Là, dès les premières lignes, dans une incise essentielle, s’exprime la volonté de bouleverser son ethos : « Sur notre tapis de tente recouvrant les pavés entre deux coulées de pisse séchées – se lancer dans le sale, l’approcher, le toucher, le traiter, vivre enfin comme un homme passe par ce contact, ce “partage de la misère”, les saints s’y sont sanctifiés, ainsi devrai-je, de quelle façon ? y confronter mon goût du net, de l’ordre –, nous nous faufilons dans nos sacs de couchage. »
La mère est morte deux mois plus tôt, la tutelle du père n’est plus supportable : dès l’année suivante, le narrateur s’installe à Paris. Il y survit, mal, d’un petit boulot de coursier. Le tenaillent la faim et le travail d’écriture, auquel il se livre déjà depuis longtemps. Le vol d’un billet de 200 francs dans la maison familiale, découvert par ses sœurs, l’entachera d’une honte incommensurable.
En Algérie, il ne se plie pas davantage aux ordres. Il connaît d’emblée la prison parce qu’il a poussé ses camarades à la rébellion. La centaine de pages consacrées à son expérience dans la guerre sont impressionnantes parce qu’elles montrent un homme libéré des enrégimentements et des soumissions au mensonge. « J’y redécouvre le plaisir, l’assurance qu’on ne peut rien contre la pensée, fût-elle, celle fragile, d’un tout jeune homme », écrit l’auteur.
On aurait tort de penser que Pierre Guyotat se pousse du col – ceux qui l’ont déjà lu savent que c’est impossible. Il décrit ainsi l’implacable tension qui alors le porte : « L’indépendance proche d’un peuple dont c’est le droit, mon désir de créer ; entre ces deux réalités, l’une collective, l’autre individuelle, je ne suis rien. » Pas de place, dans son écriture, pour l’héroïsme ou le bel esprit. Face à la barbarie, le narrateur comprend ceci, aidé par sa lecture de Faulkner : « C’est de la bête que je dois faire une œuvre, de l’idiot qui parle […] – par l’idiot, détruire l’humanisme, comprendre le monstre politique ou de camp (le culturel n’a pas empêché la pire déshumanisation […]) – plus le mental et les préoccupations sont limités, plus le verbe est beau et ample : l’idée fixe comme percée et éclatement du réel. »
Où l’on retrouve l’idiotie, qui est aussi l’affirmation d’un point de vue. Non pas à ras de terre, mais dans un dénuement et une innocence qui permettent de voir dans la merde et l’immondice, autant que dans un vers de Rimbaud, la poésie. Idiotie est un puits de sensations et d’images, une exploration par les sens, faisant parfois surgir chez le narrateur des extases à la limite du fantastique : c’est « l’éclatement du réel ». « Toute lueur, tout bruit se change en parfum, toute odeur en couleur, en formes… »
Comme l’œuvre entière de Pierre Guyotat, Idiotie est traversé par la douloureuse opposition entre le sexe et la création. Le jeune narrateur est sous l’emprise d’une attirance quasi animale envers les femmes qu’il approche. Céder serait amoindrir, banaliser l’œuvre à venir. « Y risquer ce membre par l’érection duquel, depuis la prime adolescence, et le désir attenant dans tout mon être qu’il maintient jusqu’à son extinction, je tire les prémisses des figures, lieux, actions, verbe surtout, de ma poésie future ? »
Là encore, il est question d’une lutte intérieure pour une émancipation. Sauvegarder la promesse d’une œuvre inédite et transgressive exige de puiser en soi une énergie intacte et d’y trouver une « force de chair renouvelée » – tels sont les mots qui ferment Idiotie. Pierre Guyotat n’est pas un écrivain mystique. Il ne sépare pas le corps et l’esprit. Au contraire, sa quête de vérité est résolument matérialiste, dans une écriture qui allie le sang et l’air, le sperme et le ciel, la défécation et le sacré. « Rien n’est pur », écrit-il. C’est ainsi que la littérature est immense.
(1) Cf. Le Réel. Traité de l’idiotie, Clément Rosset, Minuit, 1978.
Idiotie, Pierre Guyotat, Grasset, 250 p., 19 euros.
Pour aller plus loin…

« Les Voleurs d’ampoules », une traversée initiatique

« La Ville » : qui sont vraiment les zombies ?
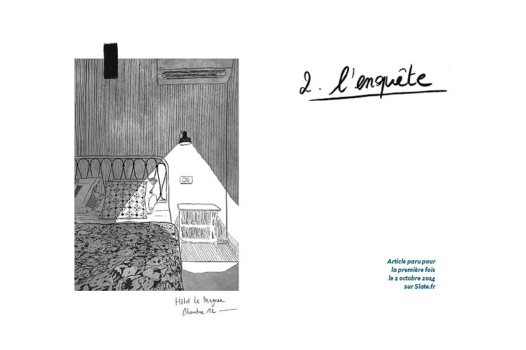
« Écrire Mazan » : avec Gisèle Pelicot, sortir de la sidération







