Une si longue absence
Dans La Première Année, Jean-Michel Espitallier met des mots sur la souffrance provoquée par la mort de sa femme et tente de trouver du sens à ce qui n’en a pas.
dans l’hebdo N° 1519 Acheter ce numéro

J e viens de pénétrer dans une zone inconnue. Dans la zone inconnue des choses qui arrivent. Qui finissent par arriver. Voici venue la période la plus triste de ma vie. » Jean-Michel Espitallier écrit ces phrases alors que l’état de sa femme, malade d’un cancer, décline subitement. Elle est à quelques semaines de sa mort, qui surviendra le 3 février 2015, à 1 h 58 précisément. Toutes les notations sont précises, dans La Première Année. Jean-Michel Espitallier ne néglige aucun détail, aucune information contribuant à fixer chaque instant dans la mémoire, à tenter de le rendre immortel…
La Première Année est un recueil de notes qui s’ouvre sur cette période, quand la femme de l’auteur entre à l’hôpital, et se prolonge jusqu’au 3 février de l’année suivante. Journal de la perte, de l’absence, mais peut-être pas de deuil. Parce que celui-ci est impossible, comme en atteste Roland Barthes dans le livre qui porte ce titre, Journal de deuil, cité par Jean-Michel Espitallier.
Parce que « faire le deuil » d’un proche, c’est en quelque sorte avoir accepté la tragédie de sa mort, parvenir à continuer à vivre malgré la douleur, qui devient supportable. Or « la résilience m’effraie », reconnaît l’auteur. Au cours de cette première année post-mortem, il relève toutes les premières fois sans sa femme, y compris les actes les plus quotidiens. Il redoute le passage du temps qui l’éloigne d’elle, lisse le souvenir et efface les traces. Il œuvre contre les trahisons inévitables de la mémoire, qui sont autant de trahisons de son amour.
Pour le poète, reste l’écriture. Comme un recours. Face à l’impuissance d’abord. Ce sentiment qui traverse tout le début du livre quand Jean-Michel Espitallier voit sa femme souffrir, partir, perdre peu à peu la conscience du monde. « J’ai toujours été pour toi celui qui résolvait tous les problèmes. Tu disais que j’étais un peu magicien. La protection dont je t’entourais me protégeait. Or la magie m’a quitté puisque cette fois-ci, qui était la seule fois où je ne devais pas rater mon tour, j’ai failli. »
L’écriture est aussi un refuge. Le seul endroit, sans lieu tangible, où l’auteur est en tête à tête avec la disparue. Ce qui ne va pas sans ce cruel paradoxe : les mots qui viennent pour l’évoquer, la réanimer, n’existent que parce qu’elle n’est plus là. D’autres raisons d’être à ce geste d’écrire se sont ensuite révélées à lui : « [La rédaction de ce livre] me donna bientôt les moyens d’une tentative d’élucidation, c’est-à-dire, au fond, de consolation face à la puissance invasive et irrationnelle de la mort. Elle fut aussi cet atelier où, durant cette longue année, je me suis installé pour tenter de redonner du sens à ce qui n’avait plus de sens. Pour tenter de faire. De faire avec. »
Mettre des mots sur un chaos, trouver une forme verbalisée à l’expérience du néant. « Je suis sous vide. » Désosser les expressions toutes faites. Atténuer l’encrage typographique pour symboliser l’effacement. Creuser des sensations, des émotions pour en découvrir la vérité. Comme celle-ci : « Ta mort m’a ôté la crainte de ta mort ». Tel est La Première année, où le « faire » dans le présent (écrire) écarte de cette folle obsession de n’être plus qu’un passé.
Peut-être est-ce seulement une fois posée la dimension irréductiblement éthique de ce livre que l’on peut s’autoriser à dire qu’il est d’une grande splendeur. En l’occurrence, cela signifie la présence d’une formulation, d’une image, qui irradie dans l’obscurité du désarroi ; le don d’une beauté partageable avec le lecteur. Par exemple : « Qu’est-ce que l’absence ? C’est une soif non étanchée. » Ou, pour dire qu’il n’a pas encore touché aux affaires de sa femme, l’auteur écrit : « Ici, à la maison, c’est Pompéi. » La Première année en est parsemé. De même qu’il rend compte de la ferveur d’un amour et du regard d’un homme profondément épris : « Je t’ai beaucoup admirée, Marina, et pas seulement pour ton courage […]. Je t’ai beaucoup admirée parce que tu vivais chaque instant avec une belle intensité. Un esthétisme authentique. Un mysticisme profane. Le culte gracieux de l’inutile. Un idéalisme sans concession. Une radicalité légère. Une rigoureuse exigence pour toi-même et pour les autres. Le regard artiste que tu posais sur le monde. Les merveilleux mystères de ta vie intérieure. » Ces mots sont indestructibles.
La Première Année, Jean-Michel Espitallier, Éd. Inculte, 160 p., 17,90 euros.
Pour aller plus loin…

« Les Voleurs d’ampoules », une traversée initiatique

« La Ville » : qui sont vraiment les zombies ?
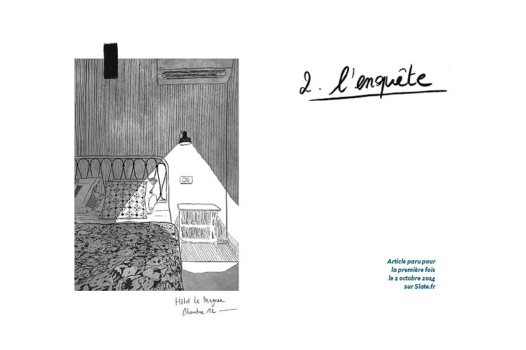
« Écrire Mazan » : avec Gisèle Pelicot, sortir de la sidération







