La Grande Guerre vue d’en bas
Le dessinateur Fredman donne un nouveau souffle aux Carnets de guerre de Louis Barthas, un témoignage empreint d’internationalisme et d’antimilitarisme, pour commémorer l’armistice de 1918.
dans l’hebdo N° 1527 Acheter ce numéro

Ceux qui voudraient célébrer le centenaire de la Grande Guerre par un prêche nationaliste ne le trouveront pas dans Les Carnets de guerre de Louis Barthas, réédités dans une adaptation graphique de Fredman. Ce document passionnant est en effet le récit autobiographique de « cinquante-quatre mois d’esclavage » au fond des tranchées, par un modeste artisan tonnelier de l’Aude, dont la plume nourrit une critique aiguë du militarisme et du nationalisme.
Le point de vue de Barthas est bien celui d’un homme du peuple envoyé au front contre son gré, mais aussi celui d’un militant socialiste. Il donne donc à lire une vision de classe, internationaliste et antimilitariste, constamment critique de la hiérarchie militaire, qui se sert des classes populaires comme chair à canon. Jusqu’à la désobéissance.
Ainsi, lorsque son capitaine lui intime de mettre les soldats au travail pour entretenir les tranchées, de jour et sous les fusils allemands, le caporal Barthas lui répond : « Je me refuse à exposer inutilement la vie de mes hommes. » Dégradé pour cela, il arrache lui-même ses galons et s’en réjouit :
En acceptant un grade si infime fût-il, on détenait une parcelle d’autorité, de cette odieuse discipline, et on était en quelque sorte complice de tous les méfaits du militarisme exécré. Simple soldat, je recouvrais mon indépendance, ma liberté de critiquer, de haïr, de maudire, de condamner ce militarisme cause de cette ignoble tuerie mondiale.
Le témoignage direct, soutenu par un dessin sombre et magnifique, rend palpables les pitoyables conditions de vie (et souvent de mort) des poilus. Comme l’intensité de leur désespoir et du sentiment d’injustice devant l’inanité de leur sacrifice. Mais il rend aussi compte de l’humanité qui demeure entre soldats du même camp et parfois avec ceux d’en face. Dans quelques-unes des plus belles pages du livre, Barthas raconte la fraternisation, un jour de décembre 1915, entre les soldats de sa tranchée et ces Allemands que les « rois déments, généraux sanguinaires, ministres jusqu’au-boutistes » ont désignés comme l’ennemi : un « élan de fraternité entre des hommes qui avaient horreur de la guerre et qu’on obligeait à s’entre-tuer malgré leur volonté ».
Puissant et émouvant, l’ouvrage de Barthas et Fredman est salutaire dans un contexte d’anniversaire de l’armistice, mais aussi de montée des nationalismes et de la xénophobie partout dans le monde.
Pour aller plus loin…

« Les Voleurs d’ampoules », une traversée initiatique

« La Ville » : qui sont vraiment les zombies ?
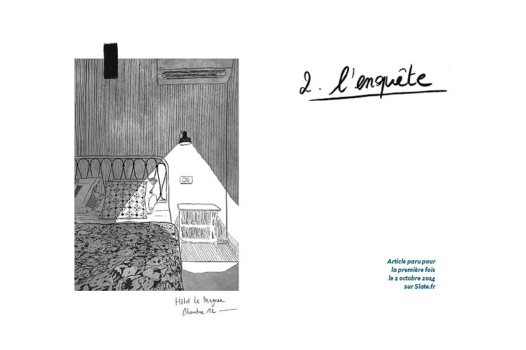
« Écrire Mazan » : avec Gisèle Pelicot, sortir de la sidération








