Scholastique Mukasonga, au nom des siens
L’écrivaine franco-rwandaise a raconté dans un récit paru au printemps dernier comment la soif de savoir lui a permis d’échapper au génocide des Tutsis. Poursuivant inlassablement son travail d’assistante sociale, elle soutient aujourd’hui les migrants.
dans l’hebdo N° 1527 Acheter ce numéro

Injonction paternelle : la réussite scolaire. Jusqu’à traîner sa fille, sous la menace d’un bâton, le jour de l’examen national. C’est aussi grâce à ce père, Cosmas, que le français, qu’il ne connaissait pas, est devenu pour elle une seconde langue. Cosmas s’était juré de sauver au moins un de ses enfants par l’école. Il ne s’est pas trompé. Ça valait bien, pour Scholastique Mukasonga, d’en faire le dédicataire de son dernier récit, Un si beau diplôme ! Celui d’assistante sociale, peut-être le seul choix de sa vie, pour exercer auprès des femmes paysannes. Le chemin sera âpre et laborieux. Elle le sait, parce que sa carte d’identité porte, « comme marque infamante », la mention « Tutsie ».
Scholastique Mukasonga naît en 1956 à Gikongoro, au sud-ouest du Rwanda, entre une mère fière de la noblesse de son lignage et un père intendant respecté et redouté, au service des chefs sous l’autorité coloniale. À la maison, on parle le kinyarwanda. En 1960, tandis qu’ont éclaté les premiers pogroms contre les Tutsis, sa famille est déplacée dans la région inhospitalière du Bugesera, à Nyamata. Elle a 4 ans seulement. « Je me revois dans une cour, confie-t-elle aujourd’hui, assise en tailleur dans la poussière, regardant l’affolement général. On avait été transportés toute la nuit dans un camion-benne et déversés à même le sol. Je m’accrochais au pagne de ma mère ! Ce n’est pas vraiment un souvenir de jeunesse, parce que je n’ai pas eu de jeunesse, mais des responsabilités, tantôt à épauler mes parents, tantôt à protéger mes petites sœurs. » Ce n’est qu’un début dans une existence de départs et d’arrivées, de valises faites et défaites.
Exil
Passé l’école primaire, l’adolescente réussit, en dépit de son statut ethnique, à s’inscrire au lycée Notre-Dame-de-Cîteaux, à Kigali, qui lui entrouvre « les portes du savoir ». Premières années de pensionnat, à 12 ans. Puis, contre toute attente avec ce maudit statut qui ne permet qu’à 10 % de Tutsis d’avoir accès aux études, elle est admise à l’école sociale de Karubanda, à Butare, à tout juste 16 ans. Réservé aux élites, placé entre les paysans et les politiques, confronté aux fréquentations des bourgmestres pour la promotion rurale, le métier d’assistante sociale fait rêver.
En 1973, comme toutes ses camarades tutsies, la jeune Scholastique est chassée de l’école de Karubanda. Le Burundi, territoire frontalier, est alors pour beaucoup de Rwandais la première étape sur le parcours de l’exil. « Je ne dirais pas [que c’est] une chance, on ne peut pas parler de chance à propos d’exil, mais l’opportunité d’accéder à des études supérieures », sans interdit, sans restriction. Elle reprend ses études à l’école d’assistantes sociales de Gitega, dirigée par des sœurs flamandes d’une sévérité morose, calées dans la surveillance tatillonne, mesquine, et « l’hypocrisie élevée au rang de vertu ». En face de l’école se dresse un pavillon abritant les lépreux. Il y a mieux que ça comme paysage pour qui ressent profondément « la lancinante désespérance de l’exil », a fortiori quand on reste esseulée, quand toute sa famille croupit dans la misère de Gitagata, à trois jets de pierres de Nyamata, sur une terre appauvrie où le spectre d’un massacre annoncé hante jours et nuits.
Pour tout bagage, Scholastique trimbale « [son] livre », à la couverture rouge et or, ramassé à l’occasion d’un séminaire : Le Comte de Monte-Cristo, qu’elle lit et relit, planque jalousement sous son matelas. Les malheurs d’Edmond Dantès la fascinent. Reviendra-t-elle, comme lui, au pays ? Mais faudra-t-il, comme lui plus tard, se venger ? En attendant, l’école devient son château d’If, entre solitude familiale et tristesse. Reste à trouver un abbé Faria et son trésor. Elle ne le devine pas encore, mais ce trésor sera celui de « pouvoir écrire », de s’employer au français (depuis l’école primaire), parce que la langue est une identité, « et cette identité, on me l’avait niée. Elle était devenue une menace de mort, qu’il a fallu raviver par la voie de la langue ».
Stages et séminaires se suivent. Avant de décrocher ce « si beau diplôme ». Ça n’empêchera pas infortunes et déboires. À commencer par l’impossibilité d’une affectation parce que les femmes burundaises demeurent prioritaires. Scholastique Mukasonga se mue en secrétaire particulière d’un riche Hollandais, le temps d’obtenir enfin son précieux sésame, à 20 ans, un contrat local au sein de l’Unicef pour travailler auprès des paysannes et à la promotion des femmes. Pendant cinq ans, elle parcourt les collines de la province de Gitega, à la fois agronome, diététicienne et infirmière, s’efforçant d’améliorer le sort et les conditions de vie de ses habitantes.
Feuille blanche
C’est en arpentant les sentiers sinueux de cette région que la jeune diplômée rencontre celui qui deviendra son mari, à 24 ans : un Français en service national actif, Claude, chargé de recueillir auprès des anciens les traditions orales du Burundi. On appelle ça un tournant dans la vie. Ce n’est certes pas le premier, ce ne sera pas le dernier. Deux enfants naissent, Aurélien et Joël. En 1986, Scholastique suit Claude, muté à Djibouti. Température différente et amère expérience. Il lui faut du temps pour s’habituer et finalement apprécier ces paysages rappelant à Rimbaud « l’horreur présumée des paysages lunaires ». À défaut de trouver un poste, elle marne bénévolement pour une congrégation religieuse, découvre effarée, auprès de la population locale, l’excision et l’infibulation. À Djibouti s’affirme en Scholastique le sentiment profond de son identité : une Africaine. « Au Rwanda, j’étais une Tutsie, une étrangère dans mon propre pays, un cafard en sursis, au Burundi une exilée, partout dans le monde une apatride selon le HCR. »
À l’été 1992, la longue carrière africaine de Claude s’achève. Retour en France, dans la banlieue populaire et métissée de Caen. Avec soulagement et la certitude, pour Scholastique, d’exercer à nouveau sa profession. N’a-t-elle pas son diplôme ? Que nenni ! Elle constate que « la France des vacances, la France ensoleillée de juillet et d’août, n’est pas la France du quotidien, celle de la recherche d’emploi » : son diplôme n’a aucune valeur. Vexation, mais pas d’humiliation. « Je me devais de rester debout, pour représenter ma famille et les 10 % de quota. Ce qui compte, c’est de traverser les obstacles. » Rebelote pour trois années de formation dans une école, après le passage d’un concours. Examen écrit d’abord. Qu’à cela ne tienne. « J’ai toujours eu une préférence et une grande facilité pour ce mode d’expression, confie-t-elle dans Un si beau diplôme ! Face à la feuille blanche, c’est une invitation à “vider son sac”, comme un devoir accompli. » Cela se vérifiera plus tard, mais Scholastique ne manque ni d’assurance ni d’opiniâtreté. Elle le répète : « J’ai écrit le français avant de le parler. » Elle aura tôt fait de trouver un poste en Normandie, d’abord à l’université de Caen, ensuite à l’Union départementale des associations familiales du Calvados (Udaf), mandataire judiciaire, chargée des tutelles. « Je travaille dans l’empathie, reconnaît-elle, sans doute parce qu’il s’agit de protéger les personnes et de s’opposer aux agressivités. »
Tabou
C’est donc depuis sa Normandie que Scholastique Mukasonga apprend à la télévision, le 6 avril 1994, qu’un génocide est déclenché au Rwanda. « L’extermination programmée allait se mettre en marche. Et je savais qu’à Gitagata, où il n’y avait que des Tutsis, personne n’en réchapperait. » Elle traverse ces jours en somnambule. Il y a de quoi : à -Gitagata, trente-sept membres de sa famille sont massacrés. Un chiffre, des visages. Ceux de son père et de sa mère. Scholastique comprend : l’école, l’exil, le diplôme. Un toutim pressenti par ses parents.
Il n’y aura pas de tombes. Les crânes et les os reposent aujourd’hui dans les vitrines d’une église de Nyamata transformée en mémorial. Il s’agit de négocier avec un irrépressible sentiment de culpabilité, sans faire son deuil, qui signifierait l’oubli. « Les miens, qui n’ont pas de sépulture, sont toujours avec moi. » Sans esprit de vengeance non plus. « C’est bien trop négatif, trop égoïste, s’emporte-t-elle_. Il ne faut pas être otage de l’histoire. »_
Lent et douloureux exercice qui pourrait bien passer par l’écriture. Ça prend des années, et une décennie avant de retourner au Rwanda, quand les médias français entament une commémoration. « Ce retour est resté longtemps tabou. Je ne voulais pas être faible mais sûre d’affronter une réalité nue. » Après ce voyage, Scholastique Mukasonga décide de publier un texte qui ne pouvait plus rester dans un tiroir. Récit autobiographique, Inyenzi ou les Cafards, publié chez Gallimard en 2006, est articulé autour des corps de Tutsis gisant dans les charniers, ces Tutsis que durant leur vie on avait traités de cafards. Tout juste bon à être écrasés.
Deux ans plus tard, La Femme aux pieds nus dessine un hommage à la figure maternelle, à toutes les mères courage survivant dans le chaos de Nyamata. Un récit salué par le prix Seligmann contre le racisme. D’autres livres s’ajoutent. Avec une régularité de métronome, toujours témoignant du Rwanda. En 2012, l’écrivaine reçoit le prix Renaudot pour Notre-Dame du Nil. Dans l’histoire presque centenaire de ce prix, -Scholastique Mukasonga est la première femme noire à être distinguée. « Mais je ne suis pas si noire que ça, s’esclaffe-t-elle. Surtout, j’ai reçu cela comme une récompense collective, un apaisement. Je prête ma plume à ceux qui ne parlent plus. Mes livres ne sont pas les miens, mais les nôtres. »
Jusqu’à Un si beau diplôme !, son œuvre est à lire comme une longue route contre l’oubli. L’oubli, et ce rapport aigu à l’altérité. D’où l’impérieux besoin de rester assistante sociale. Dans un paysage particulier, où les vaches paissant habillent les prés, où les cimetières du débarquement se sont révélés des lieux de recueillement et d’inspiration. L’impérieux besoin aussi de se rapprocher des migrants. Encore une histoire d’identification. Ce fut Edmond Dantès. C’est aujourd’hui un Somalien, un Soudanais, un Afghan… À Ouistreham, à -Bretteville-sur-Laize, aux portes de son domicile de Saint-Aubin-sur-Mer. Elle se déplace, discute, interroge, aide, fait des courses, participe à un petit-déjeuner…
« Quand je les ai vus, dans le froid, je ne pouvais plus rentrer chez moi. Le froid, je le ressentais. Je me suis vue quarante ans plus tôt, aussi jeune qu’eux, car beaucoup sont mineurs. Ce qui m’impressionne, c’est d’observer combien ils sont porteurs d’espoir, de leur famille, de tout ce qu’ils ont laissé là-bas, après un dur voyage. Il faut voir leur regard, leur sourire ! C’est une réponse à l’inhumanité des politiques, au rejet, à l’exclusion. Mais il existe des Justes en Normandie, des gens qui donnent de leur temps, de leur générosité, modestes, comme ceux que je fréquente tous les jours. Personne ne baisse les bras. » Une jubilation pour Scholastique, que seul le confort « inquiète ». Ceux-là « rebondissent, ils ne tombent pas ». Comme Edmond Dantès.
Un si beau diplôme !, Scholastique Mukasonga, Gallimard, mars 2018.
Pour aller plus loin…

« Les Voleurs d’ampoules », une traversée initiatique

« La Ville » : qui sont vraiment les zombies ?
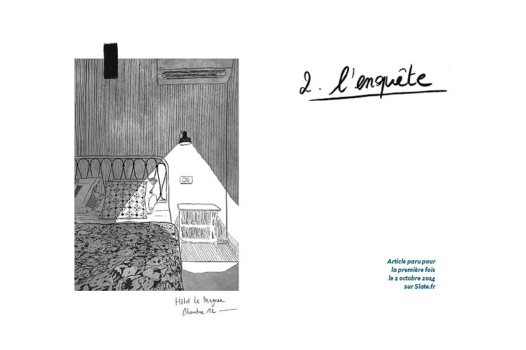
« Écrire Mazan » : avec Gisèle Pelicot, sortir de la sidération







