« Marcher jusqu’au soir », de Lydie Salvayre : Drôle d’endroit pour une rencontre
Dans Marcher jusqu’au soir, Lydie Salvayre évoque avec rage et humour son rapport tumultueux à l’art au long d’un parcours introspectif.
dans l’hebdo N° 1549 Acheter ce numéro

Soudain, Lydie Salvayre écrit en lettres majuscules : « Regarder ces œuvres m’est une corvée et je me fais violence en continuant cette expérience à la con. » Cette « expérience à la con » a consisté à passer toute une nuit au musée Picasso, à Paris, alors que s’y tenait l’exposition Picasso-Giacometti (c’était durant l’hiver 2016-2017), pour éventuellement en tirer un livre.
Quand elle trace cette phrase sur l’écran de son ordinateur, au milieu de la nuit, la lauréate du Goncourt 2014 a la rage. Entre elle et L’homme qui marche, la sculpture qu’elle aime plus particulièrement, avec laquelle elle espérait entrer dans un dialogue intime, il ne se passe rien. Nada. « Je voyais [l’œuvre de Giacometti] comme séparée de moi par une paroi invisible », écrit-elle.
Qu’est-ce qui cloche ? C’est toute la question de Marcher jusqu’au soir, qui provoque chez Lydie Salvayre d’abord un mouvement de rogne qui n’est pas sans drôlerie, puis un travail d’introspection l’emmenant loin. Elle aurait pu s’en tenir à des constats extérieurs, en particulier le peu d’estime dans lequel elle tient les musées. Des lieux consacrés, qui coupent les œuvres de la vie, concentrent un art « nettoyé de son contexte, un art nettoyé du scandale qui marqua son apparition », ainsi rendu « parfaitement inoffensif ». Elle aurait pu attiser sa haine des « dévots de l’art », de la cuistrerie excluante, de la soumission aux valeurs marchandes, notamment dans l’art contemporain – mais notons que, toute à sa colère, et sans se départir de son humour, Lydie Salvayre garde heureusement à l’esprit les limites de l’exercice, qui peut confiner au « poujadisme ».
D’autres raisons expliquent le fiasco de cette confrontation nocturne. L’auteure le sent bien, perdant de son assurance, saisie par toutes sortes de « questions à deux balles », et en qui remontent des souvenirs. Comme celui de ce dîner dans la bonne société où elle fut conviée jadis et où, devant sa discrétion, une des convives la renvoya à sa condition inférieure sous la forme d’un chuchotement qui lui fut rapporté : « Elle a l’air bien modeste. » La remarque lui mit les nerfs à vif et pourrait être à l’origine de son engagement dans l’écriture.
Lydie Salvayre a longtemps souffert du stigmate social, elle qui était fille de prolétaires espagnols, ce stigmate qui impose des complexes, écrase, humilie. Elle l’énonce crûment, comme si, pour reprendre les termes d’Annie Ernaux, elle voulait « venger sa race ». Mais, aujourd’hui, elle en est sortie. Alors elle poursuit son enquête introspective, sa marche dans ses recoins intérieurs – qui forme ce livre même – où elle rencontre réellement Giacometti et son œuvre. Elle évoque ce qui fait à ses yeux la grandeur de celui-ci : son sens de l’échec. Tenter de saisir avec la matière, encore et toujours, ce qui échappe : une vie dans un être, une présence dans un visage. Lydie Salvayre rappelle cette citation célèbre de Samuel Beckett (dont les préoccupations étaient proches de celles de Giacometti, qu’il rencontra) : « Essayer encore. Rater encore. Rater mieux. »
L’obstination dans le ratage, auquel beaucoup d’autres, en littérature, se sont livrés (Virginia Woolf, qui a droit à un beau développement, mais aussi Flaubert, Rimbaud, Gogol, Artaud, Pavese…), est d’une noblesse si rare face aux « réussites » qui font briller, comme brille la vaisselle. « Cette conscience dans un impossible à atteindre pouvait permettre de s’en approcher un tout petit peu, ce qui était, me dis-je avec fierté, la position des libertaires espagnols pendant la guerre de 36, la position de mon oncle Josep et de mon oncle Juan, et la position aujourd’hui si décriée des anars », écrit l’auteure dans un prolongement audacieux de l’art à la politique.
« L’immense modestie » de Giacometti – rétif à l’argent et aux honneurs, quand le succès arriva – « et le sentiment profond qu’il avait de ses limites et de ses insuffisances, qui lui permirent de concevoir L’homme qui marche », placent haut l’exigence pour ceux qui l’admirent, comme Lydie Salvayre. Mais on ne sent jamais chez elle l’intention de se situer sur le même plan, une présomption qui aurait pu faire écran et la tenir à l’extérieur de l’œuvre pendant sa nuit au musée. C’est bien en spectatrice qu’elle s’y est rendue, prête à recevoir, à se nourrir, dotée de ce dont dispose toute spectatrice, c’est-à-dire tout être humain, d’un esprit et d’un corps. Mais c’est précisément à sa propre condition humaine, bornée, misérable, que la sculpture a renvoyé Lydie Salvayre, rendue plus fragile encore à cause de la maladie. L’homme qui marche est sans pitié.
Marcher jusqu’au soir, Lydie Salvayre, Stock, « Ma nuit au musée », 224 pages, 18 euros.
Pour aller plus loin…

« Les Voleurs d’ampoules », une traversée initiatique

« La Ville » : qui sont vraiment les zombies ?
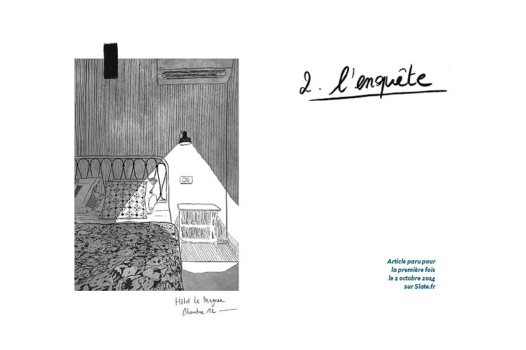
« Écrire Mazan » : avec Gisèle Pelicot, sortir de la sidération







