Louis-Philippe Dalembert, le poète passe-frontière
Attentif à la générosité immédiate et au sort des exilés, l’écrivain haïtien raconte dans son nouveau roman le destin de trois femmes qui traversent la Méditerranée, fuyant la guerre et l’horreur.
dans l’hebdo N° 1576 Acheter ce numéro

Après avoir perdu, pour l’une, sa meilleure amie, pour l’autre, son petit frère, Chochana et Semhar se sont fait une promesse : entre elles désormais, c’est à la vie à la mort. Les deux jeunes femmes auraient pu se rencontrer dans mille autres lieux plus heureux que celui-ci, mais la sécheresse au Nigeria et la dictature en Érythrée en ont décidé autrement. Elles ont dû quitter leur famille, prendre tous les risques, éviter les contrôles, voyager à l’arrière de pick-up débordant d’épuisés, certains devenus fous, retenir leur souffle dans des containers brûlants. Toujours à la merci d’accompagnateurs sans scrupule.
Leurs routes finissent par se croiser dans cet entrepôt à Sabratha, en Libye, lieu d’horreur où des passeurs rôdent et violent en piochant parmi les corps usés, défigurés par la violence et les nuits blanches. Elles y restent une éternité. Jusqu’au jour où le groupe est emmené vers un chalutier, devant lequel des centaines de personnes attendent. Une Syrienne passe devant Semhar et la bouscule avec dédain, c’est Dima. Elle a dû quitter son immeuble cossu d’Alep, frappé par les bombes. Pour la bourgeoise, habituée à ne concevoir les personnes à la peau noire que comme des laquais, l’Europe n’était pas sa destination première. Surtout si elle avait su que le voyage se faisait avec autant de Subsahariens. Mais la guerre les a poussés, elle, son compagnon, Hassan, et leurs deux filles, à rejoindre l’Italie. Une fois embarquées, Chochana, Semhar et Dima voyaient leurs cauchemars d’exil s’éloigner comme l’horizon libyen. Pourtant, l’enfer est à bord.
Les trois personnages féminins de Louis-Philippe Dalembert, dans son nouveau roman, Mur Méditerranée, racontent des vies qui disparaissent souvent derrière des chiffres, des titres de presse et des bandeaux de chaînes d’information en continu. Pourtant, l’écrivain n’a pas voulu tourner le dos à la brutale réalité. Il a construit son récit à partir d’un fait qui s’est bien produit : le sauvetage par le pétrolier danois Torm Lotte, en juillet 2014, de 600 personnes à bord d’un chalutier à la dérive entre Lampedusa et la Libye. Il a d’ailleurs découvert cette information dans Les Bateaux ivres du reporter Jean-Paul Mari (1)_. « Mon but premier consistait à remettre de l’humanité en lieu et place du vocable “migrant”, qui renvoie à un statut jamais accompli »,_ explique l’auteur haïtien, dont le travail, depuis son premier roman, Le crayon du bon Dieu n’a pas de gomme (2), se loge dans les valises et les rêves de l’humanité en déplacement. Le natif de Port-au-Prince connaît bien la banalisation des mots par l’usage répété qu’en fait la presse : lui-même fut journaliste. Un épisode qui est derrière lui aujourd’hui, même si ce rapport à l’investigation lui est resté, comme pour cet ouvrage, où Louis-Philippe Dalembert a passé un mois à Lampedusa afin de rencontrer des exilés, des acteurs associatifs, mais aussi un anthropologue, Marco Aime, qui vit sur l’île.
« L’évidence de la poésie »
« J’ai fait la connaissance d’Italiens qui ne sont pas dans le militantisme actif. C’étaient de vieux pêcheurs, ils accueillaient des Érythréens. Des gens de mer pour qui il est impossible de ne pas tendre la main à la vue de personnes en détresse », explique l’auteur.Cette générosité immédiate, ce composant essentiel de ce qui fait communauté, rebondit chez lui dans de nombreux écrits. Comme avec le poème « Un homme a tendu la main », adressé à Cédric Herrou, chez qui il voit « un homme ni tout à fait toi / ni tout à fait moi / un homme qui n’a rien / hormis tout à perdre ». C’est celui qui « saute dans l’arène au nom de l’humain », aide l’homologue en danger de mort, « mêle les rires et la foi », « ramasse sa chute et colmate les blessures », puis soigne ses « genoux rompus d’avoir tant imploré le néant ». À la manière d’un George Orwell qui a théorisé cette « common decency », traduit souvent comme un « sens moral inné », Louis-Philippe Dalembert dit aussi s’inspirer de la « petite bonté » chez Vassili Grossman. Cet élan populaire était considéré par l’écrivain soviétique comme un geste dépolitisé, désarmé de ces idéologies qui dressent l’autel du Bien mais jalonnent leurs promesses d’actes de violence ou de mort. Il y a pourtant du politique chez le polyglotte haïtien, ne serait-ce que parce que ses récits et ses poèmes portent sur le thème de l’ailleurs, de l’exil, de cet « étranger » à qui il fait souvent référence. « Ma poésie n’est pas un nuage / dansottant entre ego et libido / ma poésie saigne / et se rebelle / de l’incommensurable désastre du monde », écrit-il en novembre 2000 dans un texte intitulé « Manifeste », qui se poursuit ainsi : « La poésie éclate rugit / en mélopées nues / escorte l’absence sous nos pas muets / ressuscite l’espoir interdit de séjour. »
C’est justement par la poésie que Louis-Philippe Dalembert, né le 8 décembre 1962, dit être « entré en littérature ». Le fils d’institutrice, qui a perdu son père très jeune, laisse surgir ses premiers vers à 16 ans, « un âge où l’on croit pouvoir renverser la dictature par un poème », dit-il aujourd’hui avec un sourire aux commissures déçues. « Nous n’avions accès à la littérature haïtienne que par la voie de polycopiés distribués en classe. Sous la dictature de François Duvalier, les extraits n’allaient jamais au-delà de 1957 », date où « Papa Doc » a été élu, avant de se nommer président à vie en 1964. Ces lectures sont immédiatement soutenues par « l’évidence de la poésie », un genre majeur en Haïti et dont une des références populaires a marqué l’écrivain : « Mon pays que voici », long poème d’Anthony Phelps qui décrit l’histoire de l’île, de l’ancienne colonie française, Saint-Domingue, jusqu’au XXe siècle. Il parvient à publier son premier recueil de poésie, Évangile pour les miens, auréolé de la vingtaine rageuse. Il entre ensuite à l’École normale supérieure de Port-au-Prince et reçoit les enseignements de Yanick Lahens, la romancière haïtienne aujourd’hui responsable de la chaire « Mondes francophones » au Collège de France. « Il était brillant, parmi les meilleures élèves. Je l’avais remarqué. Après l’ENS, nos routes se croisent de l’autre côté de l’océan, en France, où je constate que nous partagions le même éditeur de l’époque, Le Serpent à plumes », explique celle qui est devenue une de ses plus proches amies. Pour la lauréate 2014 du prix Femina avec Bain de lune, « Louis-Philippe Dalembert écrit la frustration de ceux qui restent et le déchirement de ceux qui partent ».
Porter la voix d’haïti
Yanick Lahens se rappelle aussi ces jours passés aux côtés de son ancien élève après le séisme en Haïti, le 12 janvier 2010, où ils étaient tous deux « sonnés, pétrifiés ». Un cauchemar dont les répliques se retrouvent dans certains livres de l’écrivain, notamment Ballade d’un amour inachevé, où il fait également référence au tremblement de terre que l’Italie avait subi en avril 2009. L’homme connaît bien la région pour y avoir vécu plusieurs années. Mais c’est dans Avant que les ombres s’effacent, paru en 2017, que Louis-Philippe Dalembert déploie toute l’épaisseur du roman nomade, avec Haïti comme toile de fond. Il écrit l’histoire de Ruben Schwarzberg, un docteur né d’une famille juive polonaise en 1913 qui, pour fuir le nazisme, se réfugie en Haïti : l’État ayant – fait méconnu – voté un décret-loi en 1939 qui autorise les consulats à délivrer des sauf-conduits à tous les Juifs persécutés demandant protection. Vieillard quand les terribles secousses déchirent en 2010 « ce tout petit pays qui a planté sa gueule de caïman dans la chair de la mer Caraïbe », le personnage principal décide de raconter l’épopée familiale à sa petite-cousine. À l’image de ce décret-loi et de la déclaration de guerre à l’Allemagne nazie qui l’a suivi, Haïti sait clamer sa voix aux oreilles du monde comme en 1804, quand elle devint la première république noire libre.
Aujourd’hui, cette parole exemplaire rejoint celle des Chiliens, des Libanais, des Algériens, des Soudanais, qui, malgré des passés et des contextes différents, exige d’être considérée. La pénurie de carburant fin septembre a été le révélateur d’une pauvreté systémique sur l’île. Des manifestations ont lieu tous les jours. Louis-Philippe Dalembert n’est pas surpris de voir cette quête, violente ou non, de la dignité par le bas, lui qui a essayé la chose publique en participant au cabinet de Raoul Peck, le cinéaste et ministre de la Culture à partir de 1996. L’aventure a tourné vinaigre – « c’était mon seul passage en politique et ce sera le dernier », conclut-il. « Louis-Philippe est moins résistant à l’expérience du pouvoir », avance Yanick Lahens, elle aussi membre du cabinet à cette époque. Ce n’est pas pour autant que l’écrivain s’éloigne de la politique. « Je me demande si, dans certains pays comme en Haïti, on peut faire l’économie d’une révolution », note-t-il, avant d’ajouter : « Si cela arrive, je pourrais bien remettre les mains dans le cambouis. » Après tout, l’huile noircie est de la même couleur que l’encre.
(1) JC Lattès, 2015.
(2) Stock, 1996.
Mur Méditerranée Louis-Philippe Dalembert, Sabine Weispieser éd., 336 p. 22 euros.
Pour aller plus loin…

« Les Voleurs d’ampoules », une traversée initiatique

« La Ville » : qui sont vraiment les zombies ?
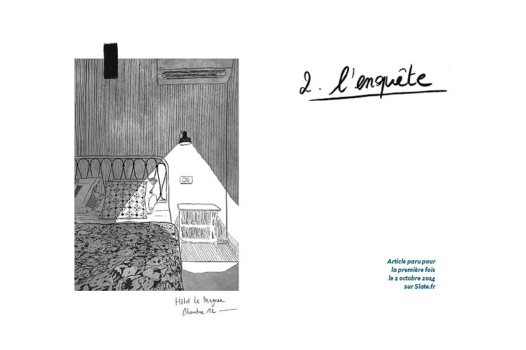
« Écrire Mazan » : avec Gisèle Pelicot, sortir de la sidération







