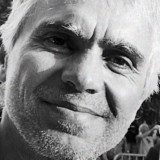« Le déboulonnage des statues interroge le déni de la France face au colonialisme »
La chercheuse Maboula Soumahoro juge ces actes utiles à l’ouverture de débats esquivés en permanence en France, à condition de ne pas en rester au stade du symbole et d’interroger en profondeur le récit national.

© Patricia Khan
États-Unis, Angleterre, Belgique, Italie, France, etc., plusieurs pays ont connu des actes de déboulonnage de statues ou de plaques de rue dédiées à des personnes liées au colonialisme ou à l’esclavagisme. Dimanche dernier, Emmanuel Macron s’est positionné très fermement : « La République n’effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire (…) Elle ne déboulonnera pas de statues. » De quoi donner raison à Maboula Soumahoro, chercheuse ivoiro-française et maîtresse de conférences à l’université de Tours, militante féministe et anti-raciste, qui souligne combien la France élude tout débat sur les relents du colonialisme. Son dernier ouvrage, Le Triangle et l’Hexagone (2020, la Découverte), pose la question d’une identité noire en France.
Le temps est-il venu d’un débat planétaire sur le colonialisme ?
Maboula Soumahoro : On peut s’interroger : pourquoi est-ce la mort de George Floyd, plus qu’une autre, qui a déclenché ces mouvements ? L’horreur des images ? Pourtant, l’exhibition du corps noir mourant ne date pas d’aujourd’hui — tabassage dans les émeutes, anciennes cartes postales de lynchages, etc. Au-delà du raz-le-bol de la persistance du tabou, la pandémie que nous traversons a sûrement joué un rôle. Le covid-19 a beaucoup plus touché les populations noires que les autres — chômage, décès, pauvreté accrue… Elles subissent un trop-plein de vulnérabilité.
Le mouvement semble-t-il en mesure d’imposer un débat dans notre pays ?
On a tendance à présenter ces revendications comme nouvelles. Or, ce n’est absolument pas le cas ! Il existe un activisme constant sur ces questions, depuis des années et notamment dans les pays anglo-saxons. Pour déboulonner les figures de Cecil Rhodes en Afrique du Sud, du général Lee aux États-Unis, etc. Et… en Martinique ! La statue de Schœlcher a été brisée fin mai, avant le meurtre de George Floyd par un policier blanc. On n’en a pas parlé, ou si peu ! Et avant, il y avait eu, en 1991, la décapitation de la statue de Joséphine de Beauharnais, soupçonnée d’avoir convaincu Bonaparte de rétablir l’esclavage en 1802.
Mais justement, on en parle désormais. Les choses bougent-elles enfin ?
Le fond de l’affaire, c’est pourtant la persistance d’un déni français, auquel même le traitement du sujet comme d’une pseudo-nouveauté contribue. Car enfin, il y a fallu un George Floyd. Comme toujours, la France ne se saisit de ces questions que par détour. La cristallisation ne s’est produite chez nous, de manière inattendue, qu’en raison d’un intérêt constant pour la question du racisme aux États-Unis. Comme d’habitude, les commentaires traitent des États-Unis, sans jamais se laisser interpeller par le racisme ici, au nom d’un jugement lapidaire récurrent : « La France, ce n’est pas les États-Unis. » Sans les qualités stratégiques du Comité Adama, qui a su s’appuyer sur l’énorme couverture médiatique de la mort de George Floyd, le sujet du racisme et de l’anti-colonialisme serait resté confidentiel en France, à ce jour. Aujourd’hui, l’hypocrisie des autorités se retourne contre elles.
Le déboulonnage à Fort-de-France de la statue de Victor Schœlcher, qui a contribué à mettre fin à l’esclavagisme, a pu être interprétée comme le geste de nostalgiques de cette époque, alors qu’il n’en est rien. Comment l’expliquez-vous ?
Car ce n’est pas seulement la figure de ce personnage qui était visée, mais plus largement le « schœlcherisme », c’est-à-dire le point de vue adopté dans le récit de la décolonisation et de l’abolition de l’esclavagisme aux Antilles. Car enfin, qui valorise-t-on pour cela via le mobilier urbain ? Une figure blanche et paternaliste de « grand sauveur ». C’est un parti pris. N’existe-t-il donc pas d’autre manière de célébrer ces actes ? Les révoltes d’esclaves ont pourtant été précurseuses !
Certaines personnes estiment qu’il faut préserver la place de ces personnages controversés dans l’espace public, pour ne pas renier l’Histoire ; d’autres le contestent, jugeant qu’il ne s’agit que d’hommages mémoriels datés. Prenez-vous position dans ce débat ?
Je ne propose pas de hiérarchie entre Histoire et mémoire. Le débats sur le déboulonnage des statues ou des noms de rue sont les bienvenus dans le sens où ils brisent le silence et ouvrent des boîtes fermés. Et le sujet n’est pas tant être « pour » ou « contre » ces actes, mais bien de questionner la manière dont le récit national a été inscrit dans l’espace public. Cependant, ces mouvements en resteront à la couche du symbolique s’ils ne parviennent pas à provoquer des questions structurelles et institutionnelles. Ainsi, après avoir éliminé ses statues de l’espace public, va-t-on toucher à la fortune accumulée par Léopold II de Belgique ? Le pays envisagera-t-il des réparations au Congo ?
Comment la France parvient-elle, plus que d’autres pays, à repousser le débat d’une relecture de son récit national ?
Parce qu’on escamote, depuis toujours, les relents du colonialisme par une dénégation lapidaire : « Ça n’existe pas chez nous. » Ce déni est facilité par la dichotomie d’une République distanciée de ses territoires d’Outre-mer : l’esclavagisme a pris place en dehors de l’Hexagone, où pendant longtemps les Noirs n’étaient pas présents, ce qui a permis d’institutionnaliser l’amnésie. Contrairement aux États-Unis, où les Noirs font partie de la nation, sur l’ensemble de son territoire même.
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…

Roger Martelli : « La gauche doit renouer avec la hardiesse de l’espérance »

Ces personnalités de gauche qui obsèdent l’extrême droite

Qui a peur du grand méchant woke ?