Prenons soin de notre hôpital !
Alors que le service public hospitalier s’apprête à subir de nouveaux coups durs, une association mise tout sur la participation citoyenne à travers une proposition de référendum d’initiative partagée.
dans l’hebdo N° 1660 Acheter ce numéro

© Masha Mosconi/Hans Lucas/Hans Lucas/AFP
L ’hôpital public, ce n’est pas uniquement le combat des soignants », note avec évidence Tiphaine Le Roux, coprésidente de la toute nouvelle association de défense du système hospitalier « Notre hôpital, c’est vous », lancée en mai. Seul et unique objectif de la structure : porter une proposition de loi au nom de « l’accès universel à un service public hospitalier de qualité » via un référendum d’initiative partagée (RIP). Dès que la procédure s’arrêtera (1), « en espérant qu’elle aille le plus loin possible, l’association disparaîtra », assure le professeur David Grabli, neurologue à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, et coprésident de l’initiative.
L’idée de cette proposition de loi, explique le médecin, est d’inscrire dans la Constitution « des mesures de bon sens », maintes fois réclamées, qui visent « à renverser et à modifier le paradigme actuel » de l’hôpital public. En clair, fixer les moyens (lits, personnels, matériels, etc.) en fonction des besoins de la population sur les territoires, et non pas d’une logique budgétaire délétère. Dans les faits, « il n’y a pas de rupture avec les revendications qui sont portées par les mouvements de défense de l’hôpital public depuis plus de deux ans, continue Tiphaine Le Roux, éditrice de bande dessinée de métier, faisant référence aux collectifs inter-urgences et inter-hôpitaux (CIU et CIH) nés en 2019, dont l’association est justement issue. La crise
Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :
Pour aller plus loin…

En CRA, le double enfermement des personnes psychiatrisées
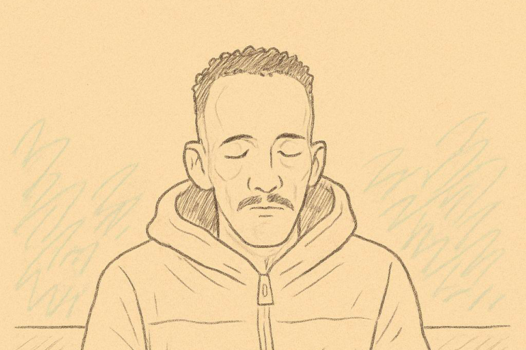
Ahmed N. voulait « soigner sa tête » : à Calais, les exilés abandonnés face aux souffrances psychologiques

Minute de silence pour Quentin Deranque : « Une ligne rouge a été franchie »







