« La fille qu’on appelle », de Tanguy Viel : Emprise municipale
Dans La fille qu’on appelle, Tanguy Viel met en scène des personnages chez qui les rapports de domination sociale se mêlent à la question du consentement. Une tragicomédie actuelle et provinciale.
dans l’hebdo N° 1669 Acheter ce numéro

© Leonardo Cendamo/Leemage/AFP
Sur la scène d’une ville portuaire et bretonne, quatre personnes sont les protagonistes d’une tragicomédie provinciale. Même si Tanguy Viel détaille les traits psychologiques de ses personnages – le faisant davantage que dans ses romans précédents –, il les caractérise aussi par leur apparence. D’un côté, ceux qui sont socialement dominés : Max et Laura Le Corre, père et fille. Ils ont leur corps pour seul actif, qu’ils dénudent l’un comme l’autre à l’occasion, en fonction de ce qu’ils ont à faire.
Max, la quarantaine, un boxeur du cru ayant connu vingt ans auparavant des victoires retentissantes – dont un championnat de France –, en proie ensuite à une chute vertigineuse, effectue depuis peu son come-back. Il a « le corps lourd et tendu », tout en muscles. Celui de Laura est, quant à lui, tout en charme. Avec sa plastique splendide, elle a été recrutée très jeune par des rabatteurs pour faire du mannequinat, quand ce n’étaient pas des photos de nu. Aujourd’hui, à 20 ans, elle est de retour dans sa ville natale pour oublier ce passé récent et vivre une existence moins sulfureuse.
De l’autre côté, les dominants sont davantage caractérisés par leur tenue, leur maintien. Un duo d’hommes mûrs aux intérêts convergents, se servant l’un de l’autre, ayant noué un réseau de relations serviles. L’un, Franck Bellec, maître d’un haut lieu de la ville – le casino –, arbore un éternel costume blanc depuis qu’il est parti de rien. L’autre, le seigneur féodal, Quentin Le Bars, occupe le château, autrement dit l’hôtel de ville – « dans les cabinets des maires persiste l’Ancien Régime ». Costume conforme à sa fonction, embonpoint naissant, classique à 48 ans.
Dans l’idée, on pourrait rapprocher La fille qu’on appelle de l’œuvre de Simenon, par son intrigue, ses oppositions sociales, son atmosphère. Pas quand on rencontre ce genre de phrases, emblématiques de la langue élaborée et limpide de Tanguy Viel, aux métaphores fulgurantes et venimeuses, en l’occurrence à propos de la relation qu’entretiennent Le Bars et Bellec : « Deux araignées dont les toiles se seraient emmêlées il y a si longtemps qu’elles ne pouvaient plus distinguer de quelle glande salivaire était tissé le fil qui les tenait ensemble, étant les obligés l’un de l’autre, comme s’ils s’étaient adoubés mutuellement, dans cette sorte de vassalité tordue et pour ainsi dire bijective que seuls les gens de pouvoir savent entretenir des vies entières, capables en souriant de qualifier cela du beau nom d’amitié. »
Le livre précédent de l’auteur, Icebergs (1), portait sur l’écriture. Tanguy Viel s’y désolidarisait d’une littérature dont on exige une « positivité nouvelle », « qui pourrait bien se héroïser trop vite en de nouvelles croisades sociétales », « une littérature de société », « si prête à se faire sociologie ou reportage au travers de la première fiction venue ». Or La fille qu’on appelle recèle au cœur de son intrigue un thème très actuel, fort commenté dans les médias, suscitant de grands succès d’édition : l’emprise et la question du consentement. Max, dont le métier alimentaire est d’être le chauffeur du maire, a demandé à celui-ci s’il pouvait recevoir sa fille pour -l’aider à lui trouver un logement. Le Bars va exiger de Laura quelques compensations en échange de ses (piètres) services : il lui obtient une chambre au casino de Bellec, où elle devient entraîneuse.
Tanguy Viel donne à comprendre comment Laura entre dans cette relation avilissante. Même si son narrateur est à la troisième personne (là encore, une nouveauté par rapport à ses romans précédents), il est au plus près du phénomène d’emprise, décrivant avec subtilité l’inertie qui saisit la jeune femme : « Quand j’ai senti la paume tiède de sa main, c’était comme si ma propre main n’était plus la mienne, et qu’alors c’était toute l’énergie du vivant en moi qu’il avait réussi à saisir, à contrôler ou magnétiser, je ne sais pas, en tout cas à partir de là il a pris le pouvoir… » Là où l’auteur n’entre pas dans ce qu’il nomme « la littérature de société », dont la « positivité nouvelle » aspirerait à « réparer le monde », pour reprendre le titre d’un essai du critique et universitaire Alexandre Gefen, c’est qu’il ne cède rien au petit théâtre de la ville portuaire où se déroule son roman.
D’abord en respectant la logique sociale qui préside aux scènes de la vie de province. Balzacien en diable (dans l’ambition qui est la sienne), Le Bars ne se satisfait pas d’être maire. Il accède au poste de ministre des Affaires maritimes. La consécration d’un parcours que la société (médiatique, en particulier) estimera réussi, y compris dans ses aspects les moins reluisants, toujours prompte à défendre le plus fort face aux menaces venant de plus faibles, comme la plainte finalement déposée par Laura.
Ensuite en introduisant une dimension cocasse, à la limite du burlesque, dans la résolution de son intrigue. Elle est due à l’intervention du père de Laura, Max, à qui toute cette histoire a fait perdre la tête – « comme si le cerf-volant qui lui servait d’esprit s’était emmêlé dans les branches d’un arbre tout là-haut dans les cieux et qu’une déesse infernale ricanait en en tirant les fils », écrit Tanguy Viel.
La fille qu’on appelle, le -huitième de son auteur, n’est pas un roman consolant, malgré le plaisir qu’il procure. Il raconte l’efficacité sociale du cynisme, parfois teinté de scrupules. « Mais comme on dit qu’il y a loin de la coupe aux lèvres, il y a des kilomètres aussi chez certains hommes entre les scrupules et la morale. » Effet mimétique ? On sort de ce livre en ayant soi-même envie d’asséner des coups…
La fille qu’on appelle, Tanguy Viel, Éditions de Minuit, 176 pages, 16 euros.
(1) Éditions de Minuit, 2019.
Pour aller plus loin…

« Les Voleurs d’ampoules », une traversée initiatique
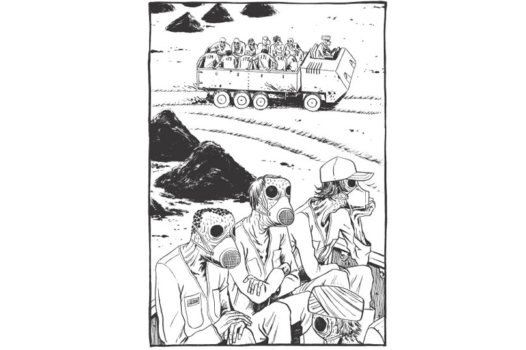
« La Ville » : qui sont vraiment les zombies ?
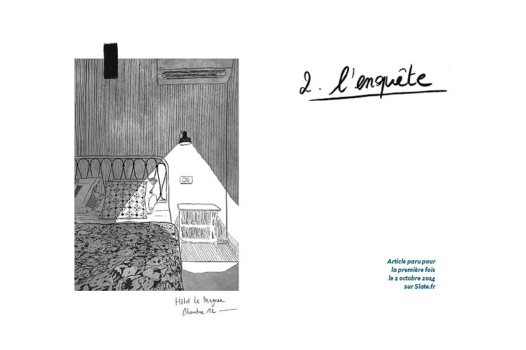
« Écrire Mazan » : avec Gisèle Pelicot, sortir de la sidération







