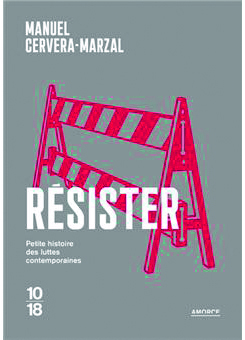Les luttes, c’est classe, et en plein renouveau !
Le sociologue Manuel Cervera-Marzal décrypte l’évolution des mobilisations face à une répression toujours plus brutale.
dans l’hebdo N° 1723 Acheter ce numéro

En juin 2008, Nicolas Sarkozy déclarait, dans un sourire arrogant : « Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s’en aperçoit. »
Résister. Petite histoire des luttes contemporaines, Manuel Cervera-Marzal, éd. 10/18, coll. « Amorce », 128 pages, 6 euros.
Ce fut le cas en 1986 lors du mouvement contre le projet de loi Devaquet, en 1993 contre le Contrat professionnel d’insertion (CIP), et en 2006 contre le Contrat première embauche (CPE). Mais assez rares furent les autres moments d’affrontements lors de défilés dans les rues de Paris ou d’autres grandes villes.
Dans ce petit essai dense, mais à la lecture aisée, Manuel Cervera-Marzal, sociologue à l’université de Liège, spécialiste des mobilisations contestataires contemporaines, estime que les choses ont changé après la mort de Rémi Fraisse. Ce jeune militant écolo avait été tué dans la nuit du 25 au 26 octobre 2014 par l’explosion d’une grenade offensive de la Gendarmerie lors d’une manifestation contre le projet de barrage à Sivens (Tarn).
Désinstitutionalisation de la manifestation
Depuis, « les règles du jeu ont volé en éclats ». Et l’auteur de souligner : « Les premiers à les avoir brisées sont les policiers et leurs donneurs d’ordre : désormais, au lieu de laisser les manifestants défiler en paix, on interdit leur manifestation et, si elle a lieu malgré l’interdiction, on frappe, on gaze, on matraque, on insulte, on mutile, on éborgne, on humilie. Toutes proportions gardées, c’est un peu comme si une partie d’échecs s’était muée en combat de boxe ; une guerre de position devenue guerre de mouvement. »
En quelques années seulement, s’est ainsi opérée « une désinstitutionalisation de la forme manifestation ». Pourtant, après des années où les défilés, aussi massifs fussent-ils, ne faisaient plus vraiment peur aux puissants ou gouvernants – tout simplement parce qu’ils se contentaient d’en ignorer les causes et les revendications –, les attaques contre les droits sociaux et les services publics n’ont fait qu’augmenter les contestations dans une société soumise à une double logique, néolibérale et sécuritaire, les deux ayant d’ailleurs un « lien consubstantiel ».
Dans un véritable « engrenage de la violence », renforcé par les incessants états d’urgence (antiterroriste puis sanitaire) rognant toujours plus les libertés fondamentales et étendant les prérogatives des forces de l’ordre, les manifestations sont devenues « de moins en moins légitimes ». Aussi, du fait qu’elles étaient plus durement réprimées, leur morphologie s’est assez rapidement reconfigurée.
On connaît la suite : augmentation du nombre de blessés, manifestants venant avec des protections et sans leurs enfants, dans une sorte de militarisation informelle du défilé populaire, qui recouvre certaines formes de ceux du XIXe siècle. « C’est la petite nouveauté des années Hollande », ironise le sociologue. Une « nouveauté » qui place la France parmi « les démocraties défaillantes », aux côtés de la Hongrie d’Orban ou du Brésil de Bolsonaro. C’est ce qui ressort de la publication d’une soixantaine d’indicateurs par nos confrères anglais de The Economist.
Ceux que les grands médias et les gouvernants désignent comme les casseurs sont une forme majeure de la reconfiguration des manifs.
Alors que les violences policières ont fortement augmenté, surtout depuis les longs mouvements contre la loi travail (2016) puis des gilets jaunes (2018-2019), les black blocks ou « cortèges de tête », ceux que les grands médias et les gouvernants désignent comme « les casseurs », sont assurément une forme majeure de cette reconfiguration des manifs.
Militantisme réinventé
Pourtant, leurs actions parfois contestables, qui se veulent une réponse autant à la violence policière qu’à la violence sociale (ou néolibérale), se voient souvent comprises par l’opinion, sinon approuvées – nombre de manifestants n’hésitant plus à défiler à leurs côtés en guise de soutien ou de protection. Mieux, la violence policière incite souvent des « primo-manifestants » à passer à l’acte, mus soudain par un sentiment d’injustice et un réflexe de révolte. Comme ces pères de famille en gilets jaunes sous l’Arc de triomphe, arrivés en criant « les CRS avec nous », et qui se mettent à lancer des pavés après les matraquages et les tirs de LBD dans la foule.
Dans cette « petite histoire des luttes contemporaines », Manuel Cervera-Marzal dresse un répertoire des pratiques de résistance collective les plus récentes, en laissant une large place aux occupations dans l’espace public et aux ZAD (zones à défendre). Il montre ainsi comment l’imaginaire militant et ses pratiques se sont récemment renouvelés, adaptés, réinventés, délaissant les classiques défilés, pétitions et meetings, pour répondre à une répression brutale et systématique. Mais aussi pour surprendre des gouvernants méprisant les anciennes formes de lutte collective. Toujours vive, l’imagination (militante) vibre encore.
Pour aller plus loin…

Yassin al-Haj Saleh : « Le régime syrien est tombé, mais notre révolution n’a pas triomphé »

Accélérationnisme : comment l’extrême droite engage une course à la guerre raciale

Sarah Durocher : « Il y a une stratégie mondiale concernant l’attaque des droits sexuels et reproductifs »