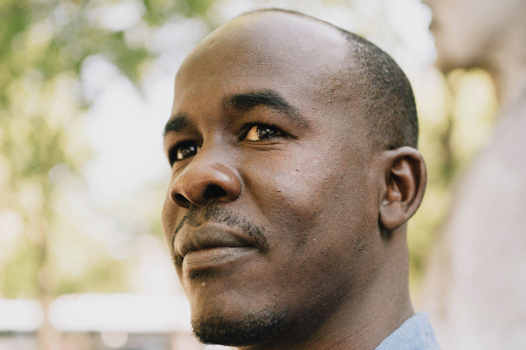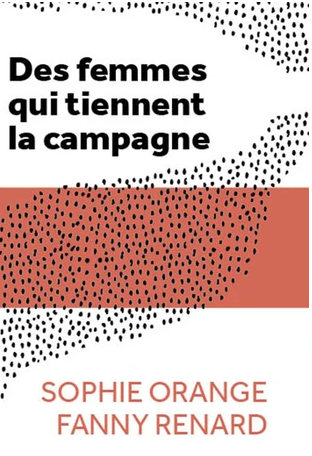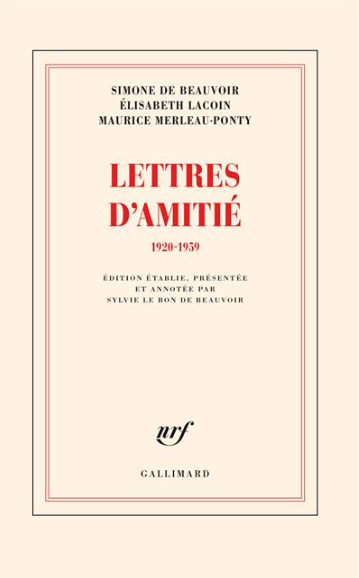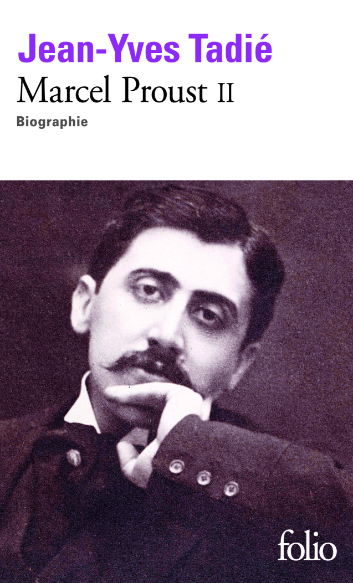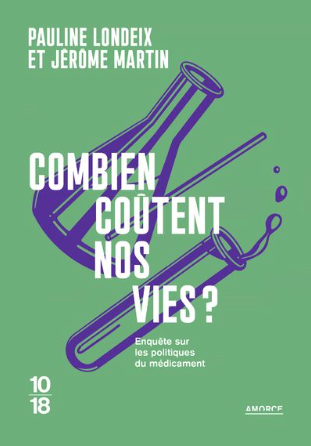Celles qui restent
Voici un ouvrage qui propose un autre regard sur la place des jeunes femmes des milieux populaires. C’est à la campagne qu’elles se mobilisent pour déjouer l’abandon de l’État et ainsi faire ruralité.
dans l’hebdo N° 1740 Acheter ce numéro

© Chantal BRIAND / AFP.
Des femmes qui tiennent la campagne, Sophie Orange et Fanny Renard, La Dispute, 232 pages, 15 euros.
À la lecture de Des femmes qui tiennent la campagne, il est difficile de ne pas immédiatement penser au médiatique Ceux qui restent, de Benoît Coquard (La Découverte, 2019). Comme dans celui-ci, Sophie Orange et Fanny Renard, respectivement maîtresses de conférence à l’université de Nantes et à celle de Poitiers, parlent de ces jeunes qui refusent de quitter leur milieu rural pour aller en ville.
Sauf qu’ici les autrices délaissent les paysages postindustriels des campagnes en déclin du Nord-Est, pour explorer celles du Centre-Ouest de la France, marquées par un relatif dynamisme économique, associatif et démographique.
Autre différence majeure, l’ouvrage, se fondant sur les témoignages de 60 femmes de 20 à 30 ans, prend un angle peu exploré de la sociologie de la ruralité, où les autrices proposent de voir les stratégies mises en place par quatre « institutions » – l’école, le marché du travail, les communes et la famille – pour les inciter à y rester.
Ainsi, elles mettent à mal l’idée reçue selon laquelle ces jeunes femmes des classes populaires resteraient par manque d’ambition ou par défaut. En vérité, ces institutions ont tout intérêt à les garder car ce sont bien ces « bandes de femmes » qui tiennent les services essentiels et pallient le retrait de l’État social des campagnes depuis les années 1980.
« Destins suggérés »
Ainsi, si les métiers du lien aux autres, tels les auxiliaires de vie, lesagents territoriaux spécialisés des écoles maternelles(Atsem), les coiffeuses ou les aides à domicile, y sont surreprésentés, c’est parce que les institutions fabriquent des « destins suggérés », comme l’analysent les autrices.
Le parcours scolaire de ces jeunes femmes dessine des vocations spécifiques vers ces métiers essentiels mais aussi précaires et invisibles. Parmi les mécanismes observés, il y a l’offre locale de formation vers laquelle elles se tournent souvent, à défaut d’avoir les moyens d’étudier ailleurs. Au niveau des diplômes professionnels (BEP ou CAP), le service à la personne est le secteur le plus représenté en milieu rural.
Mais, avant même de s’orienter massivement vers ces filières, les jeunes femmes sont « déjà inscrites depuis longtemps dans un système de solidarités locales où elles prennent toute leur part », rappellent Sophie Orange et Fanny Renard.
Qu’il s’agisse de s’occuper des grands-parents, des petits frères ou des petites sœurs, de faire du baby-sitting dans le voisinage, elles ont des compétences situées socialement que convoitent les offres locales de formation. Et c’est un autre point intéressant relevé par les autrices : loin d’être prises par défaut dans ces filières, ces jeunes femmes sont « repérées et choisies » par les organismes de formation.
Qualifiées, plus diplômées que leurs parents et que leurs conjoints, jeunes et disponibles, elles ont tendance à accepter des conditions de travail à forte pénibilité et des bas salaires. Emplois à temps partiel et contrats courts, mobilité pendulaire, isolement… Le marché du travail en milieu rural cherche à attirer ces jeunes travailleuses « sans les préserver des conditions d’emploi difficile et des marges du salariat ». Ainsi, dès l’âge de 25 ans, elles peuvent être déjà « brisées par le travail ».
Actrices du lien social
D’un autre côté, l’ouvrage renverse le stéréotype qui dépeint la campagne comme un espace masculin car plus traditionnel. Loin d’être recluses au foyer, les jeunes femmes sont actrices du lien social. Elles comptent pour la majorité de la fonction publique locale et du tissu associatif.
L’une des images les plus frappantes est la place qu’occupent les salons de coiffure et instituts de beauté, similaire à celle des cafés autrefois, qui ont progressivement disparu des campagnes. Alors que 32,7 % des agglomérations en zone rurale sont pourvues en coiffeurs contre 26 % en boulangerie, il serait malvenu de considérer comme risibles ces « véritables institutions locales » tenues essentiellement par des femmes.
En choisissant d’analyser finement les déterminismes de cette sédentarité spécifique, Fanny Renard et Sophie Orange offrent une grille de lecture nouvelle des espaces ruraux, de ses classes sociales et dynamiques de genre.
Les autres livres de la semaine
Lettres d’amitié (1920-1959), Simone de Beauvoir, Élisabeth Lacoin et Maurice Merleau-Ponty. Édition établie, présentée et annotée par Sylvie Le Bon de Beauvoir, Gallimard, 464 pages, 24,90 euros.
L’amitié tient une place centrale dans la jeunesse. Ces « lettres d’amitié » entre Simone de Beauvoir, Élisabeth Lacoin (la « Zaza » adorée des mémoires de l’auteure du Deuxième Sexe) et Maurice Merleau-Ponty, rencontré à la Sorbonne, relatent les tourments philosophiques et existentiels propres à leur âge. Entre Zaza et Maurice naît bientôt un lien amoureux, à une époque qui s’avère être une prison pour les deux jeunes filles bien plus que pour le garçon. Cette amitié dans ce trio épistolaire verra bientôt Zaza s’y briser : elle décède à 21 ans, et ce drame annonce la conviction féministe de l’alors « jeune fille rangée »…
Marcel Proust. Biographie (tomes I et II), Jean-Yves Tadié, Folio/Gallimard, 688 et 828 pages, 10,20 euros chacun.
Le centenaire de la disparition de Marcel Proust s’achève, marqué qu’il fut par une avalanche de publications et de rééditions – dont un très original volume de ses Essais dans la « Pléiade ». Spécialiste de l’œuvre, directeur de l’édition de la Recherche dans la même collection de référence, Jean-Yves Tadié propose une édition augmentée en poche en deux volumes de sa monumentale biographie. D’une enfance choyée mais souvent douloureuse au jeune homme mondain, de l’homosexuel placardisé au malade ne quittant plus sa chambre pour écrire sans cesse, on ne peut s’interrompre de relire ce portrait d’un écrivain qui a tout sacrifié à la littérature.
Combien coûtent nos vies ? Enquête sur les politiques du médicament, Pauline Londeix et Jérôme Martin, 10/18, coll. « Amorce », 108 pages, 6 euros.
Depuis la pandémie de covid, on s’est enfin rappelé que l’accès aux médicaments était entièrement dicté par des logiques mercantiles. On entend aujourd’hui qu’on manque d’antibiotiques et même de Doliprane en France. Tous deux anciens responsables d’Act Up-Paris, fondateurs du récent Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, Pauline Londeix et Jérôme Martin dénoncent l’opacité de celles-ci, entraînant l’impossibilité pour les citoyens de voir garanti leur droit fondamental à la santé. Cet essai vient nourrir l’exigence d’une réappropriation collective des politiques pharmaceutiques. Qui ne soient pas laissées aux multinationales. Un essai majeur.
Pour aller plus loin…

Accélérationnisme : comment l’extrême droite engage une course à la guerre raciale

Sarah Durocher : « Il y a une stratégie mondiale concernant l’attaque des droits sexuels et reproductifs »

Les intellectuels trumpistes au cœur de la nouvelle droite américaine