« La Chambre de Mariana » : voir sans être vu
Emmanuel Finkiel adapte un roman d’Aharon Appelfeld.
dans l’hebdo N° 1859 Acheter ce numéro

© Cinéfrance Studios - Curiosa Films - Metro Communications - United King Films - Proton Cinema - Tarantula - Arte France Cinema 2024
Après La Douleur (2017), tiré du texte éponyme de Marguerite Duras, Emmanuel Finkiel a adapté un roman d’Aharon Appelfeld, La Chambre de Mariana. Le cinéaste pensait en avoir fini avec cette période – déjà, son premier long métrage, Voyages (1999), avait pour protagonistes de vieux Ashkénazes hantés par la Shoah. Mais un élan nécessaire, lié à son histoire familiale, l’a à nouveau orienté vers cette époque.
L’adaptation du roman d’Appelfeld posait de sérieux problèmes de mise en scène s’annonçant comme des défis. La Chambre de Mariana raconte en effet l’histoire du jeune Hugo (Artem Kyryk) confié par sa mère juive, en 1943, dans l’Ukraine occupée, à une prostituée (Mélanie Thierry, étincelante, qui a appris l’ukrainien pour le rôle). Celle-ci a accepté de le cacher dans un placard de sa chambre. Comment développer un récit dans des espaces aussi exigus ? Que montrer, et à partir de quel point de vue ? Les solutions trouvées par Finkiel sont fécondes.
ImaginaireÀ partir de peu – un trou dans une paroi, un bout de fenêtre… – Hugo voit une toute petite partie du monde : des soldats de la Wehrmacht en goguette, ou la vie heurtée de Mariana, alternativement dépressive et enjouée, mais toujours droite. Il entend aussi, et bien davantage (la bande-son a ici une importance singulière). Ce qu’il perçoit alimente son imaginaire, qui alterne avec sa mémoire, active dans son réduit, lui faisant revivre des scènes de sa vie d’avant, notamment de son anniversaire avec toute sa famille réunie.
Protégé par Mariana, le garçon est projeté dans la vie intime de la jeune
Il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire :
Pour aller plus loin…
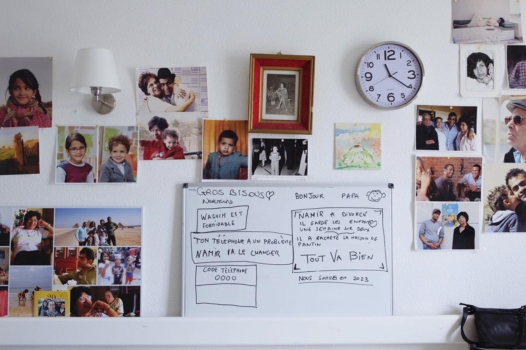
« Me tourner vers mon arabité, c’est recouvrer mon intégrité »

« Promis le ciel », une nécessaire sororité

« La Reconquista », une remontée du temps







