La France et la justice sociale de convenance
En mars dernier, Raphaël Glucksmann demandait aux États-Unis de rendre la statue de la Liberté, offerte par la France en 1886. Une sortie révélatrice de l’anti-impérialisme des politiques français·es lorsqu’il s’agit des États-Unis et qui permet de se poser en moraliste, derrière un écran de fumée révisionniste historique.
dans l’hebdo N° 1860 Acheter ce numéro

© Robyn Beck / AFP
Pour que Raphaël Glucksmann déclare que le moment actuel exige le retour de la statue de la Liberté, il faut s’interroger : pourquoi les moments précédents n’ont-ils pas suscité une telle demande ? Comment un pays bâti sur le génocide et l’esclavage, en pleine ségrégation à l’époque, a-t-il pu se voir offrir une statue censée incarner la liberté ? Mais poser ces questions obligerait aussi à questionner la légitimité de la France à se présenter comme arbitre des valeurs de liberté, alors qu’à l’époque du don, elle imposait à Haïti une rançon pour son indépendance, poursuivait son entreprise coloniale, et recourait massivement aux travaux forcés.
Une situation loin d’être nouvelle : en 2018, les macronistes votent contre la proposition de La France insoumise d’inscrire le droit à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception dans la Constitution. Mais, surprise, en 2022 : au lendemain de la décision de la Cour suprême américaine de renverser l’arrêt historique Roe V. Wade, qui garantissait le droit constitutionnel à l’avortement depuis 1973, et une semaine après avoir fait entrer l’extrême droite en masse à l’Assemblée, les macronistes s’approprient la proposition de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale et resoumettent le texte.
Il serait facile de pointer du doigt la droite et ses apparenté·es (Glucksmann), mais cette tendance existe aussi dans les partis de gauche et dans le monde intellectuel. Dans la même veine, quelle ne fut pas ma surprise (et mon scepticisme) d’apprendre que même les universités françaises, pourtant si promptes à s’opposer aux départements d’études noires et ethniques – où l’on compte sur les doigts d’une main les universitaires non-blanches détenant une habilitation à diriger des recherches –, en manque chronique de ressources, se sont soudain revendiquées comme des havres pour universitaires américain·es victimes de backlash.
Pendant ce temps, outre-Atlantique, la riposte s’organisait pour défendre les initiatives en matière de diversité et d’inclusion.
Mais, malheureusement, l’exode de masse vers la France n’a pas eu lieu. Et la riposte pour défendre les initiatives en matière de diversité et d’inclusion n’a pas eu lieu : les départs se faisaient vers le Canada. Et pendant ce temps, outre-Atlantique, la riposte s’organisait pour défendre les initiatives en matière de diversité et d’inclusion. Une défense qu’on aurait espéré voir aussi dans l’Université française, notamment face aux attaques de l’extrême droite contre les collègues comme Nacira Guenif ou Maboula Soumahoro, ou pour freiner l’exode des universitaires non-blanches et non-blancs vers l’Amérique du Nord, la Belgique, la Suisse ou la Grande-Bretagne.
Autre exemple récent, le 21 avril 2025, Jean-Luc Mélenchon, en tournée nord-américaine, était de passage à New York. Lors d’un discours fleuve consacré à la traduction de son dernier livre publié chez Verso, intitulé Now, the People ! Revolution in the Twenty-First Century, censé présenter le nouvel appareil idéologique de la gauche, il a ressassé les vieilles chimères : une France fantasmée, « sans pétrole ni terres rares, seulement riche de cerveaux et d’éducation », sans jamais mentionner l’entreprise coloniale à l’origine de l’accumulation des richesses, ni la présence française sur cinq continents facilitant l’exploitation des océans, ni le néocolonialisme mettant la puissance française au service des multinationales.
Une posture encore plus aberrante au Québec, où il a évoqué la souveraineté et les territoires sans un mot pour la question coloniale ni pour le sort des peuples autochtones, alors même que l’actualité canadienne est saturée par les découvertes de cimetières d’enfants autochtones enterrés près des anciens pensionnats.
Cet anti-impérialisme facile repose sur une réécriture de l’histoire qui fait commencer le capitalisme à l’industrialisation.
Au lendemain de l’attentat perpétré contre la mosquée de La Grand-Combe, où Aboubacar Cissé, à peine âgé d’une vingtaine d’années, a été sauvagement tué de dizaines de coups de couteau et filmé agonisant par son meurtrier, répétant : « Je l’ai fait […], ton Allah de merde », certains responsables politiques, Manuel Valls en tête, se livraient à des débats sémantiques sur l’usage du mot islamophobie – quelques semaines seulement après avoir longuement dénoncé les dérives de l’administration américaine.
Cet anti-impérialisme facile repose sur une réécriture de l’histoire qui fait commencer le capitalisme à l’industrialisation, en déshistoricisant l’histoire coloniale et esclavagiste européenne qui a donné naissance aux États-Unis. Cette vision, portée par les responsables politiques, les médias, mais aussi une partie du mouvement social en France, semble moins nourrie par un attachement réel à la liberté ou à la justice que par un profond ressentiment : celui d’avoir été dépassés sur leur propre terrain – non seulement en matière de capitalisme, d’accumulation et d’extraction, mais aussi militairement (en témoigne le retour des discours militaristes et virilistes sur la nécessité de ne pas se laisser dicter ses choix par les Américains), et en soft power et en impérialisme culturel, battus jusque dans la production intellectuelle.
Cette posture nourrit un sous-texte nationaliste, dissimulé sous une revendication de lutte contre le « vrai impérialisme », faisant passer celui de la France pour un moindre mal. Encore une fois, retour à la plantation : cette fois-ci, les États-Unis incarnent les « Grands Blancs », tandis que la France endosse le rôle du « Petit Blanc », nostalgique de sa grandeur perdue.
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…
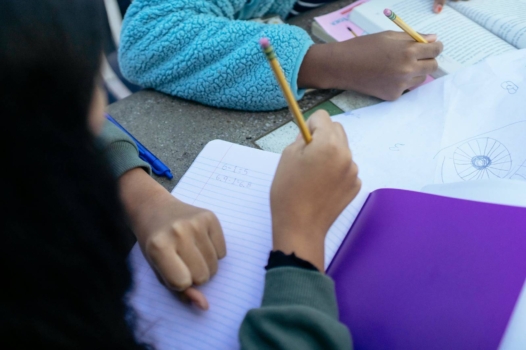
Dire que la méritocratie n’existe pas est une réalité chiffrée

Le mythe de la femme métisse

Les femmes noires sont (toujours) les grandes traîtresses du capital








