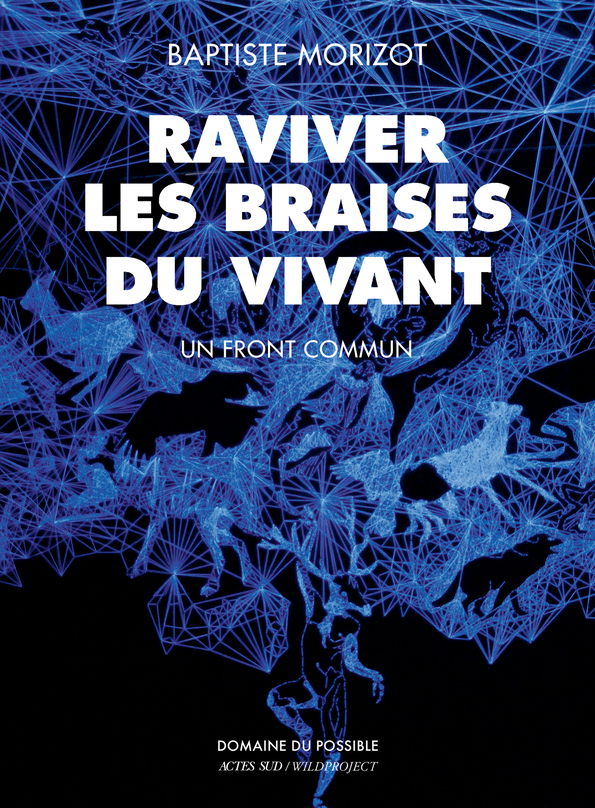Éco-anxiété : l’apprivoiser, agir et aller mieux
Depuis 2019, le terme est omniprésent dans la société et la littérature académique. Mais il dissimule toute une gamme d’émotions que les personnes sensibles à l’écologie tentent de transformer en moteur d’action.
dans l’hebdo N° 1872-76 Acheter ce numéro

© Christophe ARCHAMBAULT / AFP
Dans le même dossier…
À Dijon, les Lentillères luttent et sèment la joie Humour : « Voyez, je ne suis qu’une femme » Burn-out militant : questionner les organisations pour mieux militer Samah Karaki : « L’action est négligée dans le monde affectif »En 2015, le mouvement climat français retrouve de la ferveur pour préparer la COP 21, qui se tiendra à Paris en décembre. Chaque association, collectif citoyen ou groupe militant espère que ce sera un moment majeur pour lutter contre le changement climatique – même si les attentats de novembre 2015 ont assombri la fête et compliqué les actions. Vincent Verzat, vidéo-activiste, filme ces instants et ceux des années suivantes.
Sa chaîne YouTube « Partager c’est sympa » devient une référence sur le sujet. « L’émulation de la COP 21 et les liens affectifs qui se sont tissés nous ont aidés à mener des actions parfois difficiles et à regarder les faits scientifiques en face », glisse-t-il. Vincent, sa casquette et sa caméra sont de toutes les luttes.
L’éco-anxiété est une réponse légitime (et non irrationnelle) au regard de la crise environnementale.
Ademe
Le jeune homme traverse avec beaucoup d’enthousiasme la période quasi bénie de 2018 et 2019, avec des marches pour le climat mémorables et des actions de désobéissance civile rafraîchissantes. Mais, en 2020, il est rattrapé par ce qu’on nomme aujourd’hui éco-anxiété, quand la pandémie de covid-19 ralentit tout.
Selon une étude récente de l’Agence de la transition écologique (Ademe) et de l’Observatoire de l’éco-anxiété, un Français sur quatre serait moyennement à très fortement éco-anxieux, et cela concerne tous les profils de 15 à 64 ans. L’Ademe souligne que « l’éco-anxiété est une réponse légitime (et non irrationnelle) au regard de la crise environnementale ». Elle est devenue un enjeu de santé publique.
Mais la tentation est grande de ne percevoir que la dimension individuelle de ce mal contemporain et d’esquiver son ampleur collective et politique. Pour Jean Le Goff, psychosociologue au Centre Esta, auteur de Politiser l’éco-anxiété (Éditions du Détour), « il est important pour les personnes qui ressentent une détresse de poser clairement que l’éco-anxiété n’est pas une maladie. Il ne s’agit pas de nous guérir de notre préoccupation pour la planète, mais à l’inverse de la prendre au sérieux pour agir sur les causes de la crise écologique. » (1).
Mise à jour le 8 septembre 2025, à la demande de Jean Le Goff.
Comprendre : le système capitaliste, les énergies fossiles, l’inaction politique. S’il a mené son enquête auprès des militant·es climat avant 2015, une époque où le mot « éco-anxiété » n’était pas employé, il a observé les mêmes sentiments : angoisse, colère, incompréhension, culpabilité, sentiment d’impuissance. Une palette d’émotions avec laquelle les personnes conscientes de l’urgence climatique doivent se débrouiller.
De la prise de conscience à la désobéissance civile
La réalité scientifique et effrayante du changement climatique, Xavier Capet la connaît bien en tant qu’océanographe. L’année 2015 a été un tournant pour lui, en raison de la COP 21 mais aussi de la naissance de son fils. La canicule lui fait prendre conscience de la vulnérabilité non seulement des personnes âgées ou très malades, dont il avait beaucoup été question lors de l’été caniculaire de 2003, mais aussi des nouveau-nés. Il repense aux histoires qu’on raconte aux enfants sur les animaux, dont beaucoup sont en réalité sur la liste rouge des espèces menacées. Il a l’impression de mentir aux générations futures.
« Entre 2015 et 2019, je sens la colère monter », avoue le scientifique, qui cite l’accord non contraignant de la COP 21, les politiques déniant la résistance citoyenne et se glorifiant de l’abandon du projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes, la Convention citoyenne pour le climat méprisée par Emmanuel Macron.
Pour cette dernière, il coécrit une proposition sur la pertinence de « distinguer le vital et le non vital », notamment sur l’artificialisation des terres et sur des usages du transport aérien qui pourraient être limités. Certains scientifiques taxent les auteur·ices de militantisme, car ils ont eu l’audace d’écrire une note sur un sujet différent de leur objet d’étude. Autre motif de rogne, et de lutte.
Est-ce qu’on va léguer à nos enfants un climat où l’été signifie appréhension des événements climatiques extrêmes ?
X. Capet
Xavier Capet trouve tout de même des collègues au sein de son laboratoire LOCEAN qui se posent les mêmes questions que lui. Ils veulent que leurs pratiques soient en cohérence avec les réalités écologiques. Il reçoit une nouvelle dose d’oxygène en rencontrant le mouvement climat, « tous ces jeunes qui ont entendu le message de la communauté scientifique », et décide de franchir le cap de la désobéissance civile « pour agir et crédibiliser leurs actions ».
Il garde un souvenir ému de l’action contre « la République des pollueurs » en 2019, à La Défense… et du regard hargneux de certains salariés de Total. Il sera également témoin lors de procès d’activistes, ce qui génère « une grosse charge émotionnelle », et participe à des actions de Scientist Rebellion. Autant de façons de sortir de sa zone de confort qui l’ont un peu apaisé. Même si des bouffées de colère surgissent ponctuellement : quand le gouvernement détourne le sens du mot « sobriété » en tuant toute possibilité de débat, quand la France se félicite de ses aires marines protégées alors que le chalutage est autorisé dans 98 % d’entre elles…
« Les mots ont un sens quand même ! », fulmine Xavier Capet. Le mot « éco-anxiété » ne lui parle pas particulièrement, mais il estime souffrir de solastalgie. Ce sentiment de tristesse est lié au deuil d’un « endroit mental » : par exemple, les sensations positives et la forme d’insouciance qui pouvaient accompagner l’arrivée de l’été. « Est-ce qu’on va léguer à nos enfants un climat où l’été signifie appréhension des événements climatiques extrêmes ? L’été, on se prend en pleine figure l’irresponsabilité de nos sociétés. Ça a de quoi rendre triste. »
Sidonie Catalano, 19 ans, ne cite pas expressément le mot « éco-anxiété », mais elle raconte naturellement avoir toujours connu des inondations de sa ville et de son école par des débordements de plus en plus intenses de l’Yvette, qui parcourt l’Essonne. Ou avoir été profondément marquée par un incendie qui encerclait Athènes lors d’un voyage en Grèce. La peur s’est installée dès le collège devant la cascade de mauvaises nouvelles diffusées dans les journaux télévisés : canicules, inondations, mégafeux…
À la même période, Greta Thunberg exprime ses multiples émotions face à l’urgence climatique et commence les grèves pour le climat. « Ça me plaisait mais ça me paraissait loin. Et il y avait sûrement un effet d’attente que les autres agissent pour nous, dit-elle. Au lycée, j’ai commencé à mieux m’informer, à me politiser et à me dire qu’il fallait mettre la peur de côté et agir. » Elle participe à quelques manifestations et rejoint l’association Fridays for future (FFF).
En 2024, ses membres font grève avec cette revendication : taxer les grands voyageurs aériens afin de financer le train. Étudiante à Science Po, à Dijon, Sidonie s’est investie dans la coordination des Science Po Environnement et dans l’association Cyclistes solidaires, dont la mission cette année était d’apporter les dons récoltés à la Fondation Cram, qui œuvre pour la préservation des écosystèmes marins à Barcelone. « C’est minuscule comme action, mais je me dis que je pourrais faire un peu plus la prochaine fois. Et je me sens utile », conclut-elle.
Changer le moteur d’action
Parfois, il faut accepter de changer de moteur d’action. Pour Vincent Verzat, le remède a été de s’autoriser à se connecter à ses émotions. Son refuge : l’observation animalière. Son nouveau mantra, la philosophie de Baptiste Morizot : la cécité face aux dynamiques des écosystèmes et à l’existence des autres êtres vivants nous conduit dans un monde où rien ne saura vivre. Les longues heures à pratiquer l’affût et le pistage d’animaux sauvages dans des friches de son village lui ont procuré « un cortège d’émotions inattendues ».
D’abord l’apaisement puis la découverte de la puissance de « s’attacher à des non-humains et un territoire », à l’opposé des déplacements express sur les lieux en lutte qu’il filme. « La rage et la colère vibrent en moi depuis toujours. Là, je me suis retrouvé ému aux larmes devant une renarde allaitant ses petits. » Il ressent d’abord une forme de culpabilité à délaisser les luttes puis, au fil du temps, saisit que « goûter à la beauté du monde » est une autre façon d’agir.
Esther Le Cordier a souffert d’éco-anxiété pendant plusieurs années, allant jusqu’à des crises de pleurs et « une tétanie constante » qui a poussé son médecin à lui conseiller de faire une pause dans ses études d’anthropologie. Elle s’engage activement dans les marches pour le climat, au sein du mouvement Youth for Climate, et contre un projet d’écoquartier dans sa ville de Nantes, mais cela n’apaise pas ses angoisses.
L’antidote a été de sortir des revendications écolos un peu naïves et de comprendre que l’écologie ne peut être séparée des luttes sociales et des mouvements de libération des peuples. « M’entourer de personnes engagées dans les luttes anticoloniales, qui ont vécu des choses terribles dans leurs corps, m’a appris à utiliser ma colère pour la transformer en force révolutionnaire », analyse celle qui se définit aujourd’hui comme militante internationaliste. Elle enrage face à la loi Duplomb, adoptée début juillet au Sénat, ou la situation à Gaza : elle a tenté de participer à la marche mondiale vers le point de passage de Rafah mais a été interceptée en Égypte.
Aujourd’hui, elle se mobilise pour la campagne Mille Madleen pour Gaza, qui vise à organiser une flottille civile humanitaire. Sa rencontre avec le mouvement kurde a été déterminante pour modifier son logiciel de pensée. Elle comprend que ce peuple, persécuté depuis des décennies, s’est auto-organisé pour créer un mouvement et le massifier. L’expérience de ces militants lui a donné un nouvel espoir : « Ils m’ont permis de comprendre que les sociétés peuvent reprendre en main leur sort sans passer par le système étatique, et de croire qu’on peut gagner. Et ça, c’est nouveau dans mon militantisme ! »
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…

À Paris, « une agriculture basée sur l’exportation détruit les agriculteurs »

Nous appelons la France à voter contre l’accord UE-Mercosur

COP21 : comment le CAC 40 contourne l’accord de Paris