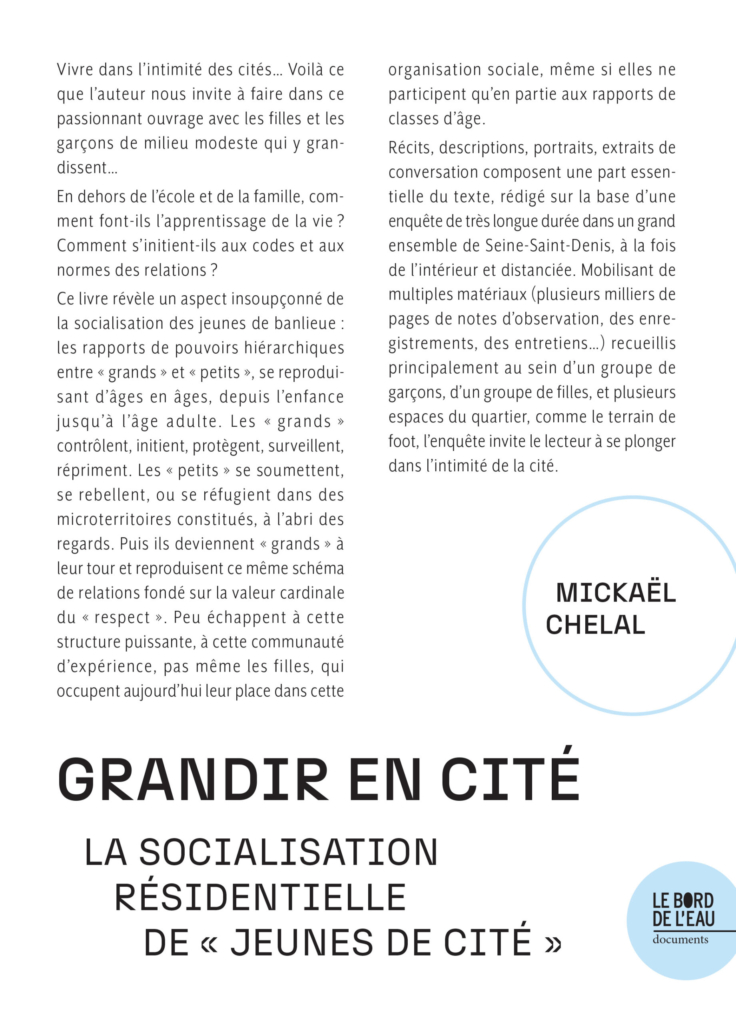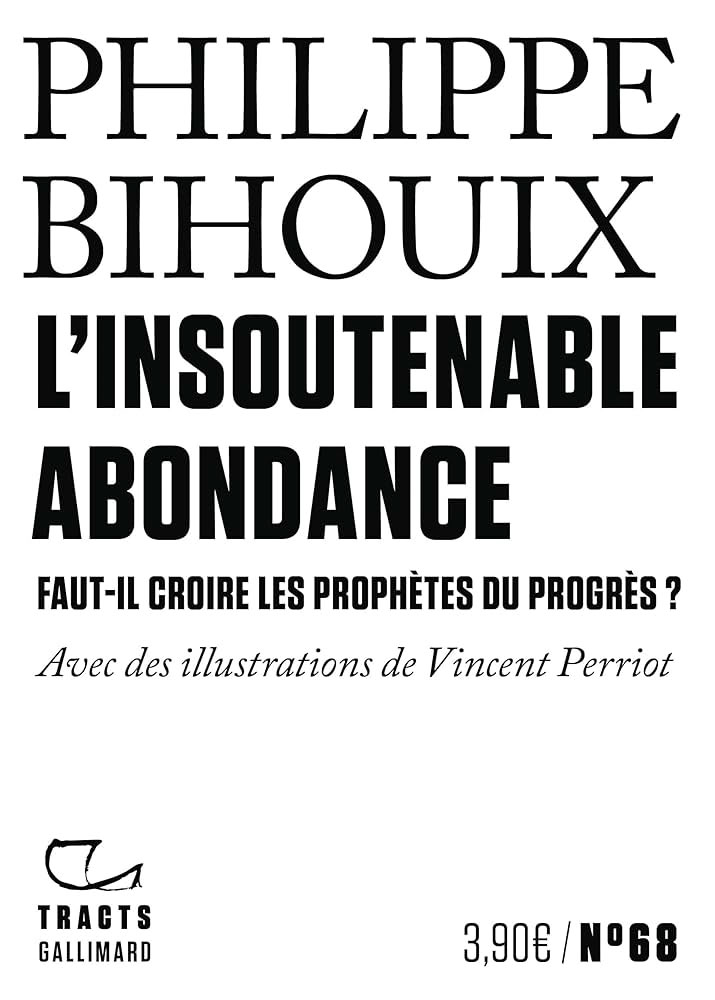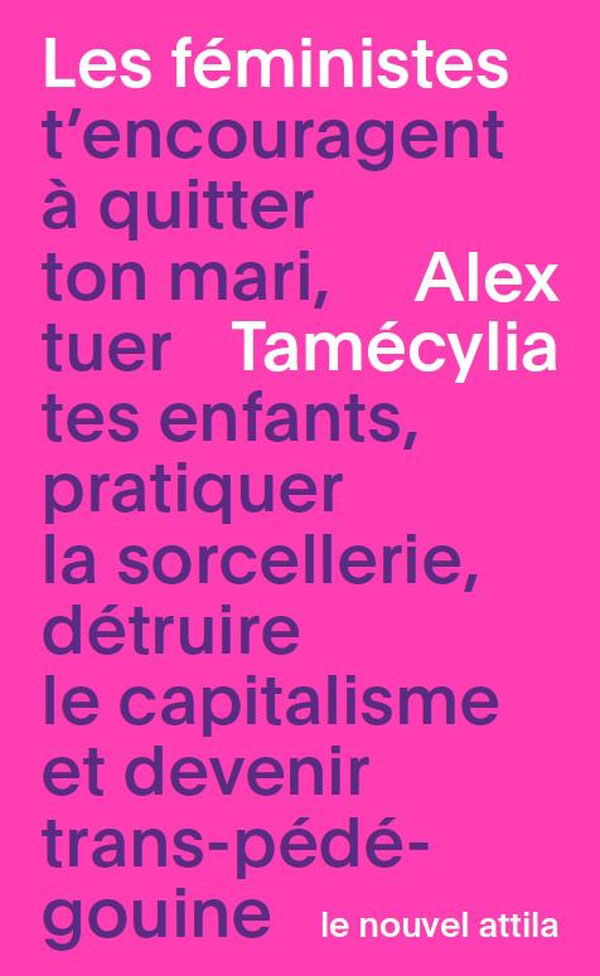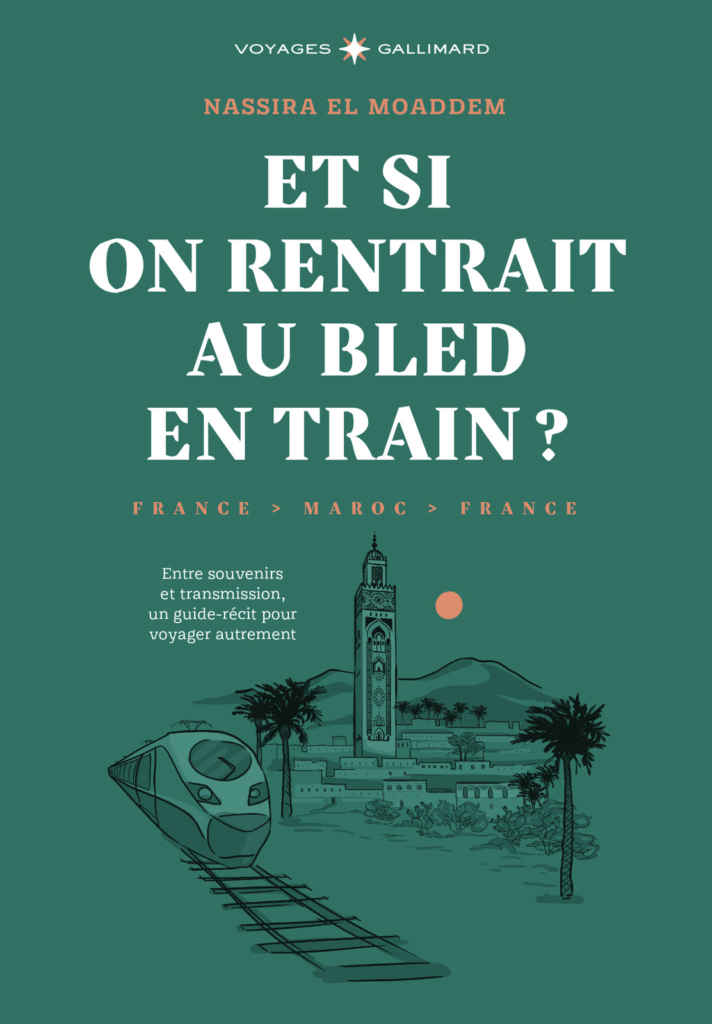En finir avec le mythe du « banlieusard-casseur »
À chaque débordement dans un cadre festif, les projecteurs médiatiques se braquent sur la jeunesse venue des périphéries. Entre fantasme médiatique et héritage colonial, cet imaginaire a la peau dure.
dans l’hebdo N° 1871 Acheter ce numéro

© Serge Tenani / Hans Lucas / AFP
Lors de la Fête de la musique à Paris, quelques débordements ont éclipsé les célébrations ; les médias ont alors pointé du doigt les banlieues et la jeunesse noire et arabe, renforçant clichés et amalgames. C’est ce qu’on peut définir comme le « mythe du banlieusard-casseur », une construction du discours médiatico-politique pour désigner la manière dont, à chaque mobilisation ou événement, on tend à désigner systématiquement les jeunes des quartiers populaires – Noirs et Arabes – comme responsables des violences et des casses. Une rhétorique qui tire son argumentaire des révoltes de 2005, ravivée en 2023, et assoit une vision erronée et stigmatisante.
Sur le plateau de CNews, Paul Sugy, journaliste, a décrit les incidents survenus lors de la Fête de la musique comme « une appropriation symbolique de la jeunesse bourgeoise par la racaille », opposant une jeunesse « bien élevée, presque exclusivement blanche », à une jeunesse « immigrée venue de banlieue », illustrant ainsi le mythe du banlieusard-casseur. Dans le même registre, ce journaliste a qualifié la soirée de la finale de la Ligue des Champions de véritable « guérilla urbaine », tandis que Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur, n’a pas hésité à parler de « barbares » pour désigner les casseurs. Un lexique qui mobilise des marqueurs associés dans l’esprit collectif à l’arabité.
C’est avant tout une construction raciste liée à l’histoire coloniale : celle du sauvage et du barbare.
C. Ch
Pour Mickaël Chelal, sociologue et auteur du livre Grandir en cité (Le Bord de l’eau), ce mythe s’inscrit dans une histoire plus large de la stigmatisation des classes populaires urbaines : « Depuis la fin du XIXe siècle, et notamment de la classe ouvrière urbaine, qu’on appelait “la classe dangereuse”. » Cet imaginaire lourd dépasse le simple « mythe » pour Célia Ch, chercheuse en sociologie des médias et créatrice du blog ALATVSURMATV : « C’est avant tout une construction raciste liée à l’histoire coloniale : celle du sauvage et du barbare. Les populations qui y vivent sont encore perçues comme des sujets coloniaux : supposés peu éduqués, peu civilisés, donc forcément violents. »
Elle ajoute que la représentation des casseurs « est une image associée au jeune homme noir ou arabe qui ne sait pas se comporter : il est violent, il casse, il crie ». Cette figure repose sur l’idée que ces jeunes seraient intrinsèquement déviants, incapables de s’autodiscipliner et que c’est à « l’homme blanc de leur apprendre les codes du civilisé ».
Typologie des émeutes : des banlieues au centre-ville
Placer sur le même plan les émeutes de 2005 et 2023 et les débordements qui suivent des festivités parisiennes revient à effacer la substance dénonciatrice de ces actes et à minimiser la colère légitime de ceux qui en sont à l’origine. Derrière l’image bien ancrée du « banlieusard-casseur » se cache une réalité plus complexe. En réduisant les violences urbaines à des actes gratuits, on passe à côté de leur dimension profondément politique. Pour la chercheuse Célia Ch, ces épisodes doivent être analysés comme de véritables « émeutes politiques », ancrées dans des revendications sociales précises.
Plusieurs dynamiques se dégagent. La première, récurrente, surgit à la suite de violences policières touchant des jeunes issus de quartiers populaires, souvent en banlieue. Ces événements tragiques impliquent fréquemment des mineurs. Faute de réponse politique ou judiciaire, la colère s’exprime dans la rue. L’émeute devient alors une manière de briser le silence, de remettre sur la carte des territoires trop souvent oubliés.
Autre forme de contestation : celle des gilets jaunes en 2018. Cette fois, ce n’est pas la banlieue mais les centres-villes, notamment Paris, qui deviennent le théâtre de la colère. Ici, ce n’est pas l’injustice policière, mais la précarité économique et le sentiment d’abandon qui mettent le feu aux poudres. Même logique, autre décor : porter la colère là où les décisions sont prises.
À cela s’ajoute une troisième dynamique, plus ponctuelle : les violences en marge d’événements festifs – Fête de la musique, finales sportives, etc. Dans ces contextes, l’excès d’alcool, la foule et un climat de permissivité peuvent rapidement faire dérailler la fête. Surtout quand l’encadrement sécuritaire est perçu comme trop massif. Exemple : lors de la finale de la Ligue des champions, 5 400 policiers et gendarmes avaient été déployés, selon le préfet de police Laurent Nuñez.
Un traitement médiatique différencié
Malgré des dynamiques différentes, une constante : la présence policière. Selon Célia Ch, elle constitue le « dénominateur commun » à ces scènes de violence. Plus le dispositif est imposant, plus le sentiment d’un espace urbain militarisé se renforce. Avec, à la clé, une montée de la tension, du rejet et, parfois, de l’affrontement. Toutefois, les gilets jaunes ont d’abord bénéficié d’une couverture médiatique plus nuancée, teintée d’empathie, portée par leur forte présence sur les plateaux télé. « Parce qu’ils sont majoritairement blancs, ils sont perçus comme Monsieur et Madame Tout-le-Monde, donc plus universels dans leur combat », souligne la chercheuse.
Un travail journalistique qui « reproduit les imaginaires associés aux cités« .
M. Chelal
Au contraire, elle relève deux points communs flagrants dans le traitement des émeutes de 2005 et 2023 : « Elles sont racontées par les images, les chiffres et la parole policière. Les raisons n’existent pas. Zyed, Bouna, Nahel n’ont pas droit à des portraits. La colère est niée, les violences policières sont invisibilisées, et on assiste pour chaque événement à une hyperfocalisation sur les dégâts matériels. » Mickaël Chelal pointe quant à lui « la recherche de sensationnalisme liée au champ médiatique », ainsi qu’un travail journalistique qui « reproduit les imaginaires associés aux cités ».
Contrairement à une idée reçue largement diffusée, les émeutes et les actes de casse ne sont ni récents ni propres à la jeunesse d’origine africaine des quartiers populaires. Bien avant 2005, d’autres formes de violences urbaines ont été menées par des groupes organisés, souvent issus de milieux étudiants, blancs et bourgeois. Parmi eux, les Black Blocs, apparus en Europe dans les années 1980, ainsi que d’autres groupes engagés dans des luttes politiques ou écologiques.
Si les émeutes et les violences urbaines ne prennent pas systématiquement racine dans les banlieues ni chez les jeunes d’origine africaine, les grands médias persistent à construire un profil type qui mêle raccourcis et stéréotypes. En entretenant ce récit, ils renforcent un mythe tenace qu’il devient urgent de déconstruire.
L’Insoutenable Abondance. Faut-il croire les prophètes du progrès ?, Philippe Bihouix et Vincent Perriot (illustrations) Tracts Gallimard, 60 pages, 3,90 euros.
Ce livre est une réflexion percutante sur notre société de consommation effrénée et ses effets sur l’individu et l’environnement. À travers une écriture à la fois lucide et incisive, l’auteur dépeint l’excès matériel comme un piège qui menace de détruire notre équilibre personnel et collectif. En analysant les dérives de la surabondance, Bihouix invite le lecteur à questionner son rapport à l’objet, à la possession et à la satisfaction. Un ouvrage essentiel, pertinent et nécessaire, qui pousse à la réflexion sur notre modèle de vie contemporain et qui résonne comme un appel à la sobriété. Un livre à ne pas manquer pour les amateurs de littérature engagée.
Les féministes t’encouragent à quitter ton mari…, Alex Tamécylia, Le nouvel attila, 160 pages, 12 euros.
Le titre complet de ce petit livre ironiquement rose flashy est : Les féministes t’encouragent à quitter ton mari, tuer tes enfants, pratiquer la sorcellerie, détruire le capitalisme et devenir trans-pédé-gouine. Outré ? Cette phrase a réellement été prononcée, presque en ces termes, par un télévangéliste américain. Alex Tamécylia a décidé de s’emparer du stigmate et de le retourner comme peau de lapin, en tirant dans le tas de la masculinité toxique ou imbue (le « papa-poussette » paré de ses plumes d’exploit, le mansplaineur de compétition…), de l’hétéronormativité, des injustices économiques genrées et autres consternations. S’il y a de la colère dans cet ouvrage, il y a surtout un humour éclatant (de rire), une tendresse sororale, l’énergie de la lutte et une langue hyper créative. Comme le note l’écrivaine Chloé Delaume en préface, il a « le goût du vitriol et de la lucidité ».
Et si on rentrait au bled en train ? Entre souvenirs et transmission, un guide-récit pour voyager autrement, Nassira El Moaddem, Gallimard Loisirs, 144 pages, 19,90 euros.
Depuis trois ans, la journaliste Nassira El Moaddem et sa famille consacrent leur été à faire le rituel voyage entre la France et le Maroc, où sont leurs racines, en train. Elle en tire un « guide-récit » tendre et engagé. On entend une légère nostalgie venant de ce périple fait dans l’enfance, dans une voiture surchargée, ou ses voyages solo ado ou jeune journaliste. Mais elle transforme cette expérience intime en ode au voyager autrement, pour toutes et tous, en mêlant avec simplicité les notions de mémoire des générations issues de l’immigration, d’écologie, et de justice sociale. Une réponse, bien ancrée dans le présent, à ceux qui lui disent : « Rentre dans ton pays ! » Car, comme elle le résume, « rentrer au bled est devenu un geste politique ».
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…

L’hystérie, symptôme… des violences masculines

Christiane Taubira : « Face à Trump, la France ne joue pas son rôle de puissance régionale »

Marcuse, penseur du néofascisme qui vient