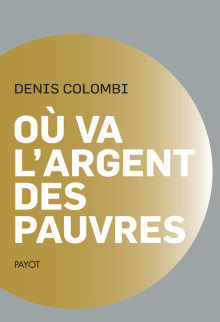Allocation de rentrée scolaire : « On laisse penser que les pauvres méritent leur pauvreté »
Comme chaque année, des politiques et des éditorialistes utilisent l’allocation de rentrée scolaire pour relancer le débat sur « l’assistanat ». Entretien avec le sociologue Denis Colombi, qui décortique ce mythe.

© Philippe Huguen / AFP
Dans le même dossier…
Des enseignants bien seuls face à la pauvreté « Nous demandons juste l’égalité des chances »En cette fin de vacances, l’allocation de rentrée scolaire vient donner un coup de pouce aux familles. Mais avec cette aide vient son lot de désinformation. Sur les plateaux télés et les réseaux sociaux, nombreux soutiennent que les familles l’utiliseraient pour autre chose que les fournitures scolaires. Écrans plats, smartphones, jeux vidéo… Chaque année, la consommation des familles les plus précaires est scrutée. Pour Denis Colombi, sociologue et auteur d’Où va l’argent des pauvres (éditions Payot), la persistance de ce mythe illustre parfaitement un mépris et une défiance envers les pauvres.
À chaque rentrée, un discours revient autour du versement des allocations de rentrée scolaires : certaines familles l’utiliseraient pour s’acheter une télé plutôt que des fournitures. Pourquoi ce mythe persiste-t-il ?
Denis Colombi : D’une part, il y a l’idée que l’allocation de rentrée scolaire serait mal utilisée. Aucune enquête sociologique n’appuie cette théorie. Mais chaque année, ce mythe persiste parce qu’il y a des personnes comme des éditorialistes qui reprennent ce mythe et se basent sur des on-dit, sans aucun exemple précis, ce qui rend très facile de le réactiver.
Où va l’argent des pauvres, Denis Colombi (éditions Payot), 22 euros.
Depuis quelque temps, c’est devenu une ressource politique, essentiellement celle de l’extrême droite, et de plus en plus d’une partie de la droite. Elle consiste aussi à dire que les savoirs, les recherches, et la science même, ont peu d’importance. On trouve ce procédé chez Trump, mais aussi au Rassemblement national en France.
La deuxième raison, c’est que ce mythe s’appuie sur la perception générale qui consiste à dire que si les pauvres sont pauvres, c’est qu’ils font quelque chose de mal, qu’ils ont une tare.
Ces consommations s’expliquent non pas malgré la pauvreté, mais à cause de la pauvreté.
On peut trouver des personnes avec très peu de moyens qui ont des consommations dont on se dit de l’extérieur qu’elles ne sont pas indispensables. Cette année, c’étaient les consoles de jeux vidéo, avant il y a eu les écrans plats, les baskets, ou encore le smartphone. Rien ne prouve qu’elles ont été payées avec l’allocation de rentrée scolaire. Mais le mythe va se greffer sur ces exemples.
En revanche, ce qu’on ne voit pas, c’est que, souvent, ces consommations s’expliquent non pas malgré la pauvreté, mais à cause de la pauvreté. Les familles qui achètent des vêtements de marques à leurs enfants malgré le manque d’argent, c’est parfois simplement parce que les parents se disent « je veux faire plaisir à mon enfant, ils voient cet objet partout, donc je vais me priver moi ». Ce sont des consommations qui sont faites pour gérer la pauvreté.
Dans votre livre vous utilisez la notion de « transfert de pouvoir » plutôt que de « transfert de richesse » dans la question de ces allocations. En quoi est-ce un transfert de pouvoir ?
Souvent, on pense que l’argent qui est redistribué est un pur transfert d’argent, mais ça reste notre argent, c’est-à-dire l’argent de la société qui est donné à des personnes en situation de difficulté. De ce fait, ils doivent l’utiliser comme on veut, nous. Si on leur donne de l’argent à la rentrée scolaire, cela doit être pour s’acheter des cahiers, des stylos et rien d’autre.
On n’accepte pas l’idée qu’il y ait un transfert de pouvoir, c’est-à-dire une capacité pour eux de décider. Pourtant, un smartphone aujourd’hui, c’est parfois le seul accès à Internet qu’on peut avoir et il faut suivre Pronotes, si on est en collège. L’école s’est transformée pour inciter les familles à avoir besoin d’un accès à Internet. On ne peut pas leur faire le reproche de vouloir le faire.
Pourquoi pensez-vous qu’il y a une partie des politiques et des éditorialistes qui n’acceptent pas que les pauvres aient ce pouvoir ?
Si on pense que les pauvres le sont par leur faute, alors cette réaction est une forme de punition. Et si on leur donne la possibilité sans subir les conséquences, il y a une espèce de sens moral qui est touché. Ils devraient souffrir parce qu’ils sont pauvres. En réalité, on ne tombe pas dans la pauvreté par sa faute, et certainement pas par des consommations.
Et puis, il y a un certain nombre de fonctions sociales à la pauvreté. La pauvreté fournit des travailleurs qui sont disposés à accepter des tâches que personne d’autre n’accepterait ou qui sont difficiles. Ceux qui ne sont pas pauvres sont alors motivés à continuer à faire des efforts parce qu’ils ont peur de tomber dans la pauvreté, qui est justement définie non seulement comme honteuse mais aussi comme une situation très difficile. Cela permet de légitimer sa propre richesse. Si les pauvres méritent leur pauvreté alors moi, qui ne suis pas pauvre, je mérite ma capacité d’action, mon pouvoir.
Une des « solutions » qui revient tous les ans serait de verser les aides en nature plutôt qu’en numéraire. Quelles seraient les conséquences ?
On pense que les familles ne sont pas capables de gérer cet argent. Il faut donc le faire à leur place. Pour cela, il faudrait mettre en place une usine à gaz administrative, en redéfinissant des listes de fournitures, vérifier que les dépenses sont bien utilisées pour ça. Ces personnes qui généralement sont très soucieuses de comment on dépense l’argent public proposent une solution qui coûterait finalement beaucoup plus cher.
Ceux qui sont très soucieux des dépenses publiques proposent une solution qui coûterait beaucoup plus cher.
On aurait un contrôle comme présenter les factures et les tickets de caisse pour montrer que cet argent a bien été utilisé, ce qui demande également une véritable organisation pour quelque chose dont l’efficacité n’est pas certaine. Tout ça juste pour le plaisir de la supériorité morale.
Y a-t-il une figure du « bon pauvre » ?
On n’a pas de définition précise de ce qu’est le bon pauvre, et la figure est extrêmement malléable. Mais il y a l’idée que c’est celui qui mérite d’être aidé, parce qu’il fait des efforts, ou parce qu’il est suffisamment en difficulté. Il y a deux types de personnes qui font la manche dans le métro à Paris : ceux qui essayent de montrer qu’ils sont vraiment à difficulté, qu’ils sont sales mais dont on pourrait se dire qu’ils vont aller boire, ou aller utiliser l’argent pour de la drogue. Et puis il y a ceux, plus « présentables », qui montrent qu’ils sont prêts à travailler et fournir des efforts.
On pourra se dire que les pauvres s’occupent mal de leurs affaires, ou qu’ils votent à l’extrême droite, qu’ils sont racistes ou homophobes. Ce sont des questions, y compris à gauche, qu’on va retrouver et qui vont justifier qu’on ne vienne pas en aide aux personnes en difficulté. Parce que le pauvre méritant n’existe pas dans la réalité.
C’est pour ça que, généralement, les mécanismes d’aides aux plus pauvres, privés, publics ou de type associatif aident tout le monde. Ils sont définis comme étant un droit, et non soumis à l’approbation d’un groupe particulier. C’est l’idée que les pauvres méritent d’être aidés, non pas en fonction de ce qu’ils font, mais simplement parce que la pauvreté doit être combattue. C’est cette idée-là qui s’érode le plus rapidement.
Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.
Faire Un DonPour aller plus loin…

Minute de silence pour Quentin Deranque : « Une ligne rouge a été franchie »

Antifascisme : quand la gauche doute de son combat historique

Municipales 2026 : à Cayenne, l’enjeu sécuritaire dépasse la campagne